1911 Dictionnaire du socialisme [Vérecque]
Anarchie, Anarchistes. Nous ne voulons signaler ici que le combat mené par les socialistes contre les anarchistes qui sont leurs ennemis de tous les jours au même titre que les bourgeois. Socialistes et anarchistes ont toujours été en lutte les uns contre les autres. Dès 1878, l’Egalité, le premier organe collectiviste de France, ouvrit les hostilités contre les anarchistes. A ce moment il y avait en France, en fait d’anarchistes, un italien André Costa, venu depuis au socialisme, et une russe Anna Koulichoff, venue depuis également au socialisme. Nous les avons combattus; ce combat a été poursuivi. En 1887, Duc-Quercy, Deville, Fournière, Goullé, Guesde, quittaient Le Cri du peuple pour ne pas supporter l’apologie des actes de l’anarchiste Duval. Le 9° congrès national du Parti ouvrier français (Lille, 1890), et les congrès internationaux de Bruxelles, 1891, et de Londres, 1896, déclarèrent qu’ils n’avaient rien de commun avec les anarchistes et leur fermèrent les portes. Dans ce dernier congrès les anarchistes avaient tenté de s’y introduire comme représentants des organisations syndicales. leur masque fut arraché et ils furent mis dehors. Ceci nous amène à parler un peu de l’évolution qui s’est produite chez les anarchistes. Jusqu’à l’époque des lois scélérates, en 1893-94, les anarchistes furent contre les organisations syndicales ; depuis ils ont changé de tactique; les lois scélérates les ayant matés, ils s’introduisirent dans les syndicats ouvriers et y semèrent leurs idées. L’anarchie s’est transformée en syndicalisme. Les syndicats qu’ils ont réussi à conquérir leur servent pour combattre les socialistes et diviser la classe ouvrière. (…) L’Anarchisme, intéressante brochure de Gabriel Deville, dans laquelle il critique et raille les anarchistes dont la conception a un caractère rétrograde, (Paris 1887).
Antimilitarisme, action contre le militarisme. Les socialistes sont des antimilitaristes, mais ils ne croient pas devoir entreprendre une campagne spéciale pour détruire le militarisme. « Je suis aussi antimilitariste que vous, disait Guesde aux délégués réunis au congrès de Limoges, en 1906. Mais ce n’est que dans le socialisme développé, grandi, devenu tout-puissant, que nous trouverons la fin du militarisme. Tout ce qui éloigne de la propagande vraiment socialiste éloigne de cette fin. »
Le militarisme comme la guerre, est un effet de la société capitaliste basée sur l’antagonisme des classes et des intérêts et ne disparaîtra qu’avec elle. Quoique sachant cela, il est cependant des citoyens qui voudraient concentrer les efforts des travailleurs pour l’abolition du militarisme et qui préconisent, les uns ou les autres, la désertion, la grève militaire et l’insurrection en temps de guerre. Ces citoyens détournent les travailleurs de la prise du pouvoir politique qui doit être leur unique préoccupation et proposent des moyens utopiques et dangereux qui compliquent les difficultés de la propagande et du recrutement socialiste.
Pourquoi appeler l’attention, plus particulièrement, des travailleurs pour la fin du militarisme et de la guerre, alors qu’il serait plus simple de renverser la société capitaliste pour en finir avec la guerre et le militarisme ! Cet antimilitarisme-là n’est pas le nôtre, celui des socialistes. La seule campagne que les socialistes doivent faire – dans l’intérêt du prolétariat et du socialisme – est celle qui organise les travailleurs pour la destruction de l’ordre capitaliste. En attendant, ils doivent poursuivre la réduction internationale du service militaire, la non-intervention de l’armée dans les grèves, l’armement général du peuple, la suppression des conseils de guerre, le refus des crédits pour la guerre, la marine, les colonies, etc.
Les congrès socialistes internationaux se sont occupés de la position et les devoirs de la classe ouvrière vis-à-vis du militarisme. Le congrès de Bruxelles, de 1891, affirme, dans une des ses résolutions, que « toutes les tentatives ayant pour objet l’abolition du militarisme et l’avènement de la paix entre les peuples – quelque généreuses qu’en soient les intentions – ne sauraient être qu’utopiques et impuissantes, si elles n’atteignent pas les sources économiques du mal », et il déclaré que, seule, la création d’un ordre socialiste mettant fin à l’exploitation de l’homme par l’homme, mettra fin au militarisme et assurera la paix définitive ». Le congrès de Zurich, de 1893, déclare également que « la chute du capitalisme signifie la paix universelle ». Le congrès de Stuttgart, de 1907, rappelle que « l’action contre le militarisme ne peut pas être séparée de l’action contre le capitalisme », et que les guerres sont de « l’essence du capitalisme et ne cessent que par la suppression du système capitaliste ».
Antisémitisme, manœuvre de la classe capitaliste destinée à faire dévier le mouvement socialiste et à diviser les travailleurs. L’antisémitisme veut rendre seuls responsables des misères ouvrières et des maux de la société les juifs ; il ne combat par le capital mais certains capitalistes ; il nie la division de la société en classes ; il nie l’existence d’une classe exploitée et d’une classe exploitrice chez les juifs et les chrétiens. Il veut aussi au profit des cléricaux, substituer une guerre de race à la guerre de classe. C’est pourquoi l’antisémitisme a été repoussé par le prolétariat et condamné par le Congrès international de Bruxelles, en 1891.
Collectivisme, communisme, socialisme.Ce sont trois termes qui signifient, aujourd’hui, la même chose, c’est-à-dire la reprise par la société des forces productives et leur utilisation au profit de tous les membres de la collectivité. A un moment donné, il y a eu, en France, cependant, nécessité de choisir un terme qui exprimait bien la socialisation des forces productives et ne prêtait à aucune confusion dangereuse. Dans l’Aperçu sur le Socialisme scientifique qui suit son important résumé, Le Capital de Marx, Gabriel Deville a fait les remarques suivantes :
« C’est le journal L’Egalité, fondé, à la fin de 1877, sur l’initiative de Jules Guesde et dirigé par lui, qui a seul donné l’impulsion au mouvement socialiste révolutionnaire actuel. Tel est le fait que ne réussiront pas à effacer les personnalités envieuses empressées à le masquer, ou tout au moins à l’amoindrir, ayant bien soin, dans leurs prétendues histoires, de cacher les dates qui ne laissent aucun doute à cet égard.
« A ce moment, il y avait utilité à distinguer le communisme scientifique sorti de la savante critique de Marx, du vieux communisme utopique et sentimental français. La même dénomination pour deux théories différentes aurait favorisé une confusion d’idées qu’il était essentiel d’éviter; aussi avons-nous alors exclusivement employé le mot collectivisme.
« Maintenant, nous écrivons collectivisme ou communisme indifféremment. Au point de vue de leur dérivation, ces deux termes sont également exacts; au point de vue usuel, ils ont les mêmes inconvénients. S’il y a eu un communisme dont nous devions nous distinguer, il y a des formes de collectivisme, les diverses contrefaçons belges par exemple, que nous répudions. L’important est de connaître non pas l’étiquette que chacun prend, mais ce que chacun met sous son étiquette. »
Dans son intéressante brochure : le Collectivisme, Jules Guesde a écrit :
« Le collectivisme ne se distingue pas du communisme scientifique, tel qui est sorti de la critique maîtresse de Karl Marx. Si cette appellation a prévalu en France, c’est que, pour les besoins de notre propagande, il y avait lieu de nous distinguer des divers systèmes communistes qui, forgés de toutes pièces par des hommes de plus ou moins de bonne volonté ou de génie, versaient tous dans l’utopie. »
De son côté, Paul Lafargue a publié la note que voici dans son ouvrage, la Propriété :
« Le mot collectivisme employé par Collins dans un sens spécial, mis en circulation par de Paepe, par Schaeffle, le socialiste chrétien, et par Bakounine, a été importé en France, sans qu’on se fut rendu compte de sa signification. Il a permis à nos adversaires d’accuser les socialistes français de vouloir faire régresser le mouvement au collectivisme du mir russe, une forme épuisée de la propriété. Mais, à partir de la deuxième Égalité (1880), la vulgarisation des théories de Marx et d’Engels ayant donné une signification communiste au mot collectiviste, on n’a pas cru utile de le supprimer. »
Ayant donné des détails historiques sur le mot collectivisme, il importe maintenant de dire ce qu’il contient. Les socialistes préconisent la solution collectiviste parce qu’elle est commandée, déterminée par le développement des phénomènes économiques. Ils ne fondent pas leurs revendications communistes sur des sentiments de justice, de morale, de droit ou d’égalité, mais sur la ruine qui se consomme journellement du mode de production capitaliste. Marx, a dit Engels, a toujours fondé ses revendications communistes « . . . sur la ruine nécessaire, qui se consomme sous nos yeux, et de plus en plus, du mode de production capitaliste. » Et Engels a ajouté : « L’ensemble d’idées que représente le socialisme moderne n’est que le reflet dans l’intelligence, d’un côté de la lutte des classes qui règne dans la société entre les possédants et les dépossédés, entre les bourgeois et les salariés, et de l’autre de l’anarchie qui règne dans la production. »
La production capitaliste a succédé à la production individualiste d’avant la grande révolution bourgeoise. Pour quiconque s’intéresse à l’évolution économique de la société, un énorme changement s’est produit autour et en dehors des hommes.
Pendant la période individualiste, notamment, le produit du travail était une œuvre individuelle. Un seul individu participait généralement à sa confection. Le menuisier, par exemple, qui réunissait en lui-même les éléments manuels et intellectuels, concevait un meuble, en traçait le plan, puis le construisait seul.
Aujourd’hui, au contraire, le produit du travail est une œuvre collective or communiste. De nombreux ouvriers collaborent à sa confection. Ainsi la chaussure qui, dans la petite industrie individualiste, est l’œuvre de plusieurs. Dans les grands ateliers mécaniques, un ouvrier découpe le cuir, un second réunit les morceaux, un troisième fait les talons, un quatrième fait autre chose.
Un immense mouvement de centralisation et de collectivisme s’est opéré et s’opère de plus en plus dans les profondeurs de la société moderne. Dans toutes les branches de l’activité humaine, dans l’agriculture, dans le commerce, dans l’industrie, dans la finance capitaliste, tout se centralise, tout se fait ou se met en commun. Les produits du travail, œuvre collective, sont réunis, mis en commun dans de vastes entreprises. Les moyens de production et d’échange collectivement mis en valeur, en action, sont réunis, mis en commun dans des magasins, des chantiers, des bureaux dont la puissance vous surprend d’étonnement.
Pendant la période de l’industrie individualiste, dans tous les villages, dans toutes les familles, on tissait, on tricotait, on filait. Toutes ces industries, fractionnées étaient alors disséminées sur tout le territoire. De nos jours, elles ont été centralisées dans certaines régions. Les instruments à filer et à tisser, transformés complètement, ont été réunis, mis en commun dans de vastes ateliers où on file et on tisse pour toutes les familles.
Dans le commerce, la même centralisation existe. Autrefois, placé sous la volonté de fer des corporations de métiers dont il fallait observer les règlements et les actes, un individu ne pouvait vendre qu’un seul objet. Un coutelier, par exemple, ne pouvait vendre que des couteaux. De nos jours, dans les grands bazars du capitalisme se trouvent réunis, mis en commun et vendus tous les objets les plus divers. Ces gigantesques entreprises renferment tout ce qu’on peut imaginer pour satisfaire tous nos besoins.
L’agriculture n’échappe pas non plus à ce mouvement économique. Autrefois, existaient de nombreuses fermes entourées de petites terres. La propriété féodale était très morcelée ; aujourd’hui, toutes ces petites terres sont réunies, mises en commun, et forment la grande propriété. Je sais bien – je me hâte de le déclarer – que la centralisation s’est faite et continue à se faire plus lentement dans l’agriculture que dans le commerce ou l’industrie ; mais elle se fait sûrement et, demain peut-être se trouvera-y-elle précipitée sous l’impulsion d’événements que nous ne prévoyons pas.
Les capitaux aussi sont mis en commun : la finance se centralise. Autrefois, pour une entreprise personnelle, il ne fallait pas grand’chose. De nos jours, ce n’est pas suffisant. Des hommes sont nés, ayant les doigts crochus et les poches profondes des financiers qui ont vidé tous les bas de laine, qui ont centralisé les capitaux individuels et qui les prêtent pour monter les ateliers mécaniques.
Ainsi donc les moyens de production et d’échange revêtent la forme collective ou communiste. Ce caractère spécifique a été la conséquence de l’introduction et du développement du machinisme. Seul, le mode d’appropriation est resté individuel.
Autrefois l’artisan, le travailler synthétique, qui maniait l’instrument de production, le possédait. Il possédait également le produit de son travail. Sa petite propriété, dont il avait l’usage personnel, était nominale et réelle. Aujourd’hui, les moyens de production et d’échange, les mines, les usines, les chemins de fer, les grands bazars, etc., n’appartiennent pas à ceux qui les manoeuvrent. Les richesses sociales appartiennent à plusieurs capitalistes qui sont une minorité de moins en moins importante. Or, cette minorité ne connaît pas le travail. Elle jouit d’une propriété qui n’est pas réelle, qui n’est pas légitime, mais qui est seulement nominale.
Il y a là une séparation intervenue et intervenant de plus en plus entre les moyens de production et d’échange et les travailleurs, entre la forme collective ou communiste de la production et la forme individuelle de l’appropriation. C’est de cette séparation, de cet antagonisme que proviennent tous nos maux.
En se constituant, cet antagonisme a écarté de toute fonction utile, le capitaliste moderne. Au début de la production capitaliste, le possesseur d’une petite entreprise trônait au milieu d’elle. De son activité, de son intelligence, de son initiative, dépendait le sort de sa petite propriété. Il mettait, comme on dit vulgairement, la main à la pâte ; l’œil du maître chanté par le fabuliste, s’exerçait partout. Il n’en est pas de même de nos jours.
Entrez dans une entreprise quelconque et cherchez : contrairement à la parole de l’évangile, vous ne rencontrerez pas le propriétaire. Seuls, les salariés, des travailleurs communément appelés manuels et intellectuels, sont utiles à l’œuvre de la production. Seuls, des salariés, depuis le directeur, le chimiste, le dessinateur, l’architecte, jusqu’au manœuvre, jusqu’à l’homme de peine, depuis le plus payé jusqu’au moins payé, sont les créateurs de toutes les richesses sociales.
Le capitaliste, on ne le connaît pas, il est étranger à la production, il ne joue aucun rôle utile. Avec les sociétés anonymes, dont les actions et les obligations peuvent changer de mains dix et cent fois par jour, le capitaliste peut même ne pas connaître la propriété que représentent ses chiffons de papier et il peut habiter la Chine, le centre de l’Afrique ou la lune sans que pour cela la production en souffre.
Le capitaliste n’est pas seulement inutile ; il est aussi nuisible à la production. La poursuite des bénéfices, son désir de gagner toujours davantage, sa situation d’exploiteur de travail d’autrui activent la surproduction, déchaînent une concurrence effrénée et font tomber drus comme grêle les crises périodiques qui engorgent les marchés, les chômages, les morts de misère dont toute l’humanité supporte les lourdes responsabilités.
Mais patience ! Cette action inutile et nuisible de la classe capitaliste est le signe de sa mort. L’histoire nous fournit cet enseignement. Une classe qui a perdu sa fonction sociale doit disparaître fatalement. La noblesse du siècle dernier signa son arrêt de mort quand elle perdit sa fonction sociale qui était de faire la guerre. La bourgeoisie capitaliste, qui ne remplit plus aucun rôle utile, qui est étrangère à la création des richesses sociales, qui vit en parasite mortel sur le corps social, doit disparaître.
Son arrêt de mort est signé ; c’est le socialisme qui l’exécutera fidèlement en rendant possesseurs des richesses sociales les travailleurs qui les produisent ; en réunissant dans les mêmes mains, les mains des travailleurs, les moyens de production et leur collective appropriation.
Ce jour là, la production se fera au bénéfice de tous, et, contrairement à ce qui se passe de nos jours, propriétaires et libres, seront les travailleurs.
Résumons-nous. Un fait domine toutes les discussions. C’est la séparation intervenue entre les moyens de production et les travailleurs. Les travailleurs ne sont pas les propriétaires des forces productives de plus en plus puissantes mises à leur disposition. Les richesses qu’ils créent vont entre les mains de capitalistes, de moins en moins nombreux et devenant, non des propriétaires réels, mais des propriétaires nominaux. En un mot, ce sont des collectivités ouvrières qui opèrent dans le domaine de la production et c’est une poignée de capitalistes, étrangers à tout travail et transformés en êtres nuisibles, qui possède. Il y a là une contradiction entre la forme de production et la forme de l’appropriation. L’appropriation est restée individuelle alors que la production devenait collective. Cette contradiction est une conséquence du mode de production capitaliste et aboutit à tous les troubles, à tous les maux qui agitent la société. Comme on le voit, la solution collectiviste est devenue adéquate à la manière d’être des forces productives. Le développement de l’humanité, dans la paix, la liberté et le bonheur, exige impérieusement que la direction des forces productives soit soustraite aux individus et remise entre les mains de la société.
Coopération, forme de groupement, d’association, d’organisation, appelée, dans certaines conditions, à rendre des services aux travailleurs. Au début du mouvement ouvrier, après la Commune surtout, la coopération fut prêchée aux travailleurs comme un instrument d’affranchissement. Le socialisme a remis la coopération à sa vraie place. Cependant, il est encore des hommes qui, aujourd’hui, espèrent que si la coopération se généralisait, elle finirait par absorber le capitalisme. Il faut mettre en garde le prolétariat contre cette espérance irréalisable, et lui dire qu’il y a autre chose à faire de plus immédiat que la généralisation de la coopération, c’est la conquête du pouvoir politique pour la rentrée à la société des moyens de production. Il est plus facile de s’emparer des entreprises capitalistes que de créer d’autres entreprises destinées à les remplacer.
Lafargue a dit une grande vérité pour les travailleurs quand il a déclaré que « la coopération n’est pas le salut, n’est pas l’ange libérateur qui doit tirer la classe ouvrière de sa misère », et il a démontré, avec force, que jamais la coopération ne pourrait s’emparer de toute l’industrie :
« On peut dire aujourd’hui qu’il y a des branches de l’industrie absolument fermées à toute coopération, par exemple, l’industrie des transports : on ne peut rêver que jamais la classe ouvrière, à moins d’une révolution, pourra organiser des chemins de fer coopératifs. On peut encore citer la métallurgie, la raffinerie et une foule d’autres industries où les capitaux nécessaires sont si énormes que jamais la classe ouvrière ne pourra les amasser ».
Il faut aussi mettre en garde le prolétariat contre certaines conséquences qu’entraînerait – si elle était possible – la généralisation de la coopération. En créant de meilleures conditions de vie aux travailleurs, les coopératives multipliées permettraient aux capitalistes de diminuer les salaires, ceux-ci étant la représentation de ce qui est nécessaire à l’ouvrier pour vivre et se reproduire. Une autre cause de la diminution des salaires, ce serait la disparition – dans le commerce de détail, par exemple – des commerçants qui seraient obligés, pour vivre, de frapper à la porte des ateliers. Les patrons, se trouvant devant des forces de travail plus nombreuses, auraient toute facilité pour abaisser les salaires.
Quoique la coopération ne soit pas d’un usage capital pour la classe ouvrière, cette dernière peut, exceptionnellement, dans certaines conditions, s’en servir et remplacer les fins commerciales par des fins de propagande. La coopération, par elle-même, n’a pas de valeur socialiste : la preuve c’est qu’elle est employée par tous les adversaires du socialisme. Elle se meut, d’ailleurs, dans le milieu capitaliste et doit se soumettre à toutes ses exigences, vendre notamment, de plus en plus, à des non-adhérents.
La coopération ne vaut, pour les socialistes, que dans la mesure où elle se met au service de leurs idées. « La coopération, dit Bracke, n’est pas socialiste par elle-même, par son origine, par son essence, par son existence ; elle peut être une arme socialiste par son usage, c’est-à-dire en accroissant les moyens d’action du Parti Socialiste. »
La coopération ne prépare pas non plus les éléments de la société de demain, ces éléments étant depuis longtemps constitués par la société capitaliste. C’est ce qu’a affirmé Guesde, au Congrès du Parti socialiste de Paris, (juillet 1910).
« Impossible de reconnaître une valeur socialiste à la coopération en elle-même, qui ne prépare même pas les éléments de la société nouvelle, préparés qu’ils sont depuis longtemps, comme matériel et comme personnel, par la concentration capitaliste qui l’a précédée de beaucoup et dans des proportions que n’atteindra jamais la coopération. C’est parce que, précisément, grâce à cette concentration capitaliste, tout le travail est aujourd’hui, d’administration, de direction, d’exécution, le travail le plus scientifique comme le plus manuel, exécuté par des salariés, que nous pouvons passer du jour au lendemain, sans choc, de l’ordre actuel à l’ordre nouveau. Tout est prêt pour cette transformation ou révolution, parce que la propriété nominale des capitalistes d’aujourd’hui ne représente aucune espèce de travail, même directif, et qu’elle peut disparaître demain sans que rien soit touché ou entamé dans le fonctionnement des différentes genres de travail, usines, champs, chemins de fer, magasins. »
La coopération contient un danger qu’il faut signaler : des militants socialistes entrent dans les coopératives et cessent de se donner, comme ils le devraient, à la propagande socialiste. Ce danger, Guesde la fait également remarquer en ces termes :
« Quand des travailleurs d’élite consacrent leur intelligence à une coopérative, qu’ils n’ont en tête que des opérations commerciales (comment lui amener une clientèle, comment en assurer la prospérité et le développement), il n’y a ni place, dans ces cerveaux ainsi occupés, pour l’idée socialiste, ni temps pour l’éducation socialiste des masses, auxquelles on ne répétera jamais assez qu’il n’y a qu’un moyen de s’affranchir : c’est en prenant le pouvoir politique, et, en reprenant, à l’aide de ce pouvoir, la propriété capitaliste, industrielle et commerciale. Comme je l’écrivais un jour, la moutarde coopérative à débiter absorbe les meilleurs, ceux qui pourraient rendre à la propagande des services incalculables et qui, enfermés, confisqués, paralysés par une œuvre nécessairement commerciale, deviennent au contraire des pertes sèches pour le prolétariat aux luttes duquel ils ont été arrachés. »
Ainsi donc la coopération est une arme à deux tranchants : il faut savoir l’utiliser de manière à ce qu’elle ne blesse que l’ennemi.
Dictature du prolétariat. Le prolétariat ne prendra possession de l’Etat et ne le conservera que pendant le temps nécessaire pour faire rentrer l’humanité dans la possession des richesses sociales. La période pendant laquelle il en disposera constituera la dictature du prolétariat. « Entre la société capitaliste et la société communiste, se place la période de transformation révolutionnaire, le passage de l’une à l’autre. A cette période correspond aussi une période de transformation politique dans laquelle l’Etat ne peut être que la dictature du prolétariat » (Marx, Lettre sur le Programme de Gotha.) Quand on demandait à Engels ce qu’il entendait par dictature du prolétariat, il répondait en montrant la Commune de Paris. Rien de plus juste. Demain, comme en 1871, mais dans d’autres circonstances et avec d’autres buts, les prolétaires prendront l’Etat et s’en serviront pour échafauder la société nouvelle. Et tant qu’ils n’auront pas accompli leur mission, ils seront naturellement en état de dictature. Cette dictature sera plus ou moins longue, selon le développement économique de la société et selon que la bourgeoisie laissera passer le nouvel ordre de choses ou cherchera à s’y opposer.
A propos de la dictature du prolétariat, Charles Bonnier a publié dans le Socialiste du 10 janvier 1897, des remarques pleines de vérité et de précision :
« S’il est une nécessité qui ressort nettement de l’étude des faits, qui s’est imposée rigoureusement aux fondateurs du socialisme scientifique, c’est celle de la dictature du prolétariat. Beaucoup des mieux intentionnés parmi les militants socialistes, repoussent le mot, s’ils admettent la chose, prétendant que ce terme de dictature a pris dans notre histoire un sens d’accaparement et de violence. Il nous faut donc, ici, bien préciser ce qu’entendaient par dictature du prolétariat et Marx et Engels, qui créèrent le terme, et le Parti ouvrier français qui l’a inscrit sur son drapeau.
… Dictature veut dire gouvernement, plus ou moins prolongé, d’une partie de la société, d’une classe sur les autres classes, dans un moment précis où les lois ordinaires n’agissent plus.
… Quand nous parlons de dictature révolutionnaire, nous voulons simplement dire qu’il arrivera un moment où le prolétariat conscient de sa force (sous quelque forme que ce soit), et tant qu’il n’aura pas accompli sa mission, justifie sa raison d’être, sera en état de dictature. Ce n’est pas par libre choix qu’il en arrivera là, mais par nécessité historique.
… Ce qui le distinguera des autres gouvernements, ce ne sera pas sa prise de prise possession du pouvoir, mais la façon dont il exercera. Tandis que les autres gouvernements n’ont eu pour mission que de représenter et d’opprimer une classe, le prolétariat détruira les classes et les absorbera dans la collectivité. Mais pour ce faire, il faut que dans sa prise de possession de la dictature, et tant qu’il l’exercera, il soit distinct et personnel, séparé aussi bien de ses amis qui n’ont qu’une notion confuse de la nécessité de son rôle historique, et par suite, pourraient l’entraver, que de ses ennemis qui feront tous leurs efforts pour l’empêcher de le remplir. »
Etat. Les sociétés humaines ont traversé différentes périodes d’évolution, période sauvage, période barbare, avant de connaître ce qu’on est convenu de nommer pompeusement la civilisation. A chacune de ces périodes correspond un degré de développement particulier que caractérisent certaines mœurs, certaines lois ou coutumes, certaines manières de vivre, certaines institutions.
Les antagonismes de classes, qui troublent si profondément la période de la civilisation, furent ignorés des périodes sauvage et barbare. Cela a pour nous une importance considérable. Ce n’est qu’à la fin seulement de la période barbare, période de la formation de la civilisation, que les conditions d’existence des hommes ont subi des modifications profondes, dont nous ne connaissons que trop aujourd’hui les conséquences. Leur transformation eut pour résultat de créer des intérêts particuliers en désaccord avec les intérêts généraux de la collectivité. Elle se produisit avec la division de travail qui scinda la société en classes. Il s’éleva alors une organisation que nous appelons l’Etat, chargée de contenir les divisions qui venaient de naître, et d’empêcher qu’elles aboutissent à la ruine de la nouvelle société, du nouvel ordre social.
La division de la société en classes distinctes est une source continuelle et naturelle de conflits divers, de collisions et d’opposition de toutes sortes entre les classes. Aussi, il n’est pas douteux que la société se consumerait en luttes stériles et finirait par disparaître, s’il n’existait pas une puissance chargée, selon une expression consacrée, de maintenir l’ordre établi et de permettre à la classe privilégiée de dominer et d’exploiter les non-privilégiés, c’est-à-dire les travailleurs. Cette puissance, c’est l’Etat.
Quand on sait cela, il n’est pas difficile d’apporter une définition exacte et simple de l’Etat. L’Etat est une organisation que crée et que maintient la société humaine divisée en classes et dont dispose librement une classe pour tenir dans l’oppression et l’exploitation une autre classe. Ou encore : l’Etat est l’organisation des forces brutales et intellectuelles dont a besoin une classe pour maintenir une autre classe dans la soumission et l’exploitation.
« L’ensemble de la société civilisée, écrit Frédérick Engels, se résume dans l’Etat qui, dans toutes les périodes classiques modernes, est exclusivement l’Etat de la classe dirigeante et reste, dans tous les cas, une machine essentiellement destinée à tenir en respect la classe opprimée et exploitée. » (Origines de la Famille, de la Propriété privée et de l’Etat). Le grand écrivain complétait sa pensée en disant encore : « … l’Etat n’est pas autre chose qu’une machine d’oppression d’une classe par une autre classe, et cela, tout autant dans une République démocratique que dans une monarchie ; et le mieux qu’on en puisse dire, c’est qu’il est un fléau dont le prolétariat hérite dans sa lutte, pour arriver à sa domination de classe, mais dont il devra, comme a fait la Commune, et dans la mesure du possible, atténuer les plus fâcheux effets, jusqu’au jour où une génération, élevée dans une société d’hommes libres et égaux, pourra se débarrasser de tout fatras gouvernemental. » (Introduction à la Commune de Paris, par Karl Marx).
Pour les socialistes, l’Etat n’existe qu’à la condition que les classes existent. Ils reconnaissent que l’Etat est un produit naturel et fatal de la société parvenue à un certain développement économique, comme la propriété privée le commerce, la famille individuelle, etc., mais un produit qui, immédiatement créé, a d’autant plus affirmé son indépendance vis-à-vis de la société qu’il était, et est devenu de plus en plus l’instrument de domination, de règne, d’une classe déterminée. L’Etat n’est donc pas une institution existant depuis toujours, indépendamment de toute autre institution sociale, quels que soient les rapports sociaux, les relations des hommes entre eux, à travers les âges. Au contraire, c’est une institution subordonnée à l’existence des classes. Pas de classes, pas d’Etat.
Né avec les classes et du besoin de réfréner les conflits des classes, l’Etat a évolué avec les classes. Il a pu changer de formes et de mains, mais il a toujours rempli les mêmes fonctions. C’est parce qu’il y a toujours eu une classe dominée et une classe dominante, une majorité travailleuse et misérable et une minorité oisive et heureuse que l’Etat a persisté. La division de la société en classes antagonistes est la seule cause de la persistance de la durée de l’Etat. Trois phases – dont la dernière se termine – ont été parcourues par lui, correspondant aux trois servitudes que l’homme a connues : l’esclavage, le servage et le salariat. A chacune de ces phases, l’Etat a été le gardien sévère d’une servitude.
Dans toutes les nations, le droit de propriété a conféré la possession et l’usage de l’Etat. Si, avec l’introduction du suffrage universel, cette condition n’est plus exclusive, c’est parce que la classe possédante, pour des motifs à exposer, règne directement au moyen du suffrage universel. Dans la société antique, l’Etat était l’Etat des possesseurs d’esclaves, et il leur permettait d’exploiter ces derniers : dans la société féodale, il était l’Etat des seigneurs, des nobles, et il leur permettait d’exploiter les paysans et les serfs ; dans la société moderne, il est l’Etat des capitalistes, et il leur permet d’exploiter les salariés, les producteurs, mais, jamais, à aucune époque comme aujourd’hui, l’Etat n’a été, aux mains d’une classe, un aussi puissant instrument de domination et d’exploitation. Jamais le caractère de classe qui s’impose à tout Etat, à tout Etat moderne surtout, ne se remarque autant qu’avec l’Etat de la bourgeoisie.
Ce qui caractérise, représente ou constitue l’Etat moderne, en France, comme, avec quelques variantes, dans les autres nations capitalistes, ce sont d’abord les députés, les sénateurs, les ministres, le Président de la République, puis ensuite les impôts, l’armée, les fonctionnaires de tous ordres, les tribunaux, les prisons, les codes, les bourreaux, etc., en un mot tous les organes d’autorité, de domination et de répression dont dispose la classe possédante. Dans sa sphère respective, chacun de ces organes concourt à produire l’effet voulu par la classe dominante, c’est-à-dire sa suprématie sociale.
Des siècles ont été nécessaires pour la constitution de l’Etat moderne, du moins tel qu’il nous apparaît actuellement avec ses rouages façonnés d’après un plan systématique : Gouvernement, Parlement, fonctionnaires, armée, justice, etc. Il s’est modifié, complété, centralisé avec le temps et les nécessités de la production sociale.
Dirigé contre les travailleurs, l’Etat ne sera avec eux qu’autant qu’ils l’auront en leur possession. Espérer qu’il peut intercéder sérieusement en leur faveur sans être en leur possession, c’est se leurrer et méconnaître le caractère de classe de l’Etat. C’est parce que la possession de l’Etat, leur assure la disposition des forces oppressives et répressives qui s’appellent la magistrature, l’armée, et la police, etc., que les capitalistes ont la possibilité de pratiquer l’exploitation économique, inhérente à l’ordre social actuel, qui pèse sur les producteurs des villes et des campagnes.
Conséquence de la division de la société en classes, l’Etat ne pourra disparaître qu’avec la disparition des classes. Dès lors, il semble qu’il serait plus logique de s’en prendre directement aux classes plutôt qu’à l’Etat. Ce n’est, cependant, pas ainsi qu’il faut envisager la chose. Depuis que les classes existent, l’Etat constitue un abri, une garantie, une possibilité d’exploitation pour la classe privilégiée contre la classe déshéritée. Pour atteindre, pour entamer, pour blesser à mort, la classe capitaliste et supprimer ses privilèges économiques, il devient indispensable de lui enlever cet abri, cette garantie, cette possibilité d’exploitation, en un mot, de lui enlever l’Etat. A la classe capitaliste, l’Etat est aussi utile que des ailes à un oiseau. Sans Etat, la classe capitaliste ne pourrait continuer d’exister. L’Etat seul pourra modifier les rapports économiques dont les classes sont la personnification. L’Etat est appelé à contribuer à la disparition des classes pour et par lesquelles il a été créé.
Maître du pouvoir politique, le prolétariat fera rentrer dans le domaine de la nation – ou de la société – les moyens de production et la matière du travail. Par cela même, il détruit le caractère d’appropriation privée de ces derniers, et fait disparaître toute cause de division entre les membres de la société. Les classes disparaissent, parce qu’il n’y a plus d’intérêts particuliers à maintenir ; il n’y a plus que des hommes égaux, en droits et en devoirs.
Mais, si les classes disparaissent, l’Etat disparaîtra aussi. Organisation nécessaire dans une société divisée en classes, dans une société où la classe dominante doit maintenir par la force l’exploitation de la classe dominée, elle ne l’est plus dès qu’il n’y a plus de classes en présence. L’Etat devient inutile, il disparaît.
–Les données générales de cet article, je les ai prises dans mon livre : la Conquête socialiste du Pouvoir politique. Le lecteur voudra bien le consulter s’il veut des explications complémentaires. De même, je lui conseille de lire avec le plus grand intérêt l’ouvrage d’Engels : les Origines de la Famille, de la Propriété privée et de l’Etat.
Expropriation. En parlant de la transformation sociale à opérer, le Parti socialiste affirme son droit – qu’ont eu toutes les classes en travail d’affranchissement – à l’expropriation de la classe bourgeoise, devenue un obstacle au développement de l’humanité. Mais, en même temps, il ne cesse de déclarer que la question de l’expropriation avec ou sans indemnité est une question secondaire, puisqu’elle est une question d’application et dépend et des événements et des adversaires.
Il est absolument certain que, comme Marx le déclare dans une boutade de quelques lignes à laquelle on attache trop d’importance, que si la classe capitaliste prenait les devants et qu’avant d’être obligée de se démettre, elle proposait de se soumettre, il y aurait avantage pour le prolétariat à reconnaître ce bon mouvement qui lui ferait l’économie d’une révolution violente et à indemniser, dans une certaine mesure, les privilégiés renonçant ainsi à leurs privilèges.
C’est ainsi que dans le premier organe collectiviste français, dans l’Egalité, de 1880, Guesde lui-même exposait qu’il pouvait y avoir place pour une transaction, sur une base viagère, tout au moins pour les situations acquises.
L’on n’a donc pas tort de dire comment, en douceur, la propriété des moyens de production peut, de propriété privée, pour quelques-uns, devenir propriété sociale, pour tous. C’est une hypothèse qu’on peut admettre, se réalisant, avec le concours de la bourgeoisie, maîtresse du pouvoir et décidée à se suicider comme classe. Mais dans cette hypothèse, où trouver l’argent nécessaire pour indemniser la bourgeoisie ? Ce n’est pas dans les poches prolétariennes puisqu’elles sont vides ! Où donc alors ? Il faudrait avoir recours à l’impôt, ouvrir le Grand-Livre de la Dette publique pour y inscrire le compte de chaque capitaliste exproprié. Les travailleurs se trouveraient donc devant cette situation : ils seraient dépouillés par l’impôt au lieu de l’être par le salariat. La production continuerait, comme aujourd’hui, à être grevée au profit des mêmes oisifs.
Mais nous sommes obligés d’envisager une autre hypothèse, une hypothèse contraire et malheureusement beaucoup plus probable, c’est-à-dire le cas où, décidée à résister jusqu’au bout, la classe capitaliste se trouvera écrasée par l’effort victorieux de la classe-victime. C’est alors que l’expropriation pure et simple – c’est-à-dire la reprise par les volés de tout ce qui leur a été volé – s’imposera non seulement comme nécessaire, mais comme un acte justicier.
Les esclavagistes du Sud, écrasés par les armées fédérales du Nord, ont vu supprimer, sans indemnité, l’esclavage noir, pendant que les esclavagistes des Antilles françaises ont, sans résistance, laissé affranchir leurs noirs, et se sont vu indemniser par la République de 1848. Voilà un nouvel avertissement non plus théorique, mais historique, donné à nos esclavagistes de l’heure présente.
Comme on le voit – et nous tenons à le répéter – l’expropriation avec ou sans indemnité, dépend des événements et des adversaires. On peut placer la bourgeoisie devant l’expropriation s’opérant avec elle, avec son consentement – et le prolétariat pourra lui tenir compte du concours apporté par elle à la transformation sociale. Mais on peut aussi placer la bourgeoisie devant l’expropriation s’opérant contre elle, contre son consentement, ou en dehors d’elle – et alors le prolétariat tenant compte de sa mise en travers de la révolution émancipatrice, la traitera en conséquence.
Nous devons ajouter, que même sans indemnité, l’expropriation capitaliste poursuivie par le Parti socialiste, se trouvera être une expropriation avec indemnité. Ce sera même la première expropriation qui aura été indemnisatrice. On n’a pas indemnisé les propriétaires des métiers à tisser expropriés par le tissage mécanique. On n’a pas indemnisé les forgerons d’autrefois expropriés par les hauts-fourneaux. On n’a pas indemnisé les chiffonniers de Paris expropriés par les poubelles de la Préfecture de la Seine. On n’indemnise pas les petits boutiquiers, les petits commerçants expropriés chaque jour par le Louvre, le Bon-Marché ou Félix-Potin.
Contrairement à tous ces précédents, les capitalistes industriels et terriens expropriés par nous seront admis à la co-propriété des usines et du sol, au même titre – et aux mêmes conditions de travail – que les prolétaires expropriateurs.
Dans leur brochure, le Programme du Parti ouvrier, Jules Guesde et Paul Lafargue ont traité avec une précision remarquable cette question de l’expropriation. Ils ont écrit ces lignes que nous nous en voudrions de ne pas citer :
« Les révolutionnaires – car il y en a – qui évitent de prononcer le mot expropriation, pour ne pas effaroucher les masses, prétendent-ils, comme les socialistes qui ont peur de la chose et essaient de la remplacer par la concurrence communale ou par des services publics, n’ont pas vu ou voulu voir :
1° Que l’expropriation est la loi de toutes les transformations dans la société capitaliste ;
2° Que l’expropriation dont il s’agit est tous les jours rendue plus facile par le développement naturel et nécessaire de l’ordre actuel ;
3° Qu’elle sera seule compensatrice pour les expropriés ;
4° Qu’elle est imposée de plus en plus par les conditions de la production.
Le progrès industriel, qui est le Dieu du siècle, a eu pour effet d’exproprier les artisans d’autrefois, travaillant à domicile, pour leur compte, avec des outils leur appartenant :
1° De leurs instruments de travail, inutilisés entre leurs mains et transformés en bois à brûler (rouet, rabot, métier, etc.) ;
2° De leur habileté technique représentant des années d’apprentissage et annulée par la machine-outil ;
3° De leur foyer domestique vidé au profit des usines que peuplent la femme et l’enfant ;
4° Des fruits de leur travail, centralisés et encaissés sous le nom de profits ou de dividendes, par les employeurs individuels ou collectifs (patrons, actionnaires, obligataires, etc.).
Telle est la marche de la production moderne, qui ne bâtit que sur des ruines, la ruine des petits par les gros, et cela dans toutes les branches de l’activité humaine ; – la prospérité de magasins monstres comme le Louvre et le Bon Marché étant faite de la faillite de petites boutiques, comme le succès d’un Creusot ou d’un Fives-Lille est composé de la déconfiture de centaines de petites forges.
L’expropriation que réclame et poursuit le Parti ouvrier est, au contraire, celle des gros au profit des petits. C’est l’expropriation de la minorité spoliatrice au bénéfice de la majorité spoliée. C’est pour tout dire en un mot – l’expropriation des expropriateurs.
Les expropriateurs de la masse, qu’il s’agit simplement de faire restituer et dont le nombre va tous les jours se restreignant par la concurrence mortelle qui sévit entre eux, ont rendu plus que possible, facile la tâche du Parti ouvrier en se désintéressant de la production, à laquelle ils sont devenus aussi étrangers que le Grand-Turc.
Ce n’est pas eux qui dirigent cette dernière, mais une élite de salariés ; et leur dépression sera de nul effet sur les chemins de fer, les mines, les hauts-fourneaux, les raffineries, les filatures, les tissages, etc., qui continueront à fonctionner comme devant.
Cette expropriation, d’autre part, sera seule compensatrice. Toutes les autres, opérées jusqu’à présent, l’ont été sans indemnité aucune. Où est l’indemnité des tisseurs à la main expropriés par les tissages mécaniques ? où est l’indemnité des voituriers et camionneurs expropriés par les chemins de fer ? où l’indemnité des porteurs d’eau expropriés par les compagnies générales des eaux ? où l’indemnité des merciers, chemisiers, cordonniers, tapissiers, etc., expropriés par les bazars à la Boucicaut et à la Jaluzot ?
L’expropriation sociale sera marquée, elle, par une série de services réellement publics en faveur de l’enfance, de la vieillesse, et contre la maladie, etc., dont seront appelées à jouir comme les autres, ses victimes nominales, c’est-à-dire les ci-devant capitalistes, admis d’ailleurs à la co-propriété de l’ensemble des moyens de production et d’échange et à une part égale – à travail égal – dans les fruits de la production commune. »
Fédérés (Mur des). Mur près duquel furent fusillés les derniers communards par l’armée de Versailles, dans le cimetière du Père-Lachaise, le 28 mai 1871. Chaque année, depuis 1880, les socialistes se rendent au Mur pour rappeler les crimes de l’armée versaillaise et pour affirmer leurs espérances en la prochaine révolution sociale.
Grève générale. Le mouvement décisif pour la propagation de la grève générale a commencé en 1892. Ce sont des anarchistes qui l’ont inventé pour faire échec au socialisme et, de nos jours, ce sont encore les anarchistes qui s’en déclarent ses plus acharnés partisans. C’est au Congrès régional des syndicats qui se tint à Tours, en septembre 1892, que fut votée une résolution acclamant la grève générale. A ce moment, la grève générale était opposée à la révolution, et signifiait l’abandon du travail par tous les ouvriers des villes et des campagnes sans exception. Depuis, d’autres conceptions ont pris naissance, et l’on peut dire que la grève générale est un pavillon dont on ignore ce qu’il y a derrière.
Lancée contre le mouvement socialiste, la grève générale est représentée comme le seul, l’unique moyen dont dispose le prolétariat pour s’affranchir. Les adeptes de la grève générale pensent qu’en cessant tous de travailler, et en se croisant les bras, ils obtiendront toutes les satisfactions possibles. Cela veut dire, que les ouvriers quitteront le travail et ne le rependront que quand les patrons accepteront leurs revendications. Cela veut dire encore que les ouvriers après avoir quitté les usines – il faut bien sortir, autrement ce ne serait plus la grève générale – y rentreront pour en prendre possession. Ce n’est pas sérieux.
Pour que soit possible, la grève générale, il faudrait que les travailleurs soient tous organisés et unanimement consentants et participants à cette idée de chômage général. Or, cette organisation, ce concours unanime de tous les travailleurs, on ne les trouvera ni aujourd’hui, ni demain. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que si la grève générale était possible, les travailleurs, avant de reprendre les usines, trouveraient en face d’eux l’Etat avec toutes ses forces, toutes ses ressources. C’est contre lui qu’ils tourneraient alors leurs efforts. Ils seraient donc obligés de finir par où ils devraient commencer, prendre l’Etat, avant de tenter la reprise de la propriété capitaliste. Pourquoi donc ne pas la prendre dès aujourd’hui ?
D’autre part, la grève générale intéresse exclusivement les travailleurs et semble se résoudre en une lutte entre patrons et ouvriers. Au contraire, le socialisme apparaît comme une lutte contre les institutions qui ne répondent plus aux besoins et aux espérances des hommes. S’il intéresse tout d’abord les ouvriers, le socialisme intéresse également tous les autres membres de la société. Par cela même, le mouvement étroit de la grève générale, est destiné à échouer.
Grèves. Le Parti socialiste ne voit dans les grèves que des conflits qui naissent au sein de la société capitaliste, que des conséquences de la mauvaise organisation de la société. C’est parce qu’il y a des gens qui travaillent, et des gens qui ne travaillent pas, que des grèves éclatent mettant aux prises les uns et les autres pour le partage des produits du travail. Le socialisme ne pousse pas, ne provoque pas aux grèves, parce qu’il sait que, même victorieux, les grèves laissent les travailleurs dans leur misérable condition de salariés. Loin de nous, cependant, la pensée d’interdire la grève aux travailleurs. La grève est la seule arme dont ils disposent sur le terrain économique pour défendre leur pain quotidien, pour résister aux menaces, aux exigences patronales. Interdire les grèves, ce serait livrer les travailleurs au patronat, c’est ce que ne veulent pas les socialistes.
–La loi a reconnu le droit de grève, mais elle ne l’a pas organisé. C’est la raison pour laquelle Jules Guesde déposa, à la Chambre, le 8 février 1894, une proposition de loi tendant à organiser le droit de grève.
Insurrection. Depuis quelques années, on a beaucoup parlé de l’insurrection. Des membres du Parti socialiste ont préconisé ce moyen pour s’opposer à une déclaration de guerre. Au Congrès de Limoges, en 1906, et au Congrès de Nancy, en 1907, des discussions fort intéressantes se sont engagées à ce sujet. Guesde a démontré d’une part, que la guerre était un produit de la société capitaliste et qu’elle ne disparaîtrait qu’avec l’avènement du socialisme, et d’autre part, que le seul moment où il soit impossible de faire l’insurrection, c’est le moment où la guerre éclate.
L’insurrection, dans le pays où il y a le plus de socialistes, désorganise la défense au profit du pays où il y a le moins de socialistes, et ce qui serait assuré c’est l’écrasement des socialistes. A Limoges, Guesde disait :
« Lorsque j’entends parler d’insurrection à opposer à une guerre déclarée, moi qui, ne recherchant ni votes, ni applaudissements, n’ai jamais vu et ne verrai jamais de solution au problème social que dans l’insurrection, je dis que s’il y a un seul moment où elle est impossible, c’est lors d’une déclaration de guerre, lorsque le péril commun faire taire toutes les préoccupations. Elle est, en tous cas, bien plus possible en temps de paix. Et cette insurrection que le prolétariat ne fait pas pour la reprise des usines, des machines et autres moyens de production, que vous ne lui demandez pas alors qu’il lui suffirait de vouloir pour s’affranchir et affranchir l’humanité, vous lui en feriez un devoir seulement pour mettre sa peau à l’abri le jour de l’ouverture des hostilités ? Ce jour-là, il pourra bien y avoir des francs-fileurs, il n’y aura pas de révolutionnaires. »
Reprenant et complétant ses arguments, Guesde disait à Nancy :
« C’est contre la classe capitaliste, réfugiée dans l’Etat, c’est pour la prise de l’Etat, pour la transformation de la propriété, pour la Révolution sociale, que chaque travailleur doit devenir à l’occasion un insurgé, et pas quand il s’agira de sauver sa peau, de la mettre à l’abri des balles étrangères, en l’exposant aux balles françaises. »
Lafargue a condamné aussi l’insurrection. Voici ce qu’il disait à Nancy aux camarades qui recommandent ce moyen :
« Vaillant, qui recommande cette façon expéditive de procéder, nous rappelait tout à l’heure, la fureur patriotique qui, en 1870, s’empara de la foule à la nouvelle de la déclaration de la guerre : la main qui auparavant se tendait fraternellement pour serrer la main d’un allemand, se fermait pour frapper tout individu supposé d’origine germanique ; il est probable qu’une déclaration de guerre allumerait un semblable idiot enthousiasme : il serait alors ridicule et dangereux de prêcher l’insurrection. La foule imbécile se chargerait d’arrêter et de lyncher les avocats de l’insurrection. »
Nous partageons cet avis, estimant que la seule insurrection salutaire qui devrait toujours retenir les efforts ouvriers, c’est l’insurrection pour l’appropriation des moyens de production et d’échange.
Internationalisme. Pour les socialistes, l’internationalisme n’est pas autre chose que l’entente entre les travailleurs de partout pour tout ce qui touche les questions de travail. Il ne peut être confondu ni avec l’anti-patriotisme, ni avec l’anti-nationalisme. Tant que les patries, ou les nations, existeront, les travailleurs devront en tenir compte ; les travailleurs français, par exemple, défendront leur pays si son indépendance venait à être menacée, mais il leur est commandé de s’entendre avec les travailleurs des autres pays, soumis comme eux, à l’exploitation du capital.
L’internationalisme est un fait contre lequel viennent se briser toutes les critiques bourgeoises. De plus en plus les arts, les sciences, les capitaux, les relations, etc., prennent un caractère international. A l’internationalisme de la bourgeoisie, servant ses intérêts et ses espérances, devait répondre l’internationalisme des prolétaires connaissent les mêmes maux dans toutes les nations capitalistes et poursuivant la même libération dans toutes les nations capitalistes également (Voir Patriotisme).
Patrie. La bourgeoisie se sert de ce mot contre les socialistes. Expliquons-nous clairement. Les socialistes ne sont pas et ne peuvent pas être contre la patrie. La patrie est une étape dans le développement de l’humanité ; elle existe comme existent les classes et il faut en tenir compte. Le socialisme qui se met d’accord avec les faits ne peut donc pas ignorer la patrie. Le socialisme seul comprend la patrie dans son vrai sens et seul il peut se dire patriote. Il veut la grandeur de la patrie en la donnant à tous, en faisant de tous une famille vivant et jouissant de toutes les choses de la patrie. Nous savons que l’on prétend que les socialistes n’ont pas de patrie, ou combattent la patrie. C’est une erreur. Sans doute, si l’on envisage l’état de dépossession dans lequel se trouvent les travailleurs, ces derniers peuvent se croire des sans-patrie ; on leur a enlevé la patrie ; ils ne disposent de rien de ce qui, à leur yeux, représente la patrie : les usines, les terres, les chemins de fer, les magasins, en un mot les moyens de production et d’échange. Mais si l’on envisage l’état de possession dans lequel ils devraient être et dans lequel ils seront, les prolétaires ont une patrie. Les patrons disposent de leur patrie ; les prolétaires s’organisent pour la leur reprendre. Les socialistes sont patriotes parce que la patrie est à eux et qu’ils veulent en faire la chose de tous. Ils sont, d’ailleurs, en accord avec l’internationalisme. Ce n’est que dans la mesure où la patrie pour tous sera que l’internation sera possible. Se dire anti-patriote, ce serait se dire contre la patrie, contre la nation, contre les choses qu’elle contient et sont à nous. Nous ne pouvons pas dire que ce qu’elle contient n’est pas à nous. Nous sommes donc et pouvons nous dire de véritables avec-patrie.
A l’appui d’une campagne maladroite conte la patrie, des citoyens ont l’habitude de rappeler une parole de Marx et d’Engels. « Les ouvriers n’ont pas de patrie. » Cette parole est extraite du Manifeste du Parti Communiste et les citoyens dont nous parlons s’en servent comme d’une arme contre les socialistes qui se déclarent à la fois patriotes et internationalistes.
J’estime que cette arme a trop duré et que le moment est venu de la briser. Il est exact que Marx et Engels ont écrit : « Les ouvriers n’ont pas de patrie. » Mais ce qu’il faut qu’on sache, c’est que cette phrase était un argument de discussion et qu’elle visait exclusivement ce fait : l’état de dépossession de la patrie dans lequel se trouvent les ouvriers.
Marx et Engels constataient un fait, mais ils n’en concluaient pas que les ouvriers, n’ayant pas de patrie, ne pouvaient pas avoir de patrie ou devaient se désintéresser des choses de la patrie.
Dire, par exemple, que les ouvriers n’ont pas de propriété, cela ne veut pas dire qu’ils doivent ne pas en avoir ou qu’ils doivent l’ignorer. Dire que les ouvriers n’ont pas de patrie, cela ne veut pas dire non plus qu’ils n’ont pas à la connaître ou qu’ils ne la connaîtront pas.
Les auteurs du Manifeste ont employé cette phrase alors que, les prenant une à une, ils répondaient aux critiques adressées aux communistes par la bourgeoisie. Au reproche que l’on faisait aux communistes de poursuivre la destruction de la patrie, Marx et Engels en démontraient l’impossibilité en déclarant : « Les ouvriers n’ont pas de patrie. On ne peut leur ravir ce qu’ils n’ont pas. »
En écrivant ces lignes, ils reconnaissaient, comme nous le reconnaissons nous-mêmes, que les ouvriers n’ont entre les mains, rien de ce qui, pour eux, constitue la patrie, maisons, terres, fabriques, mines, chemins de fer, etc. Ils ne possèdent ni un pouce de territoire de la nation, ni une miette des richesses de la nation. Le sol, le sous-sol, le sursol, toutes les richesses, tous les produits du travail sont détenus par une poignée de capitalistes fainéants et criminels. Sans aucune propriété, les travailleurs peuvent se dire des sans-patrie. Dans ces conditions, comment s’y prendraient-ils pour détruire la patrie ?
Il faut avouer que si les travailleurs n’ont pas de patrie, c’est d’abord parce que les capitalistes leur ont prise ; c’est ensuite parce qu’ils n’ont pas encore su la reprendre. Les capitalistes actuels sont les mauvais dépositaires de la patrie. Les mines, les usines, les voies ferrées, les moyens de production et la matière du travail appartiennent réellement et légitiment aux ouvriers ; le jour où ils les reprendront aux capitalistes, ils rentreront, en même temps, en possession de la patrie.
Marx et Engels pouvaient et devaient constater que les ouvriers n’ont pas de patrie, mais ils ne la niaient pas. A ceux qui n’ont pas de patrie, ils furent les premiers à leur recommander de s’organiser et de lutter dans les limites de la patrie. Voici ce qu’ils écrivaient immédiatement après les phrases que nous avons rapportées : « Comme le prolétariat de chaque pays doit, en premier lieu, conquérir le pouvoir politique, s’ériger en classe maîtresse de la nation, il est par là national lui-même, quoique nullement dans le sens bourgeois ».
Et parcourant le Manifeste du Parti communiste, vous trouverez ces autres lignes : « La lutte du prolétariat contre la bourgeoisie, bien qu’elle ne soit pas au fond une lutte nationale, en revêt, cependant tout d’abord, la forme. Il va sans dire que le prolétariat de chaque pays doit en finir, avant tout, avec sa propre bourgeoisie. »
Les conditions de lutte et de triomphe imposent au prolétariat cette règle de conduite. Comme l’a dit Guesde, les prolétaires de France ne connaissent pas les capitalistes d’Allemagne, pas plus que les prolétaires d’Allemagne ne connaissent les capitalistes de France. Mais les prolétaires de France connaissent les capitalistes de France, comme les prolétaires d’Allemagne connaissent les capitalistes d’Allemagne, et ils doivent, les uns et les autres, dans leur propre pays, en finir avec leur propre bourgeoisie et faire aboutir la révolution sociale.
Des citoyens qui se servent de Marx et Engels sans les comprendre peuvent ne pas vouloir connaître la patrie : on ne peut oublier, cependant, que c’est dans ses limites que le prolétariat doit lutter et triompher. Le prolétariat peut d’autant moins ignorer la patrie qu’il sait que sa possession – c’est-à-dire la possession de toutes les richesses sociales – est la condition de son affranchissement.
Patriotisme. Il est de mode chez nos adversaires de traiter les socialistes d’anti-patriotes et d’internationalistes. Les socialistes n’acceptent pas cette façon de les juger. Ils sont à la fois patriotes et internationalistes et ils ne permettent à personne de douter des sentiments qu’ils expriment à l’égard de la France et de l’Humanité. La solidarité qu’ils ont avec les travailleurs de partout n’est point un acte contre leur patrie. L’internationalisme qu’ils pratiquent avec les seuls travailleurs de partout n’est ni l’abaissement, ni l’écrasement de leur patrie. La civilisation moderne a engendré des relations internationales qui se réalisent plus étroitement chaque jour, non au détriment, mais à l’avantage de la France. L’internationalisme est une condition – au bénéfice du capitalisme – du développement de la production et de l’échange. Notre misère et notre servitude existent dans toutes les patries, sont devenues internationales, et il serait incompréhensible que les socialistes de partout, ayant les mêmes maux et les mêmes espérances, ne se tendent pas la main par-dessus les frontières pour les faire disparaître. L’exploitation du travail ne connaît pas de frontières ; l’affranchissement du travail ne doit pas, ne peut pas les connaître non plus. Les patries sont des étapes dans le développement de l’Humanité. Les socialistes les reconnaissent et s’en servent ; ils veulent leur patrie respective agrandie, développée, devenue la chose, la propriété de tous et, par là, ils sont patriotes. Les socialistes de partout poursuivent l’affranchissement de leur patrie respective parce qu’ils savent que l’affranchissement des patries sera l’affranchissement de l’Humanité. Nous aimons et défendons notre patrie, mais nous ne haïssons pas et ne combattons pas les patries d’à côté où, comme chez nous, les travailleurs sont exploités et volés par le patronat international.
Pouvoirs publics (Conquête des). Par conquête des pouvoirs publics, du pouvoir politique, de l’Etat, le socialisme entend et a toujours entendu l’expropriation politique de la classe capitaliste – quelle que soit la forme sous laquelle s’accomplisse cette expropriation. Et comme par conquête, il est toujours entendu la pratique de la lutte de classe, cette expropriation ne laisse et ne peut laisser place qu’à l’occupation des seules fonctions électives dont le socialisme peut prendre possession au moyen de ses propres forces, c’est-à-dire des travailleurs constitués en parti de classe. Les fonctions ministérielles, qui ne sont pas électives, ne peuvent être conquises par le prolétariat, ne peuvent être occupées par lui. Il y a toujours eu, et il devait y avoir, une distinction, une séparation entre la partie des pouvoirs publics dont le prolétariat peut s’emparer avec ses propres forces, contre l’assentiment de la bourgeoisie, et la partie des pouvoirs publics dont le prolétariat ne peut s’emparer qu’avec le consentement de la bourgeoisie. Un siège législatif est du ressort des travailleurs ; un siège ministérielle ne l’est pas. On entre à la Chambre, au Sénat, voire dans une mairie, sous la poussée populaire, grâce au nombre, à l’organisation et aux bulletins de vote des travailleurs, en ennemis de classe, sur le terrain de classe, contre la bourgeoisie, tandis qu’on ne peut entrer dans un ministère qu’avec la bourgeoisie, qu’à la condition que la bourgeoisie vous ouvre la porte, dans la mesure où on peut et où on doit lui être utile. Conquérir une chose, c’est la prendre, c’est l’arracher des mains de qui la détient. De même, conquérir le pouvoir, c’est le prendre, c’est l’arracher à la bourgeoisie ; ce n’est pas en recevoir des miettes, en mendier un morceau. C’est donc contre la bourgeoisie, et non avec elle, que doit être conquis le pouvoir politique, que doivent être conquises toutes les fonctions électives. Telle a toujours été l’opinion du Parti socialiste depuis sa constitution au congrès de Marseille de 1879 et que des circonstances politiques obligèrent à confirmer dans des congrès ultérieurs, congrès national du Parti ouvrier français d’Epernay (août 1899), congrès des organisations socialistes françaises de Paris (décembre 1899), congrès socialistes internationaux de Paris (octobre 1900) et d’Amsterdam (août 1904).
Prolétariat, ensemble des prolétaires, des producteurs ne possédant que leur force de travail qu’ils sont obligés de mettre à la disposition des capitalistes.
L’étude des conditions économiques subies par les hommes, depuis plusieurs siècles, nous apprend que le rapport entre celui qui possède et celui qui ne possède pas n’a aucun fondement naturel. Comme le dit très bien Marx : « La nature ne produit pas d’un côté des possesseurs d’argent ou de marchandises, et de l’autre des possesseurs de leurs propres forces de travail, purement et simplement. » (Le Capital, 1er volume, p. 72).
Ce n’est pas non plus, comme on pourrait le supposer, un rapport commun à toutes les périodes de l’Histoire. Dans l’antiquité, au Moyen-Age, on ne connaissait pas de prolétariat, de classe ouvrière proprement dite, indépendante, ayant pour toute propriété sa force de travail, qu’elle ne peut utiliser elle-même et dont elle doit, pour vivre, céder l’usage aux capitalistes. Ce rapport est le résultat d’un développement historique, la conséquence d’une série de révolutions économiques issues de vieilles formes de production sociale, aujourd’hui disparues.
Pour que les travailleurs puissent disposer de leur personne, de leur force de travail, et vendre cette dernière comme je viens de le dire, n’ayant pas la possibilité de l’utiliser eux-mêmes, ou celle de vivre sans la faire utiliser par autrui, il a fallu qu’ils soient dépouillés de tous les moyens de production qu’ils possédaient et qui leur permettaient de vivre, et de toutes les autres garanties d’existence assurées par l’ancien ordre de choses, en dernier lieu par le régime féodal. Or, il faut malheureusement affirmer que « l’histoire de leur expropriation n’est pas matière à conjecture : elle est écrite dans les annales de l’humanité en lettres de sang et de feu indélébiles » (Le Capital, 1er volume, page 315).
La classe salariée, cette masse de prolétaires libres et légers comme l’air, a surgi dans la seconde moitié du XIVe siècle. Au début, les salariés étaient peu nombreux. Le travail salarié était l’occupation complémentaire, accessoire et transitoire. Les compagnons d’aujourd’hui étaient appelés à devenir les maîtres de demain, et ils étaient fortement protégés, à la campagne par l’existence des paysans libres, à la ville par l’organisation corporative. La subordination des serviteurs aux maîtres n’était que dans la forme, les uns et les autres étant, à cette époque, étroitement rapprochés.
Le milieu corporatif a fourni une partie des travailleurs salariés. La formation du prolétariat repose aussi sur d’autres origines. La guerre de Cent ans, par exemple, n’y est pas étrangère. Le travail s’était arrêté partout et une misère noire s’était étendue sur tout le territoire. Des bandes se formèrent d’aventuriers qui vécurent de vols, de rapines et de mendicité ; les villes et les campagnes incendiées, dévastées par cette guerre et celles qui suivirent, les champs rendus incultes en bien des endroits, en chassant les habitants de leur propre résidence, augmentèrent le nombre des mendiants, des voleurs et des vagabonds.
L’invention de la poudre à canon, mise au service de la royauté, en désorganisant l’institution féodale, eut une certaine répercussion sur la création du prolétariat. Les nobles, qui avaient perdu leurs fonctions sociales – la lance disparaissait devant l’artillerie – perdirent en même temps toute autorité. Les innombrables suites seigneuriales furent licenciées, et ce licenciement général multiplia les bandes d’inoccupés, de gens sans feu ni lieu, pour me servir d’une expression courante.
L’afflux, vers les villes, des paysans chassés des campagnes, par les impôts trop lourds pour les payer, les vexations et les oppressions de toutes sortes, et aussi par les progrès agricoles, transformant les champs en prairies ou nécessitant moins de bras pour la culture des terres, vint de son côté accroître le nombre des misérables et des prolétaires.
Le servage, lui-même, disparu presque partout à la fin du XVe siècle, aida ce mouvement. Les rachats et les affranchissements, s’ils furent un moyen de battre monnaie, d’avoir de l’argent pour les seigneurs, permirent, en même temps, de constater que le travail libre était plus productif que le travail servile.
Telles sont quelques causes historiques qui ont abouti à la création d’une classe salariée, qui mit à la disposition de la bourgeoisie naissante des milliers de bras disponibles, quand, au XVIe siècle, s’ouvrit l’ère capitaliste. En dehors du milieu corporatif, les bases du prolétariat furent le licenciement des suites seigneuriales et l’expropriation brutale de la population campagnarde.
Mais la formation des masses prolétariennes allait plus rapidement que leur absorption par les ateliers capitalistes. D’autre part, il n’était pas facile de plier à la discipline du nouvel ordre social les hommes arrachés à leurs habituelles conditions d’existence. Les capitalistes appelèrent à leur aide l’Etat. C’est alors qu’une législation monstrueuse, sanguinaire, s’abattit sur les expropriés pour les soustraire à la mendicité et au vagabondage et les réduire au travail. « Les pères de la classe ouvrière actuelle furent châtiés d’avoir été réduits à l’état de vagabonds et de pauvres. La législation les traita en criminels volontaires ; elle supposa qu’il dépendait de leur libre arbitre de continuer à travailler comme par le passé, et comme s’il n’était pas survenu aucun changement dans leur condition. » (Le Capital, 1er volume, p. 325).
Commencée avec l’ordonnance du roi Jean en 1350, cette législation se maintint, aggravée continuellement, jusqu’à la Révolution, jusqu’au triomphe de la classe bourgeoise dont elle servait les intérêts et les buts, et elle persiste encore de nos jours. Les producteurs, privés de leurs habituelles garanties d’existence, expropriés de leurs instruments de travail, furent impitoyablement condamnés en vertu de multiples ordonnances royales et de non moins multiples lois, à l’emprisonnement, au pilori, au fouet, à la marque au fer rouge, aux galères, à la potence, etc., afin de leur faire accepter le joug du capital.
Depuis, avec le développement du régime capitaliste, il s’est formé une classe de travailleurs de plus en plus nombreux que l’habitude, l’éducation, l’asservissement quotidien ont préparés à se courber sous toutes les exigences de ce régime, aussi facilement qu’ils changent de vêtement. Ceux-là sont expropriés des produits de leurs travaux, comme leurs ancêtres ont été expropriés de leurs moyens d’existence.
On le voit, l’histoire du prolétariat n’est pas une idylle, mais un sombre drame qui ne prendra fin que le jour où la société deviendra maîtresse d’elle-même.
Syndicalisme. Pour les socialistes, le syndicalisme n’est pas autre chose que l’organisation syndicale ou corporative de la classe ouvrière. C’est ainsi qu’on pourrait retrouver, sous la plume de Guesde, l’emploi de ce mot dans le Socialiste de 1893, et s’appliquant à cette organisation. Mais depuis quelques années, sous l’influence anarchiste, ce mot a subi une transformation : on lui donne un sens qu’il n’avait pas autrefois, et qu’il ne peut pas avoir, et une valeur d’affranchissement, comme le socialisme, auquel souvent certains l’opposent.
Ce qu’on appelle le syndicalisme est considéré par ses partisans comme une méthode d’expropriation de la classe capitaliste. Il existe même des partisans qui déclarent, audacieusement et inconsciemment, que c’est la seule méthode d’expropriation capitaliste.
Le syndicalisme est opposé au socialisme ; c’est une invention anarchiste que des socialistes ont acceptée. Cette opposition au socialisme aurait dû les mettre en garde, mais il n’en a rien été. Dans l’oubli de la réalité, l’on est allé plus loin. Les anarchistes et quelques-uns de nos camarades socialistes pensent que le syndicalisme et le socialisme poursuivent le même but tout en employant des moyens différents. Le socialisme, par exemple, veut conquérir l’Etat pour remettre aux travailleurs les moyens de production et d’échange ; le syndicalisme, au contraire, repousse la conquête de l’Etat. Cette manière de combattre aurait dû aussi empêcher les socialistes dont nous parlons d’adopter le syndicalisme, ou de lui être sympathiques.
En repoussant l’Etat, le syndicalisme est en désaccord avec l’histoire, avec les faits, avec le développement de la société capitaliste. Les classes, dans le passé, n’ont pu s’affranchir qu’en s’emparant de l’Etat ; le prolétariat lui-même devra suivre cet exemple. Comme l’enseigne le socialisme, il y a nécessité, pour qu’ils puissent aboutir, de transporter sur le terrain politique les antagonismes de classe qui éclatent sur le terrain économique.
Entre ouvriers et capitalistes existent des rapports économiques que conserve et que garantit l’Etat. Ces rapports ne peuvent être modifiés ou brisés que par l’Etat. Aussi est-ce méconnaître l’Etat et son rôle dans la société que de ne pas vouloir s’en servir, que de ne pas voir qu’il sert une classe, le patronat, contre une autre classe, le prolétariat.
En détournant le prolétariat de l’Etat, le syndicalisme le laisse entre les mains de la bourgeoisie dont il maintient et préserve l’exploitation et la domination. Parce qu’il rejette l’Etat, le syndicalisme est en opposition avec le socialisme et il ne peut être accepté par aucun socialiste.
C’est, d’autre part, une grosse erreur que de croire que le syndicalisme et le socialisme puisse avoir le même but. Le but du socialisme, c’est la socialisation des forces productives, la possession par la société, ou par la nation, des usines, mines, chemins de fer, etc. Dans cet ordre social, les usines, mines, chemins de fer, etc., appartiennent non seulement aux ouvriers qui y travaillent, mais aussi à tous les autres membres de la société. Le syndicalisme a-t-il cette conclusion ? Pour que les usines, mines, chemins de fer, etc., deviennent propriétés sociales, ou nationales, comme les routes, les musées, il faut une décision de la puissance publique, de l’Etat qui représente, aujourd’hui, la bourgeoisie, qui représentera, demain, le prolétariat.
Or, que ferait un jour de révolution, le syndicalisme, en admettant que l’Etat bourgeois ne se dresse pas contre lui ? Un syndicat mettrait la main sur une usine, un autre syndicat prendrait possession d’une mine. Et après ? La propriété de l’usine ou de la mine changerait simplement de mains. A la place de la propriété du patron, nous aurions la propriété du syndicat. Les luttes d’aujourd’hui entre capitalistes se reproduiraient demain entre syndicats. Le syndicalisme, s’il était possible, n’aboutirait qu’à la propriété du syndicat, ou de quelques-uns ; le socialisme, lui, aboutit à la propriété de la société, ou de tous.
La transformation sociale ne peut pas s’opérer, morceau par morceau, les prolétaires d’ici prenant une usine, les prolétaires de là-bas prenant une mine. Cette manière de procéder mettrait simplement des prolétaires, et non les prolétaires, en possession de l’usine ou de la mine. En matière de révolution, il y a une distinction à faire entre la reprise de l’usine par le syndicat qui n’est qu’une partie du prolétariat, et la reprise de l’usine par le prolétariat tout entier que peut représenter l’Etat, conquis et utilisé par lui.
Il faut ajouter que le syndicalisme est un mouvement étroit : il rapetisse et limite la révolution. Celle-ci ne doit pas se faire seulement au profit des ouvriers syndiqués ; elle soit se faire aussi pour ceux qui ne sont pas syndiqués, comme pour ceux qui ne peuvent pas l’être. Contrairement au syndicalisme, le socialisme veut la révolution pour tous les hommes, au profit de tous les hommes.
Le syndicalisme et le socialisme ont des moyens et un but différents, mais seul le socialisme affranchira le travail et l’humanité.
Syndicat, forme d’organisation de la classe ouvrière propre au milieu économique, qu’ont toujours préconisée les socialistes. Guesde a dit que l’organisation syndicale ou corporative s’imposant doublement :
1° Pour la défense du pain ouvrier, de la dignité ouvrière, qui échappe au travailleur isolé, que la faim livre sans résistance possible à toutes les caprices de l’employeur, les travailleurs associés étant seuls en mesure de substituer, à la vente individuelle et sans conditions de leur force du travail, des contrats collectifs réduisant la durée du travail et en augmentant le prix ;
2° Pour la préparation de la nouvelle société, de l’ordre socialiste, qui fonctionnera d’autant plus facilement, avec moins d’à-coups que, repris à leurs détenteurs oisifs et voleurs, les moyens de production pourront être remis à un prolétariat préalablement groupé, solidaire et habitué à l’action commune.
Le Syndicat forme d’organisation de la classe ouvrière, propre au milieu économique, est, en effet, une arme de groupement et de résistance qu’ont toujours recommandée les socialistes. L’organisation syndicale ou corporative est indispensable pour deux raisons principales surtout : elle arrache à l’isolement, c’est-à-dire à l’impuissance les ouvriers, et les met en mesure d’arracher des concessions au patronat et à l’Etat ; elle aide à la préparation de l’ordre social de demain qui fonctionnera plus facilement si les ouvriers sont plus groupés.
Pour les socialistes, le syndicat se compose de travailleurs exerçant la même profession, le même métier ; il ne groupe pas des travailleurs représentant la même opinion, mais il groupe des travailleurs partageant toutes les opinions politiques et philosophiques. Il faut être salarié pour entrer dans un syndicat ; il importe peu qu’on soit socialiste, radical, réactionnaire ou libertaire. Si l’on veut, d’ailleurs, aider au recrutement syndical et permettre aux syndiqués, en réalisant l’unité corporative, d’obtenir plus facilement des meilleures conditions de vie et de travail, il faut absolument laisser de côté toutes les opinions. Tout ce qui pourrait empêcher ou retarder le recrutement des syndiqués, tenir des travailleurs en dehors de l’organisation professionnelle, doit être écarté – sous peine d’aboutir à la constitution de syndicats concurrents.
D’où nécessité de ne pas distinguer entre les travailleurs d’un même métier, d’une même profession, tous ayant, en dépit des divergences d’opinions, les mêmes intérêts vis-à-vis de leurs patrons et, tous, devant et pouvant les défendre sur le terrain, le même terrain corporatif. C’est assez dire, que le mode de recrutement et le but du syndicat ne lui permettent pas de sortir des cadres de la société bourgeoise, de voir au delà de l’horizon professionnel et d’adhérer – parce que les contenant tous – à l’un quelconque des partis politiques.
Les militants anarchistes de la Confédération générale du travail propagent une autre conception, en matière syndicale, qu’il est nécessaire de faire connaître, parce qu’elle est contraire aux intérêts ouvriers. Ils prétendent, conformément aux statuts de la Confédération, grouper les travailleurs en dehors de toute école politique, en vue de la disparition du salariat et du patronat ; ils considèrent le syndicat comme l’arme, la seule arme d’affranchissement de la classe ouvrière. Quelle inconséquence et quelle contradiction ! Et combien de pareilles affirmations ou confusions doivent être relevées !
Adversaires et partisans de la société capitaliste se rencontrent dans le syndicat ; il est donc impossible de grouper, en vue de la disparition du patronat et du salariat, toutes les opinions qui vont du socialisme à la réaction, en passant par l’anarchie et le radicalisme. A la rigueur, on pourrait dans un syndicat réunir des travailleurs ayant la même opinion, mettons l’opinion socialiste, mais le syndicat prendrait alors la place du groupe politique chargé précisément de la représenter. D’une autre côté, si l’on groupe toutes les opinions, qui ne voit qu’il faut cesser de poursuivre l’abolition du salariat et du patronat et laisser cette tâche au socialisme ?
Il faut qu’on le sache bien : le premier but et essentiel du syndicat, et il ne peut y en avoir d’autre, est d’arracher les travailleurs à l’éparpillement, de remplacer la lutte individuelle, ou l’impuissance individuelle, par la lutte collective, ou la puissance collective, à l’effet d’arracher au patronat de meilleures conditions de vie et de travail. Propager comme le font les anarchistes de la Confédération générale du travail, le groupement de toutes les opinions pour la disparition du patronat et du salariat, ce n’est pas seulement chose impossible à réaliser, c’est vouloir prendre la place du Parti socialiste, faire de l’action politique au premier chef et pousser à la division ouvrière sur le terrain économique.
Encore une fois le syndicat n’est pas forcément et naturellement contre l’ordre capitaliste. Il ne défend que les intérêts corporatifs et ne s’occupe des intérêts ouvriers que dans la mesure où ils ne compromettent pas les intérêts bourgeois. Le Parti socialiste, au contraire, lutte pour le renversement de la société capitaliste ; il défend les intérêts ouvriers sans égard aux intérêts bourgeois.
J’ajoute que le syndicat ne peut être une arme d’affranchissement pour les raisons suivantes : 1° parce qu’il groupe toutes les opinions ; 2° parce qu’il ne comprendra jamais dans son sein tous les travailleurs ; 3° parce que si puissant qu’il puisse être, il lui manquera toujours l’Etat sans lequel les travailleurs ne pourront rentrer en possession des richesses sociales. C’est pourquoi les socialistes donnent avec raison aux travailleurs comme moyens indispensables de salut : l’organisation syndicale pour la sauvegarde de leur intérêts immédiate et l’organisation politique pour la prise de l’Etat et l’affranchissement du travail et de la société.
Temps de travail nécessaire. Pendant une partie de la journée de travail, l’ouvrier ne produit que la valeur de sa force de travail. il n’y a donc, dans cette opération, qu’une simple reproduction de valeur. La partie de la journée pendant laquelle s’accomplit cette reproduction est appelée par Marx, Temps de travail nécessaire ; le travail dépensé au cours de ce temps de travail nécessaire est appelé par Marx, Travail nécessaire. « Je nomme donc temps de travail nécessaire, la partie de la journée où cette reproduction s’accomplit, et travail nécessaire, le travail dépensé pendant ce temps, nécessaire pour le travailleur, parce qu’il est indépendant de la forme sociale de son travail, le capital et le monde capitaliste, parce que ce monde a pour base l’existence du travailleur. » (Le Capital, 1er vol., page 93).
Temps extra, expression de Marx pour désigner le temps de travail qui dépasse le temps de travail nécessaire à la reproduction de la valeur de la force de travail.

























































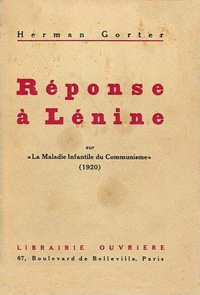

















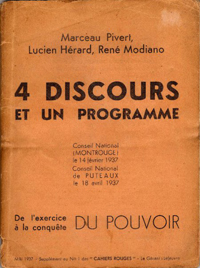



 Brochure sur l'assassinat d'A. Nin
Brochure sur l'assassinat d'A. Nin 
 Numéros de L'Insurgé de 1942 et 1943
Numéros de L'Insurgé de 1942 et 1943


 Brochure Spartacus
Brochure Spartacus


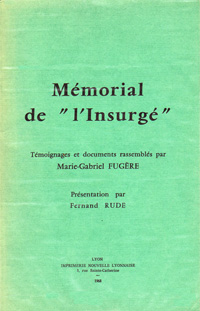 Mémorial de
Mémorial de 





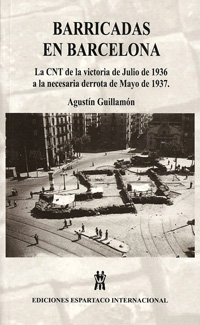


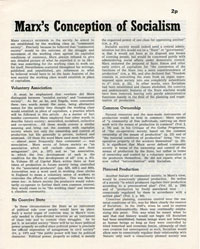













 page
page






Vous devez être connecté pour poster un commentaire.