Livre en anglais de Maximilien Rubel (140 pages) téléchargeable au format pdf:
Posts Tagged ‘Maximilien Rubel’
Marx : Life and Works (Rubel, 1965)
19 mars 2016La charte de la Première Internationale [2] (Rubel, 1965)
14 mars 2014(Suite et fin)
UN « MARXISME » DE COULISSE
Efficacité et anonymat, telle semble être jusqu’à la Conférence de Londres la devise de Marx, membre du Conseil général et secrétaire – correspondant pour l’Allemagne. Si les ouvriers et artisans, partenaires de Marx au Conseil, ont accepté de bonne grâce les services « littéraires » de l’intellectuel érudit, c’est que celui-ci possédait le talent de rendre aux proclamations de l’organe exécutif de l’Internationale le ton de dignité et d’énergie qui sont la marque de documents lancés au nom d’un mouvement historique (25). Lorsque tel membre intellectuel du Conseil soutient, dans une Adresse sur la Pologne, des thèses contraires à la vérité historique, Marx ne se contente pas de quelques objections improvisées, mais il prépare pour le Conseil un cours d’histoire diplomatique pour démontrer que de Louis XV à Napoléon III la politique étrangère de la France n’a été favorable ni à la restauration ni à l’indépendance de la Pologne. La démonstration est scientifique, et c’est comme telle que Marx l’entendait — en même temps qu’il la considérait comme un acte politique (26).
De même, pour défendre le mouvement syndical et en définir l’objectif révolutionnaire, Marx a fait, devant le Conseil, un cours d’économie politique dont les conclusions esquissent la charte du syndicalisme révolutionnaire. Quand on sait qu’il y a résumé le contenu théorique du Capital, on peut s’étonner du peu de publicité que ces exposés ont reçu à l’époque, et que la rumeur n’en soit pas parvenue aux Congrès de l’Internationale. Il est vrai que Marx lui-même ne se montrait pas empressé de les rendre publics, puisqu’il prévoyait alors la sortie prochaine de son ouvrage. Jusqu’à la Conférence de Londres de 1871, Marx, comme il le disait lui-même, travaillait « dans les coulisses » (27), ne s’affichant jamais publiquement, ne sortant de l’anonymat que contraint par les circonstances, comme ce fut le cas après la publication de l’Adresse sur la Commune. On pourrait donner plusieurs explications à cette attitude, et d’abord le fait que, apatride réfugié à Londres, il ne tenait pas a attirer sur lui l’attention des autorités britanniques. Mais on peut penser surtout que, nullement disposé à prendre des allures de tribun et se faisant une idée très particulière de son rôle d’homme de parti et de communiste, il s’efforçait de ne pas s’afficher comme auteur des manifestes qu’il acceptait de rédiger à la demande et au nom du Conseil général. Il se considérait comme le porte-voix anonyme et non comme le chef charismatique du « mouvement réel » (28). Nul doute que dans ce qu’il croyait connaître des aspirations profondes des travailleurs, on retrouve, à côté de jugements fondés sur l’observation et l’étude du développement économique et politique de l’Europe depuis 1848, des jugements de valeur conformes à la vision générale qu’il avait de ce développement et de ses perspectives d’avenir, vision définie par l’article 1 des Statuts qui pose le but de l’Internationale : « Le concours mutuel, le progrès et le complet affranchissement de la classe ouvrière ».
Dans presque tous les textes internationaux dont il est établi que Marx est l’auteur, on retrouve ce double souci de l’observation documentée et de l’évaluation en perspective, en un mot le souci de l’éducateur politique pour qui il est essentiel de lier la lutte momentanée à la conscience d’une finalité révolutionnaire. Le principe de l’autoémancipation, énoncé en tête du préambule des statuts, interdit à l’intellectuel prêt à lutter dans les rangs de la classe ouvrière de se livrer à une autre activité que l’éducation politique au sens le plus universel du terme : compréhension de la société existante et aspiration à l’émancipation complète.
Cette double démarche est visible dans le travail que Marx consacre à la préparation de la Conférence de Londres (septembre 1865) et du Congrès de Genève (septembre 1866). C’est lui qui, au nom du Comité permanent, recommande au Conseil central (31 juillet 1865) l’adoption du programme établi par la section parisienne, non sans y ajouter une question qu’il estime urgente dans la situation politique d’une Europe soumise à l’influence de la diplomatie tsariste. Or, c’est sur cette question que le Congrès de 1866 marquera une nette opposition au « marxisme » du Conseil de Londres en refusant, selon la formule de la délégation française, de voir l’Internationale imiter « la vieille politique qui oppose les peuples les uns aux autres », l’émancipation sociale de la Russie étant tout aussi souhaitable que celle de la Pologne (29).
C’est à ce même Congrès que le nom de Marx fut prononcé pour la première fois devant le forum de l’Internationale. Lors de la discussion de l’article 11 des Règlements spéciaux (« Chaque membre de l’Association a le droit de participer au vote et d’être élu »), Tolain insista pour que la fonction de délégué fût réservée exclusivement aux travailleurs ; Perrachon renchérit en disant que « ce serait vouloir la perte de l’Association que d’admettre comme délégué un citoyen qui ne serait pas ouvrier » (30).
Dans la discussion qui suivit, deux membres influents du Conseil général, Cremer et Carter, évoquèrent la figure de Marx : pour Cremer, sans le dévouement de certains citoyens exerçant des métiers intellectuels, « l’Association n’aurait pu s’implanter en Angleterre d’une façon aussi complète. Parmi ces membres, je vous citerai un seul, le citoyen Marx, qui a consacré toute sa vie au triomphe de la classe ouvrière » ; Carter signala que Marx avait refusé au Conseil d’être délégué à ce premier Congrès dont il avait « parfaitement compris l’importance » et « où seulement devaient se trouver des délégués ouvriers ». Marx n’aurait pas protesté en écoutant Tolain : « Comme ouvrier, je remercie le citoyen Marx de n’avoir pas accepté la délégation qu’on lui offrait. En faisant cela, le citoyen Marx a montré que les congrès ouvriers devaient être seulement composés d’ouvriers manuels. Si ici nous admettons des hommes appartenant à d’autres classes, on ne manquera pas de dire que le congrès ne représente pas des aspirations des classes ouvrières, qu’il n’est pas fait pour des travailleurs, et je crois qu’il est utile de montrer au monde que nous sommes assez avancés pour pouvoir agir par nous-mêmes » (31).
C’était comme un écho du débat soutenu en février et en mars 1865 devant le Conseil central pour arbitrer le conflit qui déchirait la section parisienne où les « manuels » comme Tolain, Fribourg et Limousin s’opposaient aux « intellectuels » tels que Lefort et Le Lubez, querelles qui donnèrent l’impression que « les Français avaient réellement besoin d’un Bonaparte ! » (32).
Un épisode important de l’activité du Conseil général caractérise parfaitement le rôle politique que, selon Marx, l’organe exécutif de l’Internationale était appelé à jouer en Angleterre, où un prolétariat industriel numériquement puissant, mais dépossédé de ses droits politiques pouvait, en assumant l’héritage du chartisme, réaliser sa mission révolutionnaire : le déclenchement, au début de 1865, par la bourgeoisie radicale, du mouvement pour la deuxième réforme. Ce mouvement aboutira, en 1867, après deux années de luttes dans lesquelles des masses ouvrières seront entraînées par les dirigeants trade-unionistes à un élargissement relativement peu important du droit de vote. Bien que Marx ait été trompé dans ses espoirs — la revendication chartiste du suffrage universel n’a nullement été reprise par la Reform League — il écrira encore en 1870 : « Les Anglais ont toute la matière nécessaire à la révolution sociale. Ce qui leur manque, c’est l’esprit généralisateur et la passion révolutionnaire » (33). C’est le Conseil général qui, aux yeux de Marx, avait la vocation d’ « accélérer » le mouvement révolutionnaire dans le pays qui remplissait mieux que tout autre les conditions sociales d’une lutte décisive entre le travail et le capital.
UNE CHARTE POLITIQUE.
En rédigeant les résolutions du Conseil, Marx cherche à obtenir l’accord unanime de ceux qui seront délégués aux Congrès. On peut donc s’étonner de ce que, malgré la presque unanimité sur les questions soumises aux voix, des conflits de tendances aient pu surgir, notamment sur les fonctions du Conseil général dont les statuts font l’organe d’exécution de l’Internationale. Le « marxisme » que l’on pourrait constater dans l’Internationale ne se trouve dans les textes rédigés par Marx que dans l’exacte mesure où il se trouve dans la mentalité des divers groupes adhérents, quelque contradictoires qu’eussent été leurs idéologies respectives. Et si des ambiguïtés marquent certaines démarches intellectuelles de Marx, elles ont leur source dans les désaccords fondamentaux dans les rangs des adhérents. L’exemple typique nous est fourni par le conflit qui finira par diviser les sections de l’A.I.T. en « autoritaires » et en « antiautoritaires », termes chargés d’affectivité qui dissimulent une opposition facile à définir : elle séparait ceux pour qui le « moyen politique », posé dans la charte de 1864, devait être une arme décisive dans les futures luttes et ceux qui cherchaient cette arme dans d’autres formes de lutte, telles que les institutions d’entraide (caisses de secours, banques populaires, etc.). Or, ce « moyen politique » est ouvertement ou tacitement reconnu aux Congrès de Genève, de Lausanne, de Bruxelles et de Bâle. Il est inconcevable que les délégués de Genève par exemple, aient voté sans réfléchir la résolution proposée par le Conseil sur l’instruction et le travail des jeunes. Le « marxisme », c’est-à-dire le style de Marx y est pourtant manifeste : « […] la partie la plus éclairée des masses ouvrières comprend pleinement que l’avenir de leur classe, et par conséquent de l’espèce humaine, dépend de la formation de la génération ouvrière qui grandit […]. Ceci peut seulement être accompli par la transformation de la raison sociale en force sociale et, dans les circonstances présentes, nous ne pouvons faire ceci que par des lois générales mises en vigueur par le pouvoir de l’État.
En créant de telles lois, les classes ouvrières ne fortifieront pas le pouvoir gouvernemental, de même qu’il y a des lois pour défendre les privilèges de la propriété, pourquoi n’en existerait-il pas pour en empêcher les abus ? Au contraire, ces lois transformeraient le pouvoir dirigé contre elles en leur propre agent. Le prolétariat fera alors par une mesure générale ce qu’il essaierait en vain d’accomplir par une multitude d’efforts individuels » (34).
C’est là, pourrait-on dire, une interprétation dialectique ou plutôt révolutionnaire du réformisme. Ce réformisme n’a pas été rejeté à Genève et il ne sera pas rejeté ouvertement dans les congrès postérieurs. Est-ce parce que les internationaux, quelles que fussent leurs tendances et leurs sympathies doctrinales, ont saisi la force dialectique de l’argument marxien telle qu’elle s’exprimait dans les passages du rapport sur le travail coopératif, dont voici le début : « L’œuvre de l’Association internationale est de combiner, de généraliser et de donner de l’uniformité aux mouvements spontanés des classes ouvrières, mais non de les diriger ou de leur imposer n’importe quel système doctrinaire.
Par conséquent, le Congrès ne doit pas proclamer un système spécial de coopération, mais doit se limiter à renonciation de quelques principes généraux » (35). Et la suite du même texte est d’une logique évidente, à tel point que son acceptation unanime équivalait à une « capitulation » totale devant le « communisme autoritaire » : « Mais le mouvement coopératif […] est impuissant à transformer par lui-même la société capitaliste. […] Les changements des conditions générales de la société ne seront jamais réalisés sans l’emploi des forces organisées de la société. Donc le pouvoir gouvernemental, arraché des mains des capitalistes et des propriétaires fonciers, doit être manié par les classes ouvrières elles-mêmes » (36).
Sans que le mot y soit prononcé, on devine ici l’idée de la dictature du prolétariat dont Marx verra l’image vivante dans la Commune de 1871— comme étape du développement devant conduire à la société libérée de l’État et du capital. L’argument sociologique se dégage des thèses relatives aux syndicats : à la force sociale concentrée représentée par le capital, les travailleurs peuvent opposer leur propre pouvoir social qui est dans leur masse humaine, à condition qu’elle ait conscience de sa « grande mission historique ». Ainsi le postulat de l’ « émancipation radicale » vient se greffer sur les efforts spontanés des trade unions que Marx invite à « aider tout mouvement social et politique qui tend dans cette direction » (37).
Aucune de ces thèses, aucun de ces postulats ne seront jamais contestés, même dans les moments les plus critiques de la lutte intestine que se livreront les « antiautoritaires » et les « autoritaires » (38). Que, dans ce conflit, des antipathies personnelles, voire des phobies profondes — on a dit raciales (39) — aient faussé les jugements des antagonistes est aussi certain que le fait qu’à travers les positions de Marx et de Bakounine s’affrontent deux conceptions et deux méthodes foncièrement inconciliables de la lutte ouvrière. Le passage de l’action isolée, dispersée, sporadique, explosive, voire conspiratrice, à la lutte massive, coordonnée, consciente, organisée à la fois dans les syndicats et dans les partis ouvriers, telles étaient la conception et la méthode définies par la charte de 1864 et constamment affirmées et confirmées — explicitement ou implicitement — dans les congrès. Marx y voyait le sens même du mouvement ouvrier moderne, comme l’y voyaient, d’ailleurs, les « collectivistes », dont l’accord avec les « communistes » était, au demeurant, total sur une question aussi fondamentale que la nationalisation de la terre (40). Quant à Bakounine, il eut l’honnêteté de proclamer sans cesse la justesse des fondements théoriques tels que Marx les avait élaborés avec l’idée d’enrichir et de renforcer la conscience révolutionnaire que les travailleurs devaient prendre des mobiles et des objectifs de leur mouvement d’émancipation. Si Bakounine se refusait à tirer de l’enseignement théorique dont il se reconnaissait le disciple les conclusions politiques que Marx estimait les seules efficaces dans les conditions générales de l’époque, ce n’était pas parce qu’il pouvait opposer à Marx une conception théoriquement mieux fondée des méthodes et des perspectives révolutionnaires, mais parce qu’il était incapable de trahir sa vocation romantique qui faisait de lui un conspirateur professionnel. Que, dans ses critiques d’un certain comportement de Marx et de ses disciples, Bakounine ait anticipé sur les accusations qu’on a pu porter, dans notre temps, contre les méthodes d’action et les attitudes intellectuelles se réclamant du marxisme, n’est nullement un argument contre la validité normative de l’enseignement révolutionnaire qui est un élément constitutif de la sociologie « matérialiste » de Marx. Le triomphe du marxisme signifie le triomphe d’une idéologie politique qui se réclame, certes, de l’enseignement de Marx, mais cette idéologie ne saurait échapper à l’action démystificatrice d’une sociologie qui, la première, a élevé la critique sociale à la hauteur d’une science. En faisant passer le postulat de la conquête du pouvoir politique de l’Adresse inaugurale dans les statuts, Marx a insufflé à la charte de l’Internationale ouvrière un esprit de critique qui ne reste pas désarmé devant les idéologies politiques de notre temps, qu’elles soient « marxistes » ou non : « Les seigneurs de la terre et du capital se servant toujours de leurs privilèges politiques pour défendre et perpétuer leurs monopoles économiques et asservir le travail, la conquête du pouvoir politique devient le grand devoir du prolétariat » (41).
Finalement il apparaît que l’Internationale a été plus féconde par ses visées d’avenir telles qu’elles s’exprimaient dans la discussions et les affrontements intellectuels et idéologiques, que par ses résultats pratiques. Et si le centenaire de son avènement est marqué par une littérature si abondante et si variée, si les travaux scientifiques y figurent aux côtés de publications qui relèvent de la propagande politique, c’est que la première Internationale ouvrière exerce sur la pensée sociale de notre temps plus d’ascendant par ce qu’elle a voulu réaliser et atteindre que par les résultats qu’elle a obtenus. Le rôle historique de l’Internationale est tout autant dans son action que dans sa signification, et plus encore dans ses anticipations que dans ses réalisations.
Or, c’est précisément cette dimension intellectuelle de l’A.I.T. qui a donné lieu aux spéculations les plus hasardeuses. L’atmosphère de suspicion et de peur dans laquelle elle a évolué semble lui avoir survécu et entrave encore, malgré le recul de cent ans, la poursuite méthodique des recherches historiques et sociologiques sur les mentalités individuelles et collectives qui ont fait la richesse durable de l’Internationale.
La signification historique de l’Internationale dépasse, par conséquent, les dimensions temporelles et spatiales de son existence réelle. Par la charte qu’elle s’est donnée, elle vise la réalité du mouvement ouvrier tel qu’il se présentera à partir de 1880, quand commencera ce que l’on a appelé l’ « âge d’or » du capitalisme. L’Internationale est le carrefour intellectuel où viennent déboucher les courants du passé et d’où rayonnent les avenues de l’avenir. Le rôle de Marx a consisté à énoncer dans la charte de l’Internationale les principes du mouvement politique de l’avenir, en renouvelant pour la classe ouvrière l’esprit et le sens de l’action politique et en en définissant la finalité révolutionnaire : la transformation totale des structures économiques et politiques, matérielles et morales de la cité. L’Adresse Inaugurale et les statuts de 1864 expriment en une synthèse magistrale la tendance et le sens du mouvement du siècle à venir. L’Adresse sur la Commune amplifie la projection visionnaire des textes antérieurs. C’est donc dans leur totalité que les proclamations du Conseil général rédigées par Marx avec le seul souci de porter au nom du « mouvement réel », constituent la charte de l’Internationale. Seul le besoin de mythologie — sinon de mystification — a pu inciter à voir dans cette charte le fruit du « marxisme », autrement dit d’une doctrine toute faite, imposée du dehors par un cerveau omniscient à une masse amorphe et inerte d’hommes en quête d’une panacée sociale (42).
Grâce à Marx, les idées sociales et révolutionnaires, diffuses et éparses dans les productions littéraires et les expériences sectaires disparates qui jalonnent l’essor parallèle de l’industrie et du mouvement ouvrier européen tout au long de la première moitié du XIXe siècle et au-delà, s’harmonisent et se cristallisent en une théorie sociale et politique épurée, sinon entièrement, du moins principalement des scories utopiques héritées du passé. Le rêve et l’utopie sont pour ainsi dire sublimés en une idée-force révolutionnaire portée par un mouvement de masse ayant des objectifs politiques et économiques bien déterminés. Telle est la signification profonde de la charte de l’Internationale qui exprime l’esprit d’un mouvement social plutôt que le génie d’un chef politique.
Notes:
(25) A propos de l’Adresse à Lincoln, Marx écrit à Engels le 2 déc. 1864 : « Ce fut à moi d’écrire la chose (ce qui est beaucoup plus difficile qu’un travail substantiel), afin que la phraséologie, à quoi se réduit ce genre d’exercice littéraire, se distingue tout au moins de la vulgaire phraséologie démocratique. »
(26) Aussitôt après l’insurrection de 1863, Marx s’était mis à étudier l’histoire des partages de la Pologne. Voir son manuscrit « La Pologne et la France » (probablement la réponse à P. Fox-Andrée), dans Karl Marx, Die polnische Frage, herausgegeben und eingeleitet von Werner Conze und Dieter Hertz-Eichenrode, La Haye, Mouton et Co, 1961. C’est à la demande de Marx qu’Engels écrivit pour le Commonwealth (mars-mai 1866) les articles What have the working classes to do with Poland ?
(27) Marx à Engels, 7 juillet 1866, à Kugelmann, 9 oct. 1866.
(28) Jusqu’à la Conférence de 1871, les comptes rendus des Congrès de l’A.I.T. font très rarement mention de Marx et de son activité au Conseil général. La première allusion au Capital figure au compte rendu du Congrès de Bruxelles ; elle fut faite par Lessner dans la discussion du rapport sur les effets des machines (cf. La Première Internationale, l.c, t. I, p. 297.) A une autre séance, Moses Hess fit état, à propos du rapport soumis par les proudhoniens sur le crédit gratuit, des idées exprimées par Marx dans Misère de la Philosophie (1847), mais son intervention tomba à plat. Alors que les oeuvres de Proudhon firent largement les frais des débats à ce Congrès, ce n’est que dans une séance administrative qu’une résolution sera votée par les délégués allemands recommandant la lecture du Capital « aux hommes de toutes les nationalités » et sa traduction « dans les langues dans lesquelles il ne l’est pas encore ». Marx y est déclaré « le premier économiste qui a scientifiquement analysé le capital ». Ibid., p. 430. — Notons encore
que Marx s’abstint, à la Conférence de 1865, de donner lecture du rapport sur l’Allemagne que lui avait envoyé Liebknecht, parce que celui-ci l’y avait « mis trop en vedette ». Cf. Marx à Liebknecht, 21 nov. 1865. Voir ce rapport dans Minutes, l.c, p. 251-260.
(29) Voir le programme français (signé par Fribourg et Limousin) dans la brochure publiée par la section de Paris en octobre 1865 ; réimprimée dans La Première Internationale, l.c, p. 18-19. Quant à la résolution, inspirée par Marx et Bobczynski, dénonçant le « despotisme russe en Europe », elle rencontra d’abord la résistance de Le Lubez, Weston et De Paepe à la Conférence de 1865, et elle fut ensuite rejetée au Congrès de Genève sur l’insistance des délégués français. Cf. La Première Internationale, l.c, t. I, p. 78 sq. Riazanov a trouvé peu… « marxiste » la position antirusse de Marx condamnant « un peuple tout entier au nom de l’A.I.T. ». Cf. son article « Die auswärtige Politik der alten Internationale und ihre Stellungnahme zum Krieg, III », Die Neue Zeit, 18 juin 1915. Ne pourrait-on pas plutôt affirmer que, par sa russophobie, Marx s’éloignait en fait de sa théorie et de son éthique révolutionnaire pour tomber dans ce sectarisme marxiste qui prendra beaucoup plus tard une forme caricaturale chez la plupart de ses disciples ?
(30) Cf. La Première Internationale, l.c, t. I, p. 55.
(31) Ibid., p. 55 sq. Sur son refus d’aller à Genève, Marx écrivit à Kugelmann : « Je pense que, par mon oeuvre, je fais beaucoup plus pour la classe ouvrière que tout ce que je pourrais faire personnellement à un congrès quelconque » (23 août 1866). Cette oeuvre, Marx la considérait comme le fruit du mouvement ouvrier et donc, en quelque sorte, de l’Internationale : « L’A.I.T. n’est fille ni d’une secte, ni d’une théorie. Elle est le produit spontané du mouvement prolétaire, engendré lui-même par les tendances naturelles et irrépressibles de la société moderne » (Rapport du Conseil général au Congrès de Bruxelles, 1868). Tout au plus la théorie pouvait-elle, selon Marx, hâter ce mouvement en aidant les travailleurs dans leurs efforts autoéducatifs. « Pour la victoire ultime des principes énoncés dans le Manifeste, Marx se fiait uniquement au développement intellectuel de la classe ouvrière, tel qu’il devait résulter nécessairement de l’action et de la discussion communes ». (Engels, Préface à l’édition allemande du Manifeste communiste, 1890).
(32) Marx à Engels, 13 mars 1865. Il avait déjà blâmé les Français pour leur obstination à sous estimer les services que les non-manuels pouvaient leur rendre dans la presse. « Mais leur attitude est pardonnable, vu la trahison permanente des hommes de lettres » (25 février 1865). A Genève, c’est l’ouvrier James Carter, membre du Conseil général, qui semble avoir le mieux compris la valeur « scientifique » de l’apport de Marx : « Que les hommes qui se sont occupés de la question économique, déclare-t-il, et qui ont reconnu la justice de notre cause et la nécessité d’une réforme sociale, viennent au congrès ouvrier battre en brèche la science économique bourgeoise. » Cf. La Première Internationale, l.c, t. I, p. 56. Voir également le compte rendu de J. Card, ibid., p. 80.
(33) Communication privée du Conseil général, 1er janvier 1870. Cf. La Première Internationale, l.c, t. II, p. 135. Après l’échec du mouvement pour la deuxième réforme — qu’il attribua surtout à la « trahison » des leaders syndicalistes — Marx découvrit dans la rupture de l’union forcée entre l’Angleterre et l’Irlande le levier pour la révolution sociale en Angleterre (cf. la même circulaire), mais son pronostic se révélera une fois de plus erroné.
Si les prévisions marxiennes se sont dans l’ensemble avérées à long terme en ce qui concerne les victoires politiques du mouvement ouvrier en Angle-
terre, elles conservent, en revanche, aujourd’hui comme hier, le caractère de postulats sur le plan révolutionnaire.
(34) La Première Internationale, l.c, t. I, p. 32. Si, comme nous le dit le compte rendu de J. Card, « le Congrès vote des résolutions conformes aux propositions du Comité central de Londres et des délégations françaises » (ibid., p. 76), c’est là une nouvelle démonstration en faveur du caractère politique de la charte internationale — à moins de supposer que tous les votes ont eu lieu dans la confusion totale.
(35) Ibid., p. 33. C’est dans le même esprit que Marx rédigera en mars 1869, dans l’affaire de l’Alliance de Bakounine, une circulaire dont voici le passage le plus caractéristique et le moins… « marxiste » : « […] la communauté d’action établie par l’A.I.T., l’échange des idées facilité par la publicité faite par les organes des différentes sections nationales, enfin les discussions directes aux congrès généraux, ne manqueront pas d’engendrer graduellement un programme théorique commun. » /. c, t. II, p. 271.
(36) L.c, t. I, p. 33.
(37) Ibid., p. 34 sq.
(38) Les jurassiens ont reconnu ce fait en déclarant que jusqu’au Congrès de Bàle « les quelques dissidences qui s’étaient manifestées […] ne nous apparaissaient [….] que comme de légères nuances d’opinion, non comme une sérieuse opposition de principes. Le Conseil général, composé entièrement de communistes, nous semblait notre allié naturel […] ». Cf. Mémoire présenté par la Fédération Jurassienne de l’A.I.T..., Sonvillier, 1873, p. 1. Naïveté ou ignorance, J. Guillaume, auteur du mémoire, qualifie le caractère foncièrement politique de la charte internationale, constamment souligné par les résolutions émanant du Conseil général, de « légère nuance » !
(39) Si, dans son éloge de Marx penseur, Bakounine dépasse les disciples les plus « marxistes » que le maître ait eus de son vivant, il anticipe, en revanche, dans ses invectives contre Marx « juif et allemand » la judéophobie la plus vulgaire que le XX° siècle ait connue. Il n’en reste pas moins que dans sa manie russophobe Marx a exagéré les dangers que les activités conspiratrices de Bakounine faisaient courir à l’Internationale. Pour un florilège de la marxolâtrie et de la judéophobie bakouniennes, voir Archives Bakounine, I, Michel Bakounine et l’Italie, 1871-1872, Leiden, E. J. Brill, surtout la deuxième partie « La Première Internationale en Italie et le conflit avec Marx » (1963), p. 105-111, 115-119, 121-128, 216-220. On ne peut que regretter que le commentateur, M. Arthur Lehning, ait, dans ses annotations des textes, épousé certaines manies « anarchistes » pour déformer l’image de Marx. Comment comprendre autrement, pour ne citer qu’un exemple, que M. Lehning n’ait pas placé parmi les Appendices un document aussi important que la circulaire du Conseil général du 9 mars 1869, rédigée par Marx? (voir note 35). En se bornant à en citer dans son introduction des fragments (l.c, p. XXVI), sans révéler le nom de l’auteur, l’éditeur voudrait-il laisser le lecteur ignorer que Marx s’est prononcé, dans ce document, contre toute espèce de monolithisme théorique ?
(40) César De Paepe, chef de file des « collectivistes » apparaît à la vérité comme le pilier « marxiste » à certains congrès de l’A.I.T. Voir sa lettre à Marx (13 nov. 1869) où il avoue s’être « déproudhonisé » peu à peu… Cf. V.A. Smirnova, l.c, p. 335
(41) Article 7 a des Statuts. Cf. édit. La Pléiade, p. 471 sq.
(42) « […] le Conseil général n’est pas le Pape, chaque section est autorisée à avoir ses propres vues théoriques sur le mouvement réel, à condition que rien ne soit proclamé qui soit directement contraire aux statuts. » (Marx à Paul Lafargue, 19 avril 1870). Et la veille, Marx écrit au même à propos de la création d’une nouvelle section à Paris (par Henri Verlet) : « Il ne faut pas qu’il donne à la nouvelle section […] un « nom » sectaire, communiste ou autre. Il faut éviter les étiquettes sectaires dans l’Association internationale. Les aspirations et les tendances générales de la classe ouvrière émanent des conditions réelles dans lesquelles elle se trouve placée. « Et c’est dans le même souci de placer l’Internationale au-dessus des partis et des doctrines que la Conférence de septembre 1871 votera une résolution défendant « aux branches, sections et groupes de se désigner par des noms de secte, comme par exemple les noms de branches positivistes, mutualistes, collectivistes, communistes, etc.. » On pourrait citer, dans un autre ordre d’idées, une remarque pertinente à propos d’une déclaration d’Engels sur le rôle « fondateur » de Marx : « En présentant ainsi une personne comme « véritable fondateur », tandis qu’en réalité d’innombrables individus et des facteurs généraux ont concouru […], l’image historique globale se change subrepticement en une image totalitaire avec, à l’arrière-fond, le culte du héros et le principe du führer. » Helmut Hirsch, Aufstieg und Niedergang der Ersten Internationale, dans le recueil d’essais publiés sous le titre Denker und Kämpfer, Frankfurt, Europâische Verlagsanstalt, 1955, p. 142.

La charte de la Première Internationale [1] (Rubel, 1965)
14 mars 2014Article de Maximilien Rubel paru dans Le Mouvement social °51.
La charte de la Première Internationale
Essai sur le » marxisme » dans l’Association internationale des Travailleurs
« Les programmes des partis ouvriers devraient être exempts de toute dépendance apparente à l’égard de tel auteur ou de telle œuvre » (Marx à Hyndman).
« MARXISME » : MOT ET CONCEPT.
Pour des raisons encore peu élucidées par l’historien des mouvements sociaux et de leurs idéologies, le corps de pensées connu sous le nom de « marxisme » a fini, après de multiples avatars, par occuper en plein XXe siècle une position universellement dominante. Ses origines, mal connues du sociologue des mentalités collectives, baignent dans un halo de légendes. Vu la notoriété et le prestige qu’il a conquis, on est tenté de penser avec une apparence de logique que, de son vivant, Karl Marx a réussi à faire école, donc que le « marxisme » est né en quelque sorte avec Marx. Et si l’on associe Friedrich Engels à cette gestation spirituelle, ce n’est pas sans faire le sacrifice de son nom : les pères fondateurs voient leurs efforts et leurs oeuvres s’amalgamer en un tout, le nom du « premier violon » — suivant la métaphore employée par Engels — servant à désigner la fusion ainsi obtenue.
Peu satisfait de cette explication mythique de la genèse du marxisme, le chercheur se trouvera nécessairement affronté à trois problèmes : Marx a-t-il fait école au cours de sa carrière d’homme de science et d’homme de parti ? Cette école, à supposer qu’elle ait existé, s’est-elle reconnue « marxiste » ? Qu’en pensait Marx lui-même ? Question subsidiaire : Qu’en pensait Engels ?
Répondre à ces questions, c’est retracer la carrière scientifique et politique de Marx sous l’angle du rayonnement que son œuvre et son action ont pu avoir de son vivant. En limitant notre recherche à une phase importante — peut-être la plus importante — de cette carrière, nous voudrions apporter une contribution à l’étude sociologique de la genèse du phénomène appelé « marxisme » : nous allons nous attarder au rôle de Marx comme auteur des documents constitutifs de la Première Internationale ouvrière. Précisons toutefois que notre essai ne vise qu’à une initiation méthodologique à l’exploration des problèmes, à un schéma de lignes de recherches plutôt qu’à une analyse systématique, qui ne pourrait être qu’un travail de longue haleine : il nous importe d’esquisser un procédé d’enquête permettant d’échapper à la tentation des constructions apocryphes qui ont la vertu rétroactive de souder la célébrité posthume d’un penseur à sa vocation charismatique supposée préexistante. Dans le cas qui nous intéresse, cette mise en perspective à rebours a abouti à l’obscurcissement total du rôle que Marx a effectivement tenu dans l’Internationale (1).
Ce rôle, il conviendrait de l’envisager selon les différentes sphères où l’activité de Marx s’est exercée au sein de l’Internationale : au Conseil général, dans les congrès et les conférences, dans les contacts personnels, directs ou épistolaires. On verra alors que Marx, fermement décidé à rester « dans les coulisses », a dû s’imposer un anonymat d’autant plus difficile à conserver qu’il était pratiquement l’auteur de toutes les proclamations (rapports, résolutions, adresses, manifestes) décidées le plus souvent sur son initiative par le Conseil général ; et lorsque l’effet de sensation produit par l’Adresse sur la Commune l’obligera à sortir de cet anonymat, il deviendra, malgré lui, le personnage central autour duquel vont se cristalliser les deux principales tendances idéologiques de l’Internationale : le communisme et l’anarchisme. Et l’on voit alors se reproduire le phénomène qui s’était produit vingt ans auparavant, quand la fraction qu’il représentait fut parfois désignée par ses opposants comme le « parti Marx » (2).
On en vient ainsi tout naturellement à s’interroger sur l’origine des étiquettes « marxiste » et « marxisme » : quand et par qui furent-elles employées pour la première fois et dans quel sens ? On comprend aisément qu’il s’agit là d’un problème sociologique au sens précis du terme : l’emploi de ces étiquettes correspondait à un besoin de désigner ou de dénoncer soit un groupe d’individus soumis à l’ascendant d’un « chef », soit une mentalité collective se réclamant de l’enseignement de ce « chef ». Or, s’il est difficile, dans l’état actuel des recherches, de préciser avec la dernière rigueur quand, où et par qui les termes « marxiste » et « marxisme » furent employés initialement, il est légitime de situer leur apparition au début des années 70, lorsque le conflit provoqué par la dissidence jurassienne entra dans sa phase aiguë. Comme en 1846 et en 1851, ce sont des adversaires de Marx qui éprouvent le besoin d’étiqueter ce qui leur apparaît comme une « coterie » formée autour de Marx, et l’on voit alors surgir, sous la plume d’un anonyme adepte de Bakounine, le terme « marxistes » (3). A partir de ce moment, le camp des « antiautoritaires » fait volontiers usage du terme, comme d’ailleurs du mot « marxisme » : lorsqu’en 1882, Paul Brousse publie sa brochure intitulée le Marxisme dans l’Internationale (4) — qui semble être le premier texte qui accueille ce mot dans son titre même — le terme semble déjà avoir reçu sa consécration quasiment officielle : Marx a dû s’en accommoder, car, bien que forgés par ses adversaires, les mots « marxiste » et « marxisme » avaient déjà été adoptés par certains de ses partisans et disciples. Il y a lieu de penser que cet usage n’a pas été goûté par Marx (5).
Il est significatif qu’à l’exemple de Bakounine Brousse s’en prenne à Marx, « chef de parti » et « autoritaire » (et à ses « agents » et « tacticiens » tels que Paul Lafargue), sans refuser son admiration au penseur. Ainsi trouve-t-on chez lui une définition du marxisme qui met prophétiquement en lumière toute l’ambiguïté de cette notion : « Le marxisme ne consiste… pas à être partisan des idées de Marx. A ce titre, beaucoup de ses adversaires actuels, et particulièrement celui qui écrit ces lignes,
seraient marxistes » (6).
Brousse a mis ainsi le doigt sur un fait qui, pour n’avoir pas été formulé, n’en a pas moins été reconnu pratiquement par tous les internationaux à quelque école qu’ils aient appartenu : en adhérant, lors du Congrès de Genève, à la charte de l’Internationale, telle qu’elle avait été adoptée en 1864 par le Conseil central, ils étaient devenus « marxistes » sans le savoir.
UNE CHARTE « MARXISTE » ?
Si les circonstances extérieures qui ont conduit à la rédaction par Marx du triptyque appelé Adresse Inaugurale, Préambule et Statuts de l’A.I.T. — que nous désignons désormais par la « charte de l’Internationale » — sont suffisamment connues, la nature et l’inspiration profonde de ce travail de rédaction n’ont pas encore fait l’objet d’une exploration sérieuse (7). Cela est d’autant plus étonnant que c’est autour des thèses et des postulats énoncés par cette charte que s’est joué, tout au moins au niveau des conflits de tendances, le sort de l’Internationale. On saisit la difficulté, mais aussi l’utilité d’une enquête qui tendrait à établir dans quelle mesure les principes définis par l’acte fondateur de l’Internationale étaient connus et compris des individus et groupements qui militaient dans son sein, tout en se réclamant de doctrines sociales ou de traditions révolutionnaires divergentes, voire contradictoires (8).
La France a sans doute fourni à l’Internationale initialement un contingent nombreux de proudhoniens, tandis que l’Angleterre était surtout représentée par des dirigeants syndicalistes ayant des velléités chartistes ou owenistes, et l’Italie par les adeptes de Mazzini. Secrétaire-correspondant pour l’Allemagne, Marx semblait apporter à l’Internationale une pensée sociale et politique de taille : le communisme. Mais outre que les adeptes du communisme « historique » pouvaient se compter sur les doigts, le passé de Marx théoricien du communisme et auteur du principal manifeste du mouvement n’était connu que de quelques initiés (9).
Il n’est donc nullement prouvé que Marx ait eu, dès le départ l’intention de prendre sur lui l’élaboration des documents de base de l’Internationale. Le contraire nous semble plus facile à démontrer. Nommé au comité chargé de rédiger les statuts (rules and regulations) de la nouvelle association et au sous-comité des neuf désignés à la première réunion du Conseil (5 octobre), il ne peut étant malade, assister aux premières séances de ces comités. En
son absence, le sous-comité (8 octobre) discute la « déclaration de principes » rédigée par Weston et les statuts de l’Association des Travailleurs italiens lus par le mazzinien Wolff. Ces statuts reçoivent l’approbation du sous-comité qui les recommande à l’attention du Conseil. Marx est encore absent de la séance du Conseil pendant laquelle Weston lit un texte remanié de sa déclaration des principes et Wolff la version anglaise des statuts italiens. Bien que ces textes soient favorablement accueillis, il est décidé de les retourner au sous-comité (10). Or, le lendemain, Marx est alerté par Eccarius qui l’informe que son absence paraît mystérieuse à « tout le monde ». Eccarius estime la présence de Marx « absolument nécessaire » au prochain sous-comité, et il s’explique : qu’il avait un texte élaboré qui contenait dans un sac d’ivraie une poignée de grains, mais même ceux-ci n’ont rien de décisif. Au sous-comité, il fut chargé de condenser son texte, mais sa production raccourcie n’est pas meilleure que l’original : c’est un éditorial sentimental et déclamatoire sur le programme, mais ce n’est pas le programme lui-même. Cremer a déclaré publiquement que le projet devait être raccourci des trois quarts. En outre, le major Wolff a traduit et proposé un projet de statuts qui était destiné à l’organisation des travailleurs italiens, projet qui a été accueilli, dans l’ensemble, avec sympathie. Ces deux documents ont été renvoyés au sous-comité pour en tirer, en les modelant, ce qu’ils contiennent de substantiel et pour rédiger un seul document qui contiendrait à la fois la déclaration des principes et les statuts. Après la séance, Cremer a fait confidentiellement la remarque que Weston ne devrait plus toucher à cette affaire et que la rédaction du projet devait être confiée à une commission de trois personnes au maximum qui pourraient à leur gré faire ou ne pas faire usage du tout des matériaux existants. Odger et d’autres furent du même avis. « The right man in the right place » serait indubitablement le Dr Marx. Weston est un vieil owenite qui limite, il est vrai, la doctrine sentimentale de la vieille école aux seuls travailleurs et hait instinctivement l’oppression, mais qui, semble-t- il, ne connaît d’autre base du mouvement ouvrier que la phrase éculée vérité et justice » (11).
Une phrase impérative au début de la lettre d’Eccarius va sans doute se graver dans l’esprit de Marx : « Il faut absolument que tu imprimes le sceau de ta concision profonde à ce premier-né de l’organisation européenne des travailleurs. » Le lendemain, W.R. Cremer, secrétaire général du Conseil, informe Marx que les membres du comité seraient heureux de pouvoir compter sur sa présence à la prochaine réunion. Prévenu trop tard, Marx ne peut toutefois assister à cette réunion (15 octobre), au cours de laquelle Le Lubez présente des textes remaniés de la déclaration des principes de Weston et des statuts proposés par Wolff. Ils seront soumis à la prochaine réunion du Conseil central, le 18 octobre, et c’est alors que se produit un fait curieux : Marx appuie la proposition de Cremer tendant à faire adopter le programme lu par Le Lubez (12) ! Une discussion s’ensuit au sujet de tel passage du texte de Le Lubez, puis « la substance du programme » est adoptée à l’unanimité, le sous-comité recevant mission de donner une forme définitive au préambule et aux statuts. Rien dans l’attitude de Marx, telle qu’elle est consignée dans le procès-verbal de cette réunion, ne laisse apparaître la moindre intention de procéder à une refonte totale des projets dont le Conseil central vient d’approuver la « substance » et qu’elle ne renvoie au sous-comité que pour une simple mise en forme.
Pourtant, le récit de cette réunion fait quelques semaines plus tard par Marx, dans sa lettre à Engels, n’est pas tout à fait conforme à ce que nous en dit le procès-verbal : celui-ci nous apprend que Marx s’est associé à Cremer pour proposer l’adoption du programme refondu par Le Lubez, alors que la lettre le montre « effrayé » d’entendre le « brave Le Lubez » lire un « préambule affreusement phraséologique, mal écrit et tout à fait enfantin, prétendant être une déclaration de principes », un texte d’inspiration mazzinienne, « enveloppé dans les lambeaux les plus fumeux du socialisme français ». En outre, la lettre de Marx contient un détail absent du procès-verbal, mais extrêmement révélateur pour la conception que Marx avait du rôle du Conseil général de l’Internationale. Parlant des statuts mazziniens, Marx critique sévèrement la résolution proposée par Wolff tendant à faire du Conseil général un « gouvernement central (avec, bien entendu, Mazzini à l’arrière-plan) des classes ouvrières européennes » (13). Cette remarque, on le voit, est comme une réponse anticipée au principal chef d’accusation de la campagne que les internationaux « antiautoritaires » lanceront plus tard contre l’ « autoritarisme » de Marx. « Je marquais une faible opposition, écrit encore Marx, et après de longs conciliabules, Eccarius proposa que le sous-comité soumette de nouveau la chose à sa « rédaction ». Par contre, on vota les « sentiments » contenus dans la déclaration de Le Lubez » (14).
On peut penser que ce récit, écrit plus de deux semaines après la séance du 18 octobre, exprime l’idée définitive que Marx se faisait des divers textes proposés à l’examen du Conseil. Il n’en est pas moins vraisemblable qu’en votant pour l’adoption du projet de Le Lubez, il ne pensait pas lui faire subir l’opération chirurgicale qu’il lui fera subir, seulement après un nouvel examen approfondi : c’est précisément cela que Cremer et Eccarius — et sans doute d’autres — attendaient de lui, si bien qu’on ne saurait parler à ce propos d’une « manœuvre » de sa part (15).
Bien au contraire, si, comme il s’en plaignait, Marx a dû conserver, à contre-coeur, dans sa propre rédaction de la charte de l’A.I.T., une certaine phraséologie rencontrée dans les projets, il a néanmoins tenu avant tout à ne rien exprimer dans la charte qu’il allait rédiger qui pût donner lieu à des controverses doctrinales et partant provoquer l’éclosion de fractions et de tendances opposées au sein de l’Internationale. « Rendre acceptables » des éléments de sa propre théorie sociale aux divers représentants du mouvement ouvrier était donc une tâche d’autant plus facile que cette théorie ne prétendait à rien d’autre qu’à exprimer le « mouvement réel » à un stade déterminé de son développement.
L’idée de reprendre le travail à zéro est probablement venue à Marx après qu’il ait eu connaissance du dossier qui lui avait été confié par le sous-comité (16). Il n’était pas question pour lui de faire de la charte un instrument d’endoctrinement, de faire du prosélytisme. Bref, Marx n’a pas eu l’intention de lancer aux Internationaux par un tour de passe-passe invisible un nouveau manifeste communiste. Il en a cependant tiré pour la charte de 1864 une idée capitale, peut-être même la quintessence : la revendication de la conquête du pouvoir politique ! (17).
Nous tenons là un élément essentiel pour toute recherche qui veut cerner le phénomène « marxiste » dans les débuts mêmes de l’Internationale. Car si tout le « marxisme » tenait dans la formule ou le mot d’ordre de la conquête du pouvoir politique, toute une pléiade de socialistes et de communistes antérieurs à Marx mériterait le titre glorieux de fondateurs du … « marxisme », même si on élargissait la formule pour y faire tenir le postulat de la « dictature du prolétariat » : celui-ci perdra pour Marx tout caractère d’ambiguïté quand la Commune de Paris en deviendra à ses yeux l’illustration historique (18).
D’ailleurs, pour bien marquer que la conquête du pouvoir n’est pas un mot d’ordre sectaire inventé à des fins inavouables, Marx insiste sur le caractère populaire de cette revendication, en rappelant les efforts tentés par les travailleurs anglais, allemands, italiens et français pour « réorganiser le parti des ouvriers ». C’était à ses yeux, une revendication qui se dégageait des intentions et des démarches des représentants du mouvement ouvrier en France, en Angleterre et en Allemagne. Il fallait un effort de synthèse d’une grande lucidité pour anticiper dans la charte internationale de 1864 le caractère et l’objectif des futurs mouvements ouvriers nationaux. Le bilan de la lutte ouvrière en Angleterre, Marx l’interprète comme une double victoire de l’économie politique du travail sur l’économie politique du capital : victoire politique sous la forme du bill des dix heures, victoire économique obtenue grâce au système des coopératives qui préfigure le mode de production de l’avenir, l’économie sans patronat et sans salariat. Rien d’original, ni de « marxiste » dans la partie finale de l’Adresse inaugurale : la cause de l’indépendance de la Pologne avait été la raison des rencontres franco-anglaises en 1862 et 1863 et un des thèmes majeurs du meeting de St. Martin’s Hall. Au meeting du 22 juillet 1863, George Odger, aussi explicite que le sera Marx dans l’Adresse, avait déclaré que la paix ne pouvait être préservée aussi longtemps que la Russie serait maîtresse de la Pologne (19). Le même Odger, dans l’Adresse aux travailleurs français rédigée trois mois après ce meeting, avait parlé, comme le fera Marx, de la nécessité de « prévenir les intrigues de la diplomatie secrète » (20). Bref, bien que Marx se soit désintéressé en 1862 et 1863 des rencontres à Londres des militants anglais et français et qu’il n’ait peut-être pas eu connaissance des discours prononcés à ces occasions et encore moins du Manifeste des Soixante de 1862, première charte politique du mouvement ouvrier français (21), il avait pendant plus de dix ans observé d’assez près la situation économique et politique de l’Europe, comme en témoignent les centaines d’articles que lui et Engels écrivaient pour la New York Tribune, pour être en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur les perspectives de ce mouvement (22).
Si donc l’Adresse dite inaugurale n’a rien de « marxiste », le préambule et les statuts ont été rédigés de manière à être en harmonie avec les aspirations ouvrières telles qu’elles s’étaient manifestées ouvertement en Angleterre, « métropole du capital », et moins ouvertement en France où le régime de Napoléon III était visiblement entré dans sa phase déclinante. Le postulat de l’autoémancipation est aussi vieux que le socialisme prolétarien, particulièrement dans sa variante utopique chez Weitling aussi bien que chez Owen ou, avec une nette finalité politique, chez Flora Tristan.
Que Marx eût préféré écarter le vocabulaire particulièrement cher aux disciples de Proudhon et d’Owen (« droits » et « devoirs », ou « Vérité, Justice et Morale ») correspondait à son dédain pour toute phraséologie et donc à son estime pour des valeurs qui, placées hors de tout contexte comme de simples ornements affectifs, ne signifient rien par elles-mêmes : ce langage pouvait être revendiqué par n’importe qui, adepte ou adversaire de la cause ouvrière. Si Marx accepta de quitter sa retraite et d’apparaître sur la scène publique, ce n’était pas pour proposer une nouvelle doctrine sociale, ou un nouvel évangile politique — ce fut avec le dessein d’apporter aux « puissances réelles », qu’il voyait surgir en France et en Angleterre des « éléments de culture » (23). Dès 1843, il a cru entrevoir le caractère original du mouvement ouvrier où devaient se rencontrer et s’entendre « l’humanité souffrante qui pense » et « l’humanité pensante qui est opprimée » (24).
[à suivre…]
Notes:
(1) Cf. M. Rubel, « Karl Marx et la Première Internationale. Une chronologie ». Première partie (1864-1869). Cahiers de l’I.S.E.A., série S, n° 8, août 1964, p. 9-82. On trouvera dans le même cahier : « Bibliographie de la Première internationale », p. 249-275.
(2) Le terme est employé dans les querelles Marx-Weitling à propos de Hermann Kriege, lors d’une campagne du Comité de correspondance communiste de Bruxelles contre le Volkstribun de New-York (1846). Cf., par exemple, Hess à Marx, 29 mai 1846, Der Kampf, Vienne, sept. 1929, p. 432. Il appa-raît fréquemment dans les actes de police lors du procès des communistes de Cologne, à côté du terme « société Marx ». Cf. K. Marx, Révélations sur le procès des communistes de Cologne (1853). Paris, A. Costes, 1939, p. 140 et passim. Le traducteur omet de guillemeter ces expressions citées par Marx, cf. Enthûllungen…, édit. Dietz, Berlin, 1952, p. 61 et passim.
(3) Cf. La Première Internationale. Recueil de documents publié sous la direction de J. Freymond. Genève, Droz, 1962, t. II, p. 311, et passim, où il est question également de la « dynastie des Marxides » et de la « loi marxiste » Paul Lafargue y est le principal visé. Parlant du Capital « oeuvre consciencieuse et pleine de science, quoique écrite sous l’empire d’un système préconçu », l’auteur de cette diatribe fait la remarque : « Combien y en a-t-il […] au Conseil général, qui sont marxistes sans avoir jamais ouvert le livre de Marx ! » (p. 315).
(4) Paris, Bureau du journal Le Prolétaire, 32 p.
(5) Le mot de Marx : « Je ne suis pas marxiste » a été rapporté par Engels qui n’y voyait pas une boutade, pour l’avoir rappelé maintes fois. Cf. Engels à Bernstein (3-11-82), à C. Schmidt (15-8-90), à P. Lafargue (27-8-90), à H. Lopatine (Marx-Engels, Werke, Dietz, t. 21, p. 489). Dans une lettre à Laura Lafargue (11-6-89) on peut lire : « Ils (les anarchistes) se mordront les doigts de nous avoir donné ce nom », (Cf. F. Engels, Paul et Laura Lafargue, Correspondance, Paris, Editions Sociales, t. II, 1956, p. 288). Engels s’est donc résigné à accepter le défi et, du terme honni, il s’efforcera de faire un titre de gloire… ab absurdo. C’est une des raisons, et pas la moindre, pour affirmer que le père du marxisme, c’est Engels.
(6) L.c, p. 7. Brousse ajoute : « Le marxisme consiste surtout dans le système qui tend non à répandre la doctrine marxiste, mais à l’imposer dans tous ses détails. » Vu l’époque, Brousse a sans doute exagéré ; mais sa critique a valeur de prémonition.
(7) Citons cependant deux travaux importants qui défrichent le terrain pour une telle enquête : D. Rjazanov, Zur Geschichte der Ersten Internationale. I. Die Entstehung der Internationalen Arbeiterassoziation. « Marx Engels-Archiv », I, 1926, p. 119-202. V.A. Smirnova, Iz istorii sozdaniia programmnuh dokumentov pervovo internacionala. « Iz istorii marksizma i mezdunarodnovo rabochevo dvizenija », Moscou, 1963, p. 280-342.
(8) Un exemple typique : en septembre 1866 (Congrès de Genève), James Guillaume ignorait « jusqu’à l’existence de Karl Marx ». Il n’en entendra parler qu’au Congrès de Lausanne (1867). L’Internationale, Paris, 1905, t. I, p. 5. En 1870, Guillaume ne connaissait pas encore « le célèbre manifeste écrit par Karl Marx en 1864 » (l’Adresse inaugurale), ibid., p. 277. — A propos de la phrase sur la conquête du pouvoir politique figurant dans l’Adresse inaugurale, Miklos Molnar (Le déclin de la Première Internationale. La Conférence de Londres de 1871. Genève, Droz, 1963, p. 190) écrit : « Il semble que cette déclaration passa inaperçue à l’époque, tout au moins ses lecteurs ne lui prêtèrent pas beaucoup d’attention. » Sur la résistance que les proudhoniens auraient opposé à la diffusion en France de la charte de l’A.I.T., voir E. Jéloubovskaïa, La chute du Second Empire et la naissance de la Troisième République en France, Moscou, 1959, p. 174 sq. Toutefois, telles déclarations des accusés aux procès de l’A.I.T. démontrent que le « marxisme » était alors un phénomène immanent au mouvement ouvrier et que les membres français, proudhoniens ou non, n’avaient aucun intérêt à refuser la charte de l’A.I.T.
(9) Depuis la dissolution de la Ligue des communistes (nov. 1852), le parti communiste allemand n’existait plus, dans la vision de Marx, qu’au « sens éminemment historique », donc nullement comme organisation formelle et structurée. Cf. M. Rubel, « Remarques sur le concept de parti prolétarien chez Marx », Revue française de Sociologie, 1961, II, 3, p. 173. Pourtant, le Conseil central de l’Internationale comprendra dès les premiers mois de son existence, outre Marx et Eccarius (grâce à des cooptations proposées par eux), plusieurs autres anciens membres de la Ligue des communistes : Lessner, Pfânder, Lochner, auxquels s’adjoindront bientôt quelques membres du Deutscher Arbeiterbildungsverein londonien avec lequel Marx avait repris le contact interrompu depuis plus de dix années et dont il fut délégué au Conseil central comme correspondant-secrétaire pour l’Allemagne. Pour mieux démontrer sa mission représentative, Marx avait pensé, un moment, à se faire offrir officiellement la succession de Lassalle à la tête de l’Association Générale des Travailleurs Allemands. Cf. M. Rubel, Afarx et la Première Internationale, l.c, p. 13. Un seul militant futur membre de l’A.I.T., extérieur au groupe londonien des adeptes de Marx, connaissait la carrière de l’auteur du Manifeste communiste : Bakounine.
(10) Cf. The General Council of the First International 1861-1866. The London Conférence 1865. Minutes. Moscou, s.d., p. 35 sq.
(11) Cette lettre, écrite en allemand, dans : Karl Marx und die Gründung der I. Internationale. Dokumente und Materialien. Berlin, Dietz, 1964, p. 30-32.
(12) Cf. Minutes, l.c, p. 42. V.A. Smirnova fait état de cette séance mais omet de mentionner l’attitude de Marx, Elle se borne à citer le récit que Marx en fit à Engels, le 4 novembre 1864. Cf. Iz istorii…, l.c. p. 293.
(13) Pour une raison inexplicable, cette résolution proposée par Wolff ne figure pas au procès-verbal de la séance du 8 octobre 1864. Elle avait été notée par W.R. Cremer sur une page vide de la traduction anglaise des statuts italiens. Cf. Gründung, l.c, p. 123 et suiv.
(14) Marx à Engels, 4 novembre 1864.
(15) J. Freymond, l.c, p. XXI.
(16) Séance du sous-comité, 20 oct. 1864, au domicile de Marx. Celui-ci disposait, par conséquent, d’un projet de statuts destiné à l’Association des Travailleurs Italiens, proposé par Wolff et remanié par Le Lubez, et d’un projet de déclaration de principes dû à J. Weston et également remanié par Le Lubez. Ces documents n’ont pas été conservés. Cf. Founding of the First International. New York, International Publishers, 1937, p. 75-78 (extraits des statuts italiens en traduction anglaise). A travers le texte de Le Lubez, Marx en a retenu, outre les « sentiments », l’idée d’une enquête générale sur les conditions et les revendications des travailleurs. Le Conseil central, en adoptant unanimement les textes rédigés par Marx, félicitera Weston et Le Lubez au même titre que Marx d’avoir « produit une adresse si admirable » (séance du 1er nov. 1864, Minutes, l.c, p. 44). La question de l’apport mazzinien prétendument conservé par Marx fera l’objet de controverses au Conseil central et Marx fera une mise au point intéressante (« Wolff voulait
la centralisation et entendait par sociétés ouvrières uniquement des sociétés du secours » ; séance du 13-3-66, Minutes, l.c, p. 171).
(17) Cette revendication fera l’objet de la résolution IX votée à la Conférence de Londres, septembre 1871, et elle deviendra l’article 7 a des statuts au Congrès de La Haye, septembre 1872. Voir l’intervention de Marx à la Conférence de Londres, soulignant l’importance de la représentation des ouvriers dans les parlements. Cf. La Première Internationale, l.c, t. II, p. 194-196. Au Congrès de La Haye, Guillaume rappellera que la résolution sur l’action politique contient des « phrases fondées sur le Manifeste communiste » (ibid., p. 360). Sur l’attitude du groupe blanquiste (Vaillant, etc.) pendant et après le Congrès, voir J. Verdès, « Les délégués français aux Congrès et Conférence de l’A.I.T. », Cahiers de VI.S.E.A., série S, n° 8, août 1964, p. 149 sq. et 162 sq. (brochure de, Vaillant : Internationale et Révolution, 1872).
(18) Cf. Hal Draper, « Marx and the dictatorship of the proletariat », Cahiers de l’I.S.E.A., série S, n° 6, sept, 1962, p. 5-73.
(19) Cf. Riazanov, Entstehung…, l.c, p. 167. L’auteur souligne le caractère belliqueux du discours d’Odger .
(20) Bee-Hive, 5 décembre 1863. Cité par Riazanov, l.c, p. 173.
(21) Citant et commentant le Manifeste des Soixante, Riazanov conclut : « On voit qu’il n’est guère possible de ne voir dans ce manifeste qu’un résumé et une répétition des idées fondamentales de Proudhon », J.c, p. 180.
(22) Sur les articles consacrés par Marx au Second Empire, voir M. Rubel, Marx devant le bonapartisme, Paris-La Haye, Mouton et Co, 1960.
(23) « Les communistes […] ne posent pas de principes particuliers d’après lesquels ils prétendent modeler le mouvement prolétarien. […] Dans les diverses luttes nationales des prolétaires, ils mettent en avant et font valoir les intérêts communs du prolétariat tout entier, sans considération de nationalité. […] Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, des principes inventés ou découverts par tel ou tel réformateur du monde. Elles ne font qu’exprimer, en termes généraux, les conditions réelles d’une lutte de classes qui existe, d’un mouvement historique qui se déroule sous nos yeux. » Le Manifeste communiste, édit. La Pléiade, p. 174. Cette déontologie du communisme a-t-elle été scrupuleusement respectée par son auteur ? Les ambiguïtés, voire les contradictions des écoles qui se réclament de Marx semblent prouver le contraire.
(24) Marx à Ruge, mai 1843. Annales franco-allemandes, 1844.
La pensée maîtresse du Manifeste communiste (Rubel, 1948)
7 mars 2014Article de Maximilien Rubel paru dans la Revue socialiste, N°17-18, janvier/février 1948 (Numéro Spécial : Centenaire de 1848), texte également tiré en imprimé 19 pages chez M. Rivière.
Bien qu’un siècle nous sépare du Manifeste communiste, ce n’est que depuis quinze ans environ que nous avons à notre portée les matériaux susceptibles d’éclairer d’une manière définitive et les circonstances historiques de sa genèse et la place qu’il occupe dans l’œuvre de Marx et d’Engels.
En effet, alors que le marxisme — c’est-à-dire l’ensemble des courants idéologiques se réclamant de l’enseignement marxien — a fait naître une immense littérature apologétique, la marxologie — c’est-à-dire l’exploration scientifique, historico-critique de l’œuvre de Marx et d’Engels — n’a pu produire jusqu’ici qu’un nombre relativement réduit de travaux importants.
On comprendra aisément les raisons de cette situation paradoxale, si l’on considère que la recherche marxologique au sens propre du terme ne remonte guère qu’à une trentaine d’années et que les foyers principaux en furent l’Allemagne républicaine d’avant Hitler et la Russie révolutionnaire pré-stalinienne: c’est donc dans la période de 1917 à 1932 que se situe la moisson sinon abondante, du moins précieuse que représentent les travaux des D. Riazanov, G. Mayer, C. Grünberg, M. Nettlau, B. Nicolaevski, pour ne nommer que les marxologues les plus méritants.
Toutefois, si après plus de soixante ans de marxisme militant et « triomphant » il n’existe pas encore une édition complète des œuvres, écrits et lettres des fondateurs du socialisme scientifique — fait qui prouve, à lui seul, que la marxologie est loin d’avoir achevé sa tâche — , il faut se féliciter qu’en ce qui concerne leur activité théorique et politique durant la période antérieure à la publication du Manifeste communiste, la recherche marxologique se meuve aujourd’hui sur un terrain sûr, et cela grâce à D. Riazanov. Celui-ci, avant de disparaître de son poste de directeur de l’Institut Marx-Engels de Moscou, a pu mettre au point l’édition historico-critique des écrits de jeunesse et de l’Idéologie allemande de Marx et d’Engels.
A la lumière des résultats obtenus par la récente recherche marxologique, on peut apprécier à leur juste valeur certaines des publications parues à l’occasion du cinquantenaire du Manifeste, comme par exemple les Essais sur la conception matérialiste de l’histoire d’Antonio Labriola ou l’Introduction historique de Ch. Andler. Si elles contiennent des erreurs, celles-ci ne sont devenues évidentes que depuis peu ; par contre, elles sont à beaucoup d’égards encore très instructives, dans la mesure où les déductions faites par leurs auteurs — qui ne pouvaient que conjecturer ce que nous savons aujourd’hui — ont été confirmées par la suite. Ainsi, ce qui ne pouvait être que supposition chez Andler, lorsqu’il se livrait à une enquête sur les auteurs dont la pensée a fécondé celle de Marx, a reçu sa confirmation partielle, après la découverte des manuscrits économico-philosophiques et des cahiers d’extraits de Marx.
Dans le même ordre d’idées, il convient de citer, ne serait-ce qu’au titre de symptôme, le jugement porté sur l’activité théorique de Marx jusqu’à 1848, par un professeur d’université affirmant que l’auteur du Capital « n’a rien écrit qui touche à l’économie politique avant son Manifeste communiste de 1847 (sic) » et que « jusqu’à cette date il ignorait à peu près tout des questions économiques » (1). Quand même on ignorerait l’existence des nombreux écrits de Marx, datant de la période antérieure au Manifeste, un simple regard sur la Misère de la Philosophie parue en 1847 (et écrite en français !) suffirait pour se convaincre qu’il s’agit là d’un ouvrage sérieux de critique économique contenant de nombreuses citations d’économistes bien connus ou tirés de l’oubli par Marx. On y trouve non seulement la première ébauche d’une critique magistrale des théories de Ricardo, mais aussi une réfutation des adversaires de celui-ci, qui — comme Bray et Proudhon — préconisaient la réforme de la société sur la base de l’échange individuel de quantités égales de travail (2).
Quant à l’activité politique de Marx et d’Engels avant 1848, elle a également été beaucoup plus importante qu’on ne pouvait le supposer avant que les investigations de Riazanov n’eussent révélé le rôle de Marx comme initiateur des comités de correspondance communistes (3).
I. — Le problème de la paternité du Manifeste communiste
Il ressort des propres déclarations de Marx et d’Engels que le Manifeste du Parti communiste fut leur œuvre commune. Retraçant son activité littéraire jusqu’à la Contribution à la Critique de l’économie politique (1859), Marx parle en ces termes de sa collaboration avec Engels pendant son séjour à Bruxelles (1845-1848) : « Des travaux épars que nous avons soumis au public à cette époque et dans lesquels nous avons exposé nos vues sur des questions diverses, je ne mentionnerai que le Manifeste du parti communiste, rédigé par Engels et moi en collaboration… » (4).
De son côté, Engels, dans son aperçu de l’histoire de la Ligue communiste, écrit en 1885 (5), à propos du deuxième Congrès que la ligue tint à Londres, fin novembre et commencement décembre 1847 : « Marx y assista et, dans des débats assez longs, … défendit la nouvelle théorie. Toutes les objections et tous les points litigieux furent finalement résolus; les principes nouveaux furent adoptés à l’unanimité et l’on nous chargea, Marx et moi, de rédiger le Manifeste. Nous le fîmes sans retard aucun. Quelques semaines avant la révolution de février, nous expédiâmes le Manifeste à Londres, aux fins d’impression » (6).
De quelle nature fut cette collaboration ? On sait que pour la Sainte Famille (1844), pamphlet philosophique de plus de deux cents grandes pages Engels en écrivit à peine trois, sans que cela empêchât Marx de placer, sur la couverture, le nom de son ami avant le sien. Engels en fut lui-même surpris (7). Toutefois, dans le cas de l’Idéologie allemande (1845-46), chacun semble s’être réservé une cible particulière, sans que l’état incomplet et imparfait des manuscrits permette de préciser la part exacte que l’un ou l’autre eut dans la rédaction de l’ouvrage informe dont les meilleures pages sont celles où la théorie matérialiste de l’histoire est exposée pour la première fois et de la manière la plus complète, sans doute par Marx seul (8). Dans la préface qu’il écrivit en 1883 pour la deuxième édition allemande du Manifeste, Engels a pris soin de nous donner la clé de ce problème. Résumant avec une extrême concision « la pensée fondamentale et directrice du manifeste », — nous verrons plus loin comment le compagnon de Marx entend définir cette pensée — il déclare : « Cette pensée maîtresse appartient uniquement et exclusivement à Marx ».
Il est clair que par cette mise au point péremptoire, Engels a voulu établir une distinction nette entre sa contribution — qu’il considérait comme moins fondamentale — et celle de Marx qui avait fait œuvre géniale. Et Engels était en mesure de délimiter exactement l’importance de son apport dans l’élaboration des idées développées dans le Manifeste.
Cette délimitation nous pouvons la tenter aujourd’hui avec autant plus d’exactitude que nous connaissons le projet rédigé par Engels à la veille du congrès tenu par la Ligue communiste en novembre 1847. Il fut publié pour la première fois par Edouard Bernstein, en 1914, sous le titre : « Principes du Communisme » (9).
Précisons tout d’abord les circonstances dans lesquelles le projet d’Engels est né. A son congrès de juin 1847, auquel Engels avait assisté comme délégué du comité parisien, la Ligue des Justes — qui devait adopter en novembre de la même année le nom de Ligue des Communistes — avait discuté, entre autres, la question de la publication d’une « profession de foi » communiste, et les sections de la ligue avaient été invitées à présenter des projets au congrès suivant qui devait se prononcer sur l’adoption définitive de l’un d’entre eux. Encore avant le mois de septembre, le comité central de Londres avait envoyé aux sections du continent « un credo communiste succinct et facilement intelligible à tous ». (10) Un des membres de la section parisienne, Moses Hess — dont le nom est étroitement lié à l’histoire du communisme théorique allemand avant Marx et qui avait l’habitude du style catéchiste (11) — semble avoir été le premier à entreprendre le travail, ce qui ressort du récit circonstancié qu’Engels adressa à Marx, fin octobre 1847 de ses rencontres avec Louis Blanc et Flocon (12). Nous en détachons le passage qui nous intéresse ici :
« J’ai joué, ceci tout à fait entre nous — un tour infernal à Moïse (13). Comme de juste, il avait réussi à imposer une profession de foi délicieusement amendée. Or, vendredi dernier, je l’ai reprise à la section, point par point, mais je n’en étais pas encore arrivé à la moitié que tout le monde se déclarait satisfait. Sans la moindre opposition je me fis charger de rédiger un nouveau projet qui sera discuté à la section vendredi prochain et envoyé à Londres à l’insu des Communes (14). Naturellement, personne n’en doit rien savoir, sans quoi nous serons tous destitués et cela fera un scandale du diable ».
Deux semaines plus tard, Engels fut désigné par sa section comme délégué au congrès de Londres et le 24 novembre il écrivit à Marx pour lui fixer rendez-vous à Ostende où les deux amis devaient faire ensemble la traversée de la Manche. C’est dans cette lettre qu’Engels communiqua à Marx le schéma de son projet de crédo communiste qu’il voulait soumettre à la discussion du congrès : « Réfléchis donc un peu à la profession de foi. Le mieux serait, à mon avis, d’abandonner la forme de catéchisme et de l’intituler : Manifeste communiste. Comme il faut y parler plus ou moins d’histoire,la forme adoptée jusqu’ici ne convient pas du tout. J’apporterai le projet de la section parisienne, que j’ai fait. Il est purement narratif, mais fort mal rédigé, avec une terrible hâte. Je commence par la question : Qu’est-ce que le communisme ? et je passe immédiatement au prolétariat, — genèse historique, différence entre le prolétariat et les ouvriers d’autrefois, développement de l’antagonisme entre le prolétariat et la bourgeoisie, crises, conséquences. Toutes sortes de choses secondaires y sont mêlées, et à la fin je parle de la politique de parti des communistes, autant qu’on peut en parler publiquement. Le projet d’ici n’a pas encore été soumis, dans son entier, à l’approbation, mais je pense qu’à part quelques tout petites détails je le ferai passer pour qu’il n’y figure rien de contraire à nos idées ».
Il n’a pas été possible de savoir si Engels a présenté son projet au congrès de novembre-décembre. Marx l’en a-t-il dissuadé, après s’être convaincu qu’il s’agissait de mettre au monde un document d’une portée historique ? (15) Quoiqu’il en en soit, nous savons qu’au congrès de Londres Marx prit l’engagement de rédiger le Manifeste communiste. Nous en avons la preuve par la lettre comminatoire que le comité central de Londres adressa le 26 janvier 1848 à la section de Bruxelles, et où il est dit : « Le Comité central charge par la présente le comité de la section de Bruxelles d’informer le citoyen Marx que si le Manifeste du Parti communiste dont il a pris sur lui la rédaction au dernier congrès n’est pas arrivé à Londres avant le mardi 1er février de l’année en cours, des mesures ultérieures seront prises contre lui. Au cas où le citoyen Marx ne rédigerait pas le Manifeste, le Comité central demande le renvoi immédiat de tous les documents qui lui ont été remis par le congrès » (16).
Si l’on pense que le deuxième congrès de Londres se termina le 8 décembre ; que Marx quitta Londres pour Bruxelles vers le 14 décembre ; qu’Engels le rejoignit à Bruxelles le 17 décembre et retourna à Paris vers le 24 décembre, on peut calculer que les deux amis n’avaient à leur disposition qu’une dizaine de jours pour faire un travail commun. Ce simple calcul permettrait à lui seul, s’il n’y avait pas d’autres raisons plus sérieuses, de prouver que la rédaction définitive du Manifeste est due au seul Marx qui s’est acquitté de sa tâche dans les quelques semaines entre son retour de Londres et la fin de janvier 1848. Pendant la même période, Marx a fait deux ou trois causeries – sur le travail salarié et le capital – au club ouvrier allemand, et une conférence en langue française sur la question du libre-échange devant l’Association Démocratique de Bruxelles (17).
De toutes ces considérations préliminaires il convient de tirer une seule conclusion : La rédaction définitive du Manifeste communiste fut exclusivement l’œuvre de Marx qui s’est inspiré — nous verrons dans quelle mesure — des « Principes du communisme » qu’Engels lui avait sans doute remis lors de leur séjour à Londres (18).
II. — Les « Principes du communisme » de F. Engels.
Extérieurement, le projet d’Engels se présente sous la forme d’un questionnaire comportant vingt-cinq points, dont trois seulement n’ont pas trouvé de réponse. Le manuscrit comprend 21 pages in-octavo. Le texte débute par les définitions du communisme et du prolétariat (19). Le communisme est défini comme la « théorie des conditions de l’affranchissement du prolétariat » ; celui-ci est la « classe sociale qui tire sa subsistance exclusivement de la vente de son travail et non du profit d’un capital quelconque ». Le prolétariat, dont le sort est lié aux caprices du marché du travail, à ses fluctuations et à ses crises, est la classe laborieuse de notre époque.
Suit un bref historique de l’origine du prolétariat (20). S’il y a toujours eu des ouvriers et des pauvres, il n’y a pas toujours eu des prolétaires, qui sont le produit de la révolution industrielle dont les débuts se situent en Angleterre et qui se répand progressivement dans tous les pays civilisés. Cette révolution industrielle fut la conséquence de toute une série d’inventions techniques, machine à vapeur, machine à filer, métier à tisser mécanique, etc. Toute l’industrie passait ainsi entre les mains des gros capitalistes, et le mode de production artisanal fit place au système de la fabrique qui transformait l’ancien artisan en un exécutant d’opérations parcellaires, simples et mécaniques. Ainsi les anciennes classes moyennes ont été ruinées et la stratification antagoniste de la société se poursuit inexorablement, mettant face à face deux nouvelles classes : les capitalistes, détenteurs des instruments de production, et les prolétaires, dépourvus de toute propriété, vivant de la vente de leur travail.
Comment se réalise cette vente du travail ? (21) « Le travail est une marchandise comme toute autre, et son prix s’établit, par conséquent, selon les mêmes lois que celui de toute autre marchandise ». Sous le régime de la libre concurrence, qui est celui de la grande industrie, le prix des marchandises est en moyenne toujours égal au coût de leur production (22). Il s’ensuit que le coût de production du travail n’est autre que le coût des moyens de subsistance nécessaires pour faire vivre et travailler l’ouvrier, qui de ce fait, ne recevra en moyenne ni plus ni moins que ce minimum d’existence : c’est là, selon Engels, la « loi économique du salaire » dont le domaine d’action s’étendra à mesure que la grande industrie s’emparera de toutes les branches de la production.
Engels retrace ensuite l’histoire du travail dans l’antiquité et au moyen-âge (23). Le prolétaire moderne a une existence moins assurée que ne l’avait l’esclave antique et le serf médiéval, mais en tant que membre de la société bourgeoise, il appartient à un stade supérieur du développement de la société. L’esclave s’affranchit en devenant prolétaire, le serf se libère en devenant artisan, ou fermier libre, ou propriétaire. Le prolétaire ne peut s’affranchir qu’en supprimant la propriété privée elle-même, et par suite la concurrence et toutes les distinctions de classe.
Quelles furent les conséquences immédiates et ultérieures de cette révolution industrielle et de cette dichotomie sociale? (24) Tout d’abord, la destruction du système manufacturier, mi-artisanal non seulement dans les pays civilisés, mais encore dans les pays semi-barbares tels que l’Inde et la Chine. « La grande industrie a ainsi mis en contact tous les peuples de la terre, transformé tous les marchés locaux en un vaste marché mondial, préparé partout la civilisation et le progrès, et fait en sorte que tout ce qui arrive dans les pays civilisés doit nécessairement avoir des répercussions sur tous les autres pays. En conséquence, si maintenant les ouvriers se libèrent en Angleterre ou en France, cela doit entraîner des révolutions dans tous les autres pays, qui tôt ou tard auront pour résultat l’affranchissement des ouvriers de ces pays. »
Une autre conséquence du système industriel fut la conquête du pouvoir politique par la bourgeoisie et la disparition des classes jusque là dominantes. A la place de l’État féodal ou corporatif, la bourgeoisie mit l’État représentatif qui lui assurait des privilèges électoraux.
Enfin, parallèlement au développement de la bourgeoisie et du capital, le prolétariat et sa misère vont en augmentant, faisant entrevoir une nouvelle révolution sociale.
Une autre conséquence de la révolution industrielle, ce sont les crises commerciales (25). L’augmentation croissante de la production intensifie la concurrence, les produits surabondants ne trouvent pas d’acheteurs, les industriels font faillite et les ouvriers chôment. A des intervalles presque réguliers, tous les cinq ou sept ans approximativement, des crises éclatent et leur répétition met en danger non seulement tout le système existant, mais la civilisation dans son ensemble. Dès lors, on commence à comprendre la nécessité d’un nouveau régime social pour la venue duquel tous les moyens matériels sont enfin donnés. En effet,, l’abolition du système de la propriété privée n’a pas été toujours possible (26). D’ailleurs, la propriété privée fut à elle-même le résultat d’une évolution historique dans laquelle le développement des forces productives a joué un rôle primordial. La division de la société en classes est étroitement liée à l’insuffisance des forces productives. Celles-ci ont maintenant atteint un degré de développement tel qu’elles brisent les cadres du régime bourgeois et rendent possible la création d’un ordre social nouveau, dans lequel l’association se substitue à la concurrence, l’utilisation collective des moyens de production à la propriété privée de ces moyens, la production suivant un plan commun à l’anarchie du mode de production bourgeois.
Quels seront le caractère et le processus de cette révolution (27). Les révolutions ne sont pas les produits arbitraires de la volonté humaine, des individus ou des classes. Il ne dépend donc pas des communistes que l’abolition de la propriété privée s’opère d’une manière pacifique ou violente. Au demeurant, la révolution prolétarienne ne pourra transformer d’un seul coup la société actuelle. Cette transformation sociale se fera progressivement, au fur et à mesure de l’accroissement des moyens de production. Mais ce n’est qu’après la conquête du pouvoir politique, conséquence de l’instauration du régime démocratique, que le prolétariat pourra réaliser un programme de mesures transitoires susceptibles d’assurer son existence et de préparer le terrain pour la suppression définitive de la propriété privée. Ces mesures auront pour but de limiter de plus en plus l’étendue du droit de propriété privée (impôts progressifs, expropriation progressive des propriétaires fonciers, industriels, etc.), de centraliser les grands moyens productifs et financiers entre les mains de l’État (nationalisation des moyens de transport, des usines, des banques), de supprimer la concurrence des ouvriers (organisation du travail dans les domaines et entreprises nationalisés), travail obligatoire pour tous les membres de la société (constitution d’armées industrielles, particulièrement pour l’agriculture), intensification de l’exploitation des terres, éducation des enfants aux frais de la nation, méthodes d’éducation combinant l’instruction et le travail industriel, construction de grandes cités destinées à des communautés de citoyens travaillant simultanément dans l’industrie et dans l’agriculture et réunissant ainsi les avantages de la vie citadine à ceux de la vie rurale, droit d’héritage égal pour les enfants légitimes et non légitimes.
« Toutes ces mesures ne pourront naturellement pas être réalisées d’un seul coup. Mais l’une entraînera fatalement l’autre. Une fois accomplie la première atteinte radicale à la propriété privée, le prolétariat se verra obligé d’aller toujours de l’avant et de concentrer de plus en plus dans les mains de l’État tout le capital, toute l’agriculture, toute l’industrie, tous les moyens de transports, tout l’échange. C’est vers quoi tendent toutes ces mesures, et elles seront réalisables et développeront leurs effets centralisateurs au fur et à mesure de l’accroissement des forces productives du pays, réalisé par le travail du prolétariat. Enfin, quand tout le capital, toute la production et tous les échanges seront concentrés dans les mains de la nation, la propriété privée tombera d’elle-même, l’argent deviendra superflu, la production sera augmentée et les hommes seront transformés à tel point que les dernières formes de vie de l’ancienne société pourront également disparaître ».
Cette révolution ne pourra s’accomplir dans un seul pays. Dans tous les pays civilisés, le développement social s’est poursuivi plus ou moins au même rythme, les antagonismes sociaux s’y sont approfondis de plus en plus. « La révolution communiste, par conséquent, ne sera pas une révolution purement nationale, elle se produira en même temps dans tous les pays civilisés, c’est-à-dire tout au moins en Angleterre, en Amérique, en France et en Allemagne. Elle se développera dans chacun de ces pays, plus rapidement ou plus lentement, selon que l’un ou l’autre de ces pays possède une industrie plus développée, des ressources plus importantes, une masse plus considérable de forces productives. C’est pourquoi elle sera la plus lente et la plus difficile en Allemagne, la plus rapide et la plus facile en Angleterre. Elle exercera également sur tous les autres pays du globe une répercussion considérable, et transformera totalement ou accélérera énergiquement leur procès d’évolution. Elle est une révolution universelle et aura, par conséquent, un terrain universel ».
Dans les deux points suivants (28), Engels dessine les contours de la future société délivrée de la propriété privée. La prise en charge et l’administration par la société de toutes les forces productives conformément à un plan qui tient compte à la fois des moyens et des besoins de la société, feront disparaître les crises et la misère. Bien plus, tandis que dans la société actuelle la surproduction est une source de pénurie, dans la nouvelle société elle sera la source de nouveaux besoins, et de nouveaux moyens pour satisfaire ces besoins. Industrie et agriculture profiteront sans cesse des progrès de la technique et de la science et cet essor de la production générale sera suivi de la disparition des classes, les besoins de tous pouvant être amplement satisfaits. A l’origine de la division de la société en classes il y a la division du travail. Or la division du travail disparaîtra du fait que non seulement les moyens techniques se transforment constamment, mais aussi les hommes qui les mettent en mouvement.
« La production en commun ne peut s’effectuer par des hommes comme ceux d’aujourd’hui, dont chacun est soumis à une branche particulière de la production, enchaîné à elle, exploité par elle; dont chacun n’a développé qu’une seule de ses facultés, au dépens des autres, et ne connaît qu’une branche ou même qu’une partie d’une branche de la production totale. Déjà, l’industrie actuelle a de moins en moins besoin de tels hommes. L’industrie exercée en commun et suivant un plan par l’ensemble de la société, suppose des hommes dont les facultés sont développées dans tous les sens et qui sont en état de contrôler tout le système de la production. La division du travail, déjà minée par le machinisme, et qui fait de l’un un paysan et de l’autre un cordonnier, du troisième un ouvrier d’usine, du quatrième un spéculateur à la Bourse, disparaîtra donc complètement. L’éducation fera traverser rapidement aux jeunes gens tout le système de la production, et elle les mettra en état de passer successivement de l’une à l’autre des diverses branches de la production, suivant les besoins de la société ou leurs propres inclinations. Elle leur enlèvera, par conséquent, le caractère unilatéral que leur imprime l’actuelle division du travail. De cette manière, la société organisée sur la base communiste donnera à ses membres l’occasion d’exercer dans tous les sens leurs facultés universellement développées. Il en résulte nécessairement qu’en même temps disparaîtront les diverses classes, de sorte que la société communiste, d’une part, est incompatible avec l’existence des classes, et, d’autre part, fournit elle-même les moyens de supprimer ces différences de classes ».
Un autre résultat important de la suppression de la propriété privée sera la disparition de l’opposition entre la ville et la campagne, de l’infériorité sociale de la femme par rapport à l’homme, de la prostitution, de la communauté des femmes qui caractérise la société actuelle, de l’actuel mode d’éducation des enfants.
Les deux derniers points du projet d’Engels traitent des soi-disant socialistes et de la position des communistes vis-à-vis des autres partis politiques (29). Engels distingue trois sortes de pseudo-socialistes : les socialistes réactionnaires, les socialistes bourgeois et les socialistes démocratiques. Les premiers voudraient éviter les maux de la société actuelle par le retour à la société féodale et patriarcale ; les seconds proposent des réformes grandioses ou charitables pour guérir ces maux, tout en maintenant intacte la société qui les engendre; les troisièmes, ignorant les conditions de l’affranchissement du prolétariat auquel ils appartiennent, considèrent les mesures transitoires préconisées par les communistes comme moyen de supprimer la misère actuelle. Une entente entre les communistes et cette dernière catégorie de socialistes est toutefois possible.
En ce qui concerne la position des communistes à l’égard des autres partis politiques existants, elle varie selon les différents pays. Dans les pays où la bourgeoisie est déjà solidement installée au pouvoir (en Angleterre, France, Belgique, par exemple), les communistes font campagne commune avec les partis démocratiques qui défendent les intérêts du prolétariat. Ainsi en Angleterre les communistes devront s’allier aux chartistes, et en Amérique aux réformateurs agrariens, afin de mener la lutte ensemble contre la bourgeoisie. En Allemagne, cependant, où la bourgeoisie lutte encore contre la monarchie absolutiste, les communistes aideront la classe bourgeoise à conquérir le pouvoir, ce qui entraînera pour eux des avantages certains, particulièrement la propagande de leurs idées, et partant « la constitution du prolétariat en une classe fermement unie, prête à la lutte et bien organisée ». L’absolutisme une fois abattu, la véritable lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat commencera et la politique de parti des communistes prendra les mêmes formes que dans les pays où la bourgeoisie exerce déjà le pouvoir.
Tels sont, exposés dans leurs grandes lignes, les Principes du communisme que F. Engels rédigea hâtivement en octobre 1847, et qu’on peut retrouver, entièrement refondus et vivifiés par le génie titanesque de Marx, dans le Manifeste communiste de février 1848. Si, néanmoins, Engels a tenu à rappeler avec insistance que la pensée fondamentale du Manifeste avait pour seul auteur Marx, c’est qu’il savait que son propre projet n’était entré que pour la moindre part — un cinquième environ — dans la géniale construction de son ami.
III. La théorie éthico-matérialiste de l’histoire.
Quelle est cette « pensée fondamentale et directrice » du Manifeste, selon Engels ? Ce dernier l’a résumée sous la forme de quelques thèses, en tête de l’édition allemande du Manifeste, dans la préface écrite un an après la mort de Marx :
« La production économique et la structure sociale qui en découle nécessairement à chaque époque historique forment (30) la base de l’histoire politique et intellectuelle de cette époque. Il s’ensuit que (depuis la dissolution de la commune agraire primitive) toute l’histoire a été l’histoire de luttes de classes, de luttes entre classes exploitées et classes exploiteuses, entre classes dominées et classes dominantes, aux différents stades de l’évolution sociale. Mais cette lutte en est arrivée aujourd’hui à une phase où la classe exploitée et opprimée (le prolétariat) ne peut plus se libérer de la classe qui l’exploite et l’opprime (la bourgeoisie), sans affranchir en même temps et pour toujours la société tout entière de l’exploitation, de l’oppression et des luttes de classes ».
Engels précise, dans une note, que c’était dans ces termes que Marx lui avait exposé, au printemps 1845, la théorie matérialiste de l’histoire (31).
Il est certain que toutes ces idées qui, d’après Engels constituent dans leur ensemble le contenu essentiel de la conception matérialiste de l’histoire, se retrouvent, bien qu’énoncées plus succinctement, dans le Manifeste communiste. D’ailleurs, Marx a lui-même pris soin de raconter comment, dès 1844, ses recherches entreprises à l’occasion d’une révision critique de la Philosophie du droit de Hegel, l’avaient amené à concevoir une nouvelle théorie de l’histoire, en partant du principe qu’il fallait chercher l’anatomie de la société bourgeoise dans son économie politique. Cette indication donnée par Marx en 1859 (32) sur la nature et le résultat de ses recherches de 1844, nous paraît avoir une importance d’autant plus décisive qu’elle bouleverse jusque dans leurs fondements les conceptions et interprétations que les diverses écoles marxistes ont pu formuler à propos du matérialisme historique, étant donné que ces formulations ont dû nécessairement ignorer les écrits marxiens de 1844, 1845 et 1846, restés inédits jusque vers 1927-1932.
Jusqu’alors, la conception matérialiste de l’histoire ne pouvait être dégagée que d’un nombre restreint de textes artificiellement tirés des divers ouvrages et écrits de Marx et Engels, si l’on excepte les cinquante lignes de la Préface de 1859, lesquelles, pendant une cinquantaine d’années, ont dû fournir leur maigre substance à une véritable Babel d’interprétations, commentaires, exégèses et hypothèses. On ne pouvait pas savoir que les Thèses sur Feuerbach, écrites en 1845 et publiées en 1889 (par Engels), étaient le résumé magistral, sous une forme aphoristique, de l’énorme Idéologie allemande écrite en 1845-46 et abandonnée par leurs auteurs à la « critique rongeuse des souris », faute d’éditeur (33). Quant à la lettre de Marx à Annenkov datée de fin 1846, et que son destinataire ne rendit publique qu’en 1912 (34), on pouvait en retrouver la trame dans la Misère de la Philosophie, publiée en 1847.
En tenant compte de cet état de choses, on peut aisément comprendre pourquoi presque tous les jugements émis pendant si longtemps au sujet de la véritable portée de la théorie matérialiste de l’histoire ont abouti à la même conclusion, encore aujourd’hui généralement répandue et acceptée comme définitive: le matérialisme historique, c’est essentiellement une méthode d’investigation à l’usage de l’historien, du sociologue ou de l’économiste. N’avait-on pas la meilleure démonstration de cette thèse dans l’exemple de Marx lui-même, qui avait « appliqué » sa propre méthode dans des écrits comme Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Les Luttes de classes en France et surtout dans Le Capital, où l’aspect dialectique de la méthode du matérialisme historique est particulièrement mis en lumière ?
Les rectifications et les avertissements formulés par Engels, après la mort de Marx, pour aider ses jeunes disciples à saisir la vraie signification de la conception matérialiste de l’histoire étaient loin de pouvoir fournir la clef du problème et dissiper les malentendus et exagérations que le marxisme naissant risquait d’accumuler par sa tendance à dogmatiser les idées du maître (35). Et c’est ainsi que, au lendemain de la disparition d’Engels, la « querelle de Marx » commença son orageuse carrière dont on ne peut encore prévoir la fin.
Ce Streit um Marx apparaît aujourd’hui, rétrospectivement, comme un phénomène d’autant plus naturel que l’oeuvre de Marx se présente en grande sinon en majeure partie comme une œuvre posthume dont on commence seulement à percevoir et à mesurer toute l’ampleur (36).
On ne saurait, sans répéter et multiplier les erreurs passées, négliger ce fait, aujourd’hui patent, lorsqu’on s’efforce de scruter les divers aspects de ce qu’on appelle, depuis Engels, — Marx n’employait pas ce terme équivoque — le « matérialisme historique ». C’est uniquement en saisissant l’inspiration et l’orientation fondamentales de l’ensemble de l’œuvre de Marx qu’on sera en mesure de se faire une idée exacte de ce qui, dans la conception matérialiste de l’histoire et sans en altérer le caractère de théorie TOTALE, peut, à juste titre, en être dégagé pour fournir les éléments d’une méthode scientifique d’exploration du champ total de l’évolution historique des sociétés humaines.
C’est Marx lui-même qui, dans un document dont aucune variante du marxisme n’a encore compris toute l’importance, a pris la peine d’esquisser les grands traits d’une méthode rationnelle de sociologie. Écrit en 1857 pour servir d’introduction à sa Critique de l’Economie politique, il fut mis de côté par son auteur soucieux de ne pas dérouter son lecteur par des anticipations sur des résultats qui restaient à prouver. Publiée en 1903 par Kautsky, l’Introduction de 1857 constitue avec la Postface à la 2e édition du Capital de 1873 l’exposé le plus clair de cette dialectique rationnelle que Marx se vantait d’avoir découvert derrière le voile mystificateur de la dialectique hégelienne.
Nous n’avons pas, ici, pour tâche de développer ce thème. Pour notre sujet, il suffit de souligner que l’exposé de la méthode dialectique marxienne est non seulement chronologiquement, mais encore génétiquement postérieur à la formulation de la théorie matérialiste de l’histoire.
Si donc Engels identifie la pensée maîtresse du Manifeste communiste à cette théorie dont il définit, comme nous l’avons vu, les données essentielles, sans faire la moindre allusion à des problèmes de méthodologie quelqu’ils soient, si, par ailleurs, il tient à englober dans ces données non seulement le déterminisme économique et les luttes de classes en tant que facteurs constants de l’histoire devenue, mais encore les postulats d’une détermination consciente de l’histoire en devenir, c’est qu’il reconnaît avec juste raison la structure ambivalente de la conception marxienne de l’histoire. Le Manifeste communiste, composé un an environ après les Thèses sur Feuerbach — quintessence de l’éthique marxienne, — révèle mieux que n’importe quel autre écrit de Marx cette ambivalence structurelle de ce qu’Engels a baptisé improprement le « matérialisme historique ».
En vérité, toute l’originalité de la pensée marxienne — originalité dont le Manifeste est l’expression la plus vigoureuse — réside dans la substitution aux doctrines ou systèmes idéologiques (religieux, philosophiques, économiques ou politiques) que Marx avait rencontrés, d’un enseignement total dont la structure intime se caractérise par une synthèse parfaite de jugements rationnels et de jugements de valeur, de science et d’éthique.
Si ce caractère de l’enseignement de Marx est moins apparent dans ses écrits postérieurs au Manifeste que dans ses travaux dits « de jeunesse » — qui témoignent de l’incomparable précocité de son génie — il n’en reste pas moins le trait fondamental de toute son œuvre « mûre » et notamment du Capital, qui est autant une critique scientifiquement fondée de l’Economie politique — comme l’indique son sous-titre — qu’un monument éthique élevé à la souffrance imméritée des classes laborieuses modernes.
Ce sont indéniablement ces écrits « de jeunesse » que Marx eut en vue, lorsque, dix ans après la publication du Manifeste, il dressa le bilan de ses recherches faites durant les années 1843-1847, aux bibliothèques de Paris et de Bruxelles, recherches qui — on ne saurait le répéter assez — l’avaient conduit à rejeter Hegel et à se séparer de ses épigones, et à jeter les bases d’une nouvelle conception de l’histoire dont il voulait qu’elle fût à la fois une théorie interprétative du processus historique et un instrument éthique de la création historique, et dont il empruntait les éléments constitutifs chez Hegel comme chez Vico et Montesquieu, chez Feuerbach comme chez Helvetius et Holbach, chez Spinoza comme chez Bentham et Locke.
En abordant la critique de l’économie politique, Marx a amplement fait usage des critères éthiques nécessairement impliqués dans cette vision nouvellement construite de l’évolution historique. On n’a qu’à se rapporter aux notations qu’il a faites dès 1844, au cours de ses lectures des grands économistes, à ses Manuscrits économico-philosophiques de la même période, et même à l’Idéologie allemande, pour constater comment Marx, insatisfait des travaux critiques d’un Bray ou d’un Proudhon, envisageait de formuler sa propre position théorique en abandonnant le cadre même de l’économie politique et en choisissant ses critères critiques parmi les valeurs d’un régime socialiste imaginaire, d’un état futur de non-aliénation de l’homme (37). Le fait que Marx ait considéré rétrospectivement les écrits inédits de cette période comme une Selbstverständigung, c’est-à-dire une sorte de tentative de se mettre en règle avec sa conscience philosophique, ne doit pas faire oublier que ce n’est pas de bon gré qu’il a renoncé à les publier, mais qu’il lui était difficile de trouver un éditeur. Certes, ses scrupules d’auteur et de scrutateur l’empêchaient de faire imprimer des travaux dont il n’avait pas la conviction qu’ils étaient définitifs : Ce fut le cas précisément de ses premiers manuscrits économiques dont il disait, dans un avant-propos, que les résultats en avaient été acquis « grâce à une analyse purement empirique, fondée sur une étude critique consciencieuse de l’économie politique ». Ce travail a fait l’objet d’un contrat que Marx avait signé dès février 1845 avec un éditeur allemand qui, après un an de vaine attente, rompit ses engagements (38).
C’est dire que Marx considérait vraisemblablement cette ébauche critique comme suffisante, parce qu’il croyait alors à un effondrement proche du capitalisme dans les pays où l’industrie avait atteint un degré relativement élevé de développement, – notamment en Angleterre, – et à l’arrivée proche de la société socialiste. Indubitablement, ce fut cette erreur de perspective — aussitôt démontrée par l’échec des mouvements révolutionnaires de 1848 — qui l’amena à se consacrer désormais à de vastes études économiques, sur le « lieu classique » du mode de production capitaliste: l’Angleterre. Car il ne s’agissait plus de prédire la fatalité de la chute du régime capitaliste — ce que Sismondi avait fait avant Marx — mais de découvrir la « loi naturelle » de ce mouvement vers la catastrophe, autrement dit de formuler more geometrico « la loi économique du mouvement de la société moderne » (39).
L’effondrement du capitalisme est prédit dans le Manifeste communiste aussi catégoriquement que le triomphe du socialisme. Mais, ainsi que les développements précédents le suggèrent, ces deux inéluctabilités ne sont pas du même ordre. En effet tandis que l’effondrement du capitalisme repose sur une nécessité économique inhérente au système, la montée du socialisme se fonde sur un postulat éthique: l’autoémancipation du prolétariat.
Le Manifeste communiste n’est rien d’autre que cet appel au socialisme en regard de l’inéluctable déchéance du mode capitaliste de production et de la société qu’il implique. Le fait même que Marx ait lancé ce message, et la forme qu’il lui a donnée prouvent qu’il ne concevait pas le socialisme comme l’aboutissement fatal de l’économie bourgeoise. En dehors de cette prise de conscience totale, passionnelle et active, par la classe des opprimés, il n’est pas de salut socialiste, — mais certainement la chute dans une nouvelle barbarie, nouvelle forme de la préhistoire humaine (40).
Ainsi donc, l’avènement du socialisme requiert simultanément un certain développement — que Marx qualifie de « total » — des forces productives et la transformation parallèle, l’épanouissement universel des facultés du travailleur dans et par le mouvement même de son autoémancipation révolutionnaire.
Conclusion
Il n’y a rien de surprenant à ce que le Manifeste communiste soit aujourd’hui plus actuel qu’il ne le fut il y a cent ans, au moment de sa publication. Les perspectives tracées par ses auteurs étaient valables pour une phase avancée du développement industriel, et nous savons maintenant que depuis la disparition de Marx et d’Engels il s’est accompli ce qu’on appelle non sans raison la seconde révolution industrielle, entraînant des changements profonds aussi bien dans la structure économique que dans l’organisation politique des États. La concentration croissante du pouvoir économique et du pouvoir politique entre les mains de l’État, — phénomène que Marx a prédit avec un savoir quasi mathématique, — le rôle toujours plus important que les organes représentatifs des classes laborieuses jouent dans ce procès de la pénétration progressive de la puissance économique dans l’appareil étatique, tous ces faits ont pu pendant certaines périodes stimuler l’optimisme dans les rangs des théoriciens marxistes qui voyaient se confirmer les thèses établies par Marx dans son élaboration de la théorie du mode de production capitaliste. Mais ces optimistes ont confondu et continuent à confondre la loi économique du mouvement de la société capitaliste énoncée par Marx, avec le postulat éthique de la transformation psychique des travailleurs, proclamé par le même Marx comme la condition nécessaire de la révolution socialiste.
Ainsi l’optimisme marxiste repose sur une incompréhension totale de cette conception éthico-matérialiste de l’histoire, qui a trouvé en Marx son théoricien le plus génial et qui constitue l’idée maîtresse du Manifeste communiste. Quand même Marx et Engels n’auraient pas expressément déclaré en 1872 que le programme des nationalisations et étatisations formulé dans le Manifeste — programme dont il ne faut pas oublier qu’il fut principalement l’œuvre d’Engels — avait besoin d’être révisé, notamment après l’expérience de la Commune ; quand même Marx n’aurait pas formellement condamné le socialisme d’État, dont Ferdinand Lassalle s’était fait le champion en Allemagne, nous savons maintenant que la pensée marxienne sur l’État avait dès 1845 atteint son état d’achèvement, après s’être libérée de l’emprise de la philosophie politique de Hegel. Cette pensée se trouve condensée dans la phrase finale du manuscrit sur Feuerbach, qui forme la première partie de l’Idéologie allemande : « Pour faire valoir leur personnalité, les prolétaires doivent anéantir leur propre condition d’existence, — qui est aussi celle de toute l’ancienne société, — le Travail. Ils se trouvent donc par là-même en opposition directe avec la forme dans laquelle les individus de la société ont jusqu’ici manifesté leur personnalité : l’État. Ils doivent abolir l’Etat, afin d’affirmer leur personnalité ».
« Là où finit l’Etat, là seulement commence l’homme qui n’est pas superflu » — tel fut le chant qui retentit de la bouche de Nietzsche, l’année même où mourut Marx.
Marx nous a fourni l’instrument scientifique pour saisir le processus d’évolution qui, en l’absence de l’action socialiste, mène inéluctablement de la société libérale à la société totalitaire. Le socialisme n’est pas qu’un problème d’analyse et de dialectique. Sa réalisation ne dépend pas non plus du seul développement des forces matérielles.
Engels lui-même a tranché ce problème pour les générations à venir, en écrivant:
« Marx, pour le triomphe des principes du Manifeste, se fiait exclusivement au développement intellectuel de la classe ouvrière, tel qu’il devait nécessairement résulter de l’action commune et de la discussion. »
(1) Cf. Daniel Villey, Petite Histoire des grandes doctrines économiques, p. 191. Cette affirmation a été répétée par Jean Lacroix écrivant que «le premier écrit de Marx qui traite d’économie politique » fut le Manifeste. (Cf. Le Monde, 11-7-47).
(2) Voici la liste des auteurs cités par Marx dans l’Anti-Proudhon : Sismondi, Lauderdale, Ricardo, Anderson, Storch, A. Smith, Boisguillebert, Atkinson, Hodgskin, W. Thompson, Edmonds, Bray, J. St. Mill, Tooke, Cooper, Sadler, de Villeneuve-Bargemont, Lemontey, Ferguson, Babbage, Ure, Rossi, Petty, J. Stuart, Cherbuliez. On retrouve presque tous ces noms dans le Capital.
(3) Cf. D. RIAZANOV, Introduction historique au M.c., A. Costes, éd., Paris 1934.
(4) C’est également au cours de cette période que furent composés les quatre ou cinq manuscrits qui forment l’Idéologie allemande.
(5) Cf. Karl MARX, Révélation sur le procès des communistes à Cologne. Introduction: Quelques mots sur l’histoire de la Ligue des Communistes, par Frédéric Engels, 1885. (Trad. J. Molitor, A. Costes, éd.).
(6) o. c.
(7) Cf. lettre d’Engels à Marx du 20 janv. 1845.
(8) V.G. Mater, Friedrich Engels, Une biographie, I, p. 241. (En allem.).
(9) Il en existe une version française par M. Ollivier. (Bureau d’Editions, Paris, s. d.). Par contre, le Projet d’une Profession de foi Communiste figurant parmi les annexes ajoutés par J. Molitor à sa traduction du Manifeste (A. Costes, éd.) n’a rien de commun avec le projet de F. Engels, excepté les questions. J. Molitor n’indique pas la source d’où il a tiré les réponses.
(10) Ce qui ressort de l’appel publié par la Kommunistische Zeitschrift paru à Londres en septembre 1847, à l’initiative des membres londoniens de la Ligue communiste. Riazanov y voit le « premier journal ouvrier marxiste ». Un seul numéro en a paru. V. annexe II du Manifeste communiste, A. Costes, éd. pp. 135-182.
(11) V. Moses Hess et la Gauche hégélienne, par A. Cornu, Paris, 1934.
(12) Au cours des derniers mois de 1847 et au début de 1848, Marx et Engels vécurent séparés, l’un à Bruxelles, l’autre à Paris.
(13) Moses Hess.
(14) La ligue était organisée en sections (Kreise) et en communes (Gemeinden). Chaque section comprenait au minimum deux et au maximum dix communes.
(15) Cf. Préface au M. c., 1872, signée par Marx et Engels.
(16) La lettre du Comité central a été retrouvée par Riazanov qui l’a remise à Frantz Mehring. On peut en voir le fac-similé dans F. Mehring, Karl Marx, Geschichte seines Lebens, 5-e éd., 1933, p. 171.
(17) De ses causeries faites au club ouvrier, Marx a tiré la matière de ses articles parus en avril 1849 dans la Neue Rheinische Zeitung et publiés plus tard comme brochure sous le titre « Travail salarié et Capital ». Le « Discours sur la question du libre échange » fut imprimé aux frais de l’Association Démocratique, Bruxelles, 1848.
(18) F. Mehring s’exprime ainsi sur l’étendue de la collaboration des deux amis : « Pour autant que le style permet de juger, Marx a eu la plus grande part dans l’élaboration de la forme définitive, bien qu’Engels, comme le montre son projet ne lui fût pas inférieur, quant au niveau de ses connaissances. Il doit être considéré, au même titre que Marx, comme co-auteur du Manifeste. »
(19) Questions 1 et 2.
(20) Questions 3 et 4.
(21) Question 5.
(22) On voit combien Engels était alors encore loin de s’être assimilé la critique des théories ricardiennes formulée par Marx dans ses premiers écrits économiques.
(23) Questions 6, 7, 8 et 9, la question 9 (« par quoi le prolétaire se distingue-t-il de l’artisan ») étant restée sans réponse.
(24) Question 11.
(25) Questions 12 et 13.
(26) Questions 14 et 15.
(27) Questions 16, 17, 18 et 19.
(28) Questions 20 et 21.
(29) Questions 24 et 25. En face des questions 22 (« Comment l’organisation communiste se comportera-t-elle vis-à-vis des nationalités existantes ? ») et 23 (« Comment se comportera-t-elle vis-à-vis des religions existantes »), Engels a noté : « peut rester ». Cette remarque se rapporte vraisemblablement soit au projet (non retrouvé) du Comité central, soit à celui de Moses Hess dont il a été question plus haut.
(30) Engels emploie le verbe au singulier (« bildet »), mais ce n’est peut-être pas là un simple solécisme, les deux sujets de la phrase voulant signifier l’infra-structure de la société.
(31) De même, on lit dans l’Introduction d’Engels aux Révélations... de Marx: « Lorsqu’en été 1844 j’allai voir Marx à Paris, nous constatâmes notre complet accord dans toutes les questions théoriques, et c’est de cette époque que date notre collaboration. Quand nous nous retrouvâmes à Bruxelles, au printemps 1845, Marx avait déjà… construit, dans les grandes lignes sa théorie matérialiste de l’histoire, et nous nous mîmes à développer par le détail et dans les directions les plus diverses notre nouvelle conception ».
(32) V. Préface à la Contribution à une Critique de l’Economie politique.
(33) Lorsque F. Engels, en 1888, se mit à rechercher et à regarder le manuscrit de l’Idéologie allemande afin d’y puiser des éléments pour son essai sur Feuerbach, il n’y trouva plus rien qui lui eût semblé digne d’être publié, sans excepter la partie exposant la conception matérialiste de l’histoire. La lecture de ce chapitre, publié par Riazanov dans les Archives Marx-Engels I (1926) montre à quel point Engels était mal inspiré lorsqu’il rejeta le vieux manuscrit pour laisser les souris continuer leur œuvre…
(34) En russe. En 1913, la lettre parut en français et en allemand.
(35) V. les lettres d’Engels à C. Schmidt, J. Bloch et F. Mehring. C’est devant ce dernier qu’Engels a fait son mea culpa, avouant avoir été « complice » dans la déformation de la théorie marxienne. A ce sujet, nous ne saurions assez recommander la lecture du livre de R. Mondolfo, Le Matérialisme historique (Giard, éd., 1917).
(36) Le cadre de cet essai ne nous permet pas de développer ce thème qui fera l’objet d’une étude ultérieure.
(37) V. mon article sur « Marx lecteur » et ma traduction de « Travail aliéné » de Marx dans La Revue socialiste> de novembre 1946 et février 1947.
(38) Ce fut Leske, éditeur à Darmstadt. En janvier et février 1845, Engels harcelait son compagnon pour qu’il achevât son « livre économico-politique » et en annonça la prochaine publication dans The New Moral World dont il était le correspondant pour l’Europe. Dans sa lettre à Annenkov (déc. 1846), Marx regrette de ne pouvoir lui envoyer son « livre sur l’économie politique », n’ayant pu le faire imprimer.
(39) Préface à la 1° édition du Capital. Une anticipation d’une des principales idées développées dans cet ouvrage se trouve dans le manuscrit inachevé et inédit de 1846, sur le « Travail salarié », où Marx énonce la « loi générale » de la composition organique du capital.
(40) Un exemple typique de la négligence systématique du facteur humain dans le devenir du socialisme nous est fourni par Hendryk Grossmann (« La loi de l’accumulation et de l’effondrement du système capitaliste »). Cet auteur considère la théorie scientifique de l’effondrement capitaliste comme une preuve suffisante de l’inévitabilité du socialisme. On lira avec profit la brochure de Tomori, Qui succédera au Capitalisme ? (Collection Spartacus). L’auteur y pose le problème, ce qui est déjà beaucoup. Les autres ne le> voient même pas…
[+ pdf]
Pour une Biographie Monumentale de Karl Marx (Rubel, 1950)
24 avril 2013Paru dans «La Revue Socialiste» n°40 (octobre 1950).
Parmi les nombreux livres parus en France au cours de ces dernières années et consacrés à Marx et à son oeuvre, on a pu en remarquer plusieurs qui visent tout particulièrement l’homme, son caractère, sa personnalité. Tout récemment encore, deux biographies de Marx ont paru en librairie, celle de Léon Schwarzchild, traduit de l’anglais (1), et l’autre de C. J. Gignoux (2). Ce fait pourrait surprendre. En effet il y aura bientôt soixante-dix ans que l’auteur du Capital est mort et les travaux dont certains sont assez remarquables, sur sa vie et sa carrière littéraire, n’ont pas manqué. La figure humaine et spirituelle de Marx serait-elle donc malgré tout insuffisamment éclairée et sondée, pour que les tentatives d’en tracer un portrait plus véridique paraissent naturelle ? Et est-ce bien à un mobile aussi légitime qu’obéissent, par exemple, les auteurs mentionnés, en nous donnant leur vérité sur Marx ? La vérité a-t-elle gagné à leur travail ?
Nous ne le pensons pas. Nous ne pensons pas que le dénigrement systématique soit de rigueur dans les travaux qui relèvent du genre biographique. Il l’est aussi peu que l’idolâtrie systématique. Mais n’est pas biographe qui veut. Les livres de M. Schwarzschild et de M. Gignoux ne s’imposaient pas, ce qu’ils ont écrit n’est pas nouveau, cela ne fait que renouveler les phénomènes signalés par Engels sur la tombe de son ami par ces mots : « Marx fut l’homme le mieux haï et le mieux calomnié de son temps ». Leurs livres ne comblent pas l’immense lacune que présente la littérature biographique qui continue à nous priver du seul portrait digne de l’homme et de l’esprit que fut Marx, ce portrait ne pouvant être que monumental.
I
Karl Marx est du petit nombre de ceux dont il est juste d’affirmer que l’essentiel de leur vie est dans leur oeuvre. Mais parmi les oeuvres qui ont marqué dans le destin de notre monde rares sont celles qui ont connu un sort semblable à celle de Marx. La réimpression, après sa mort, de ses très nombreux et très divers écrits tombés dans l’oubli, et la publication à titre posthume, de l’énorme masse de ses manuscrits économico-politiques et philosophiques font apparaître l’ensemble de l’oeuvre marxienne comme une oeuvre en majeure partie posthume. Or, ces réimpressions et ces publications, réalisées à des intervalles plus ou moins longs, s’étendent sur une période de plus de cinquante ans, et aujourd’hui, en 1950, donc presque 70 ans après la mort de Marx, nous n’avons pas encore une édition intégrale de ses oeuvres, établie selon des méthodes critico-scientifiques (3). Cette seule constatation peut expliquer pourquoi les biographies de Marx sont relativement rares, surtout lorsqu’on compare leur nombre aux masses immenses de monographies consacrées aux divers aspects de son enseignement théorique et de sa carrière politique. Aucun biographe scrupuleux, tenté d’éclairer la vie de Marx et sachant que cette vie s’était manifestée essentiellement dans son œuvre, ne pouvait aborder sa tâche avant d’en connaître toute l’ampleur et avant de disposer de tous les matériaux offrant les éléments indispensables à la reconstitution littéraire de la figure totale de son héros. Rien de plus logique alors, que l’idée d’une biographie de Marx se soit présentée tout d’abord à Friedrich Engels, héritier du legs spirituel de son ami, peu après la mort de celui-ci (4). Mais ce projet, Engels ne pouvait en envisager l’exécution qu’après s’être acquitté d’une tâche plus urgente, celle de publier l’œuvre inédite de Marx, et on sait que, contrairement à ses propres calculs, il a fallu qu’il donnât toutes les années qui lui restaient encore à vivre à la publication non pas de l’intégralité des manuscrits marxiens mais d’une partie, importante certes, de ceux-ci. Après la mort d’Engels, puis après la disparition d’Eleanor Marx-Aveling, chacun des exécuteurs testamentaires désignés par l’un ou par l’autre nourrissaient plus ou moins secrètement, et non sans un esprit de jalousie, l’espoir d’écrire tôt ou tard la biographie de Marx (5). Incontestablement, Franz Mehring, par ses dons stylistiques et sa culture littéraire était, dans cette équipe, le plus qualifié pour une telle entreprise, bien que Karl Kautsky et Edouard Bernstein, qui avaient vécu dans l’intimité d’Engels, lui fussent supérieurs en tant que théoriciens économistes. Quoiqu’il en soit, les luttes idéologiques déclenchées dans la social-démocratie allemande par la campagne dite « révisionniste » de Bernstein n’étaient pas de nature à faciliter et à favoriser la collaboration des trois meilleurs disciples d’Engels en vue des tâches littéraires qui leur étaient, en somme, communes. Néanmoins, Mehring put donner la mesure de ses qualités d’éditeur et de biographe de Marx, lorsqu’il fit paraître en 1902 les 4 volumes du Legs littéraire de Karl Marx, F. Engels et F. Lassalle, riches en introductions et commentaires historiques. Dès lors Mehring fit preuve d’un esprit critique qui ne pouvait pas manquer de mécontenter des marxistes aussi orthodoxes que Kautsky et, plus tard, D. Riazanov. Il est probable que Mehring était alors persuadé qu’il allait devenir le biographe, pour ainsi dire attitré de Marx, ce dont témoignent certains de ses essais de caractère biographique publiés dans la Neue Zeit et surtout sa critique malveillante du livre du marxiste américain John Spargo : Karl Marx, sa vie et son oeuvre, ouvrage qui fut indéniablement le premier et, vu l’état dans lequel se trouvait à ce moment la publication des oeuvres de Marx, le plus important document biographique dans son genre publié jusqu’alors (6). Mehring lui-même ne publia sa biographie de Marx qu’en 1918, sans tenir compte de l’opposition des « deux gardiens du Sion marxiste » Kautsky et Riazanov qui lui reprochèrent d’avoir blâmé l’attitude injuste que Marx avait souvent eue envers Bakounine et Lassalle (7). Le livre de Mehring, en dépit de son évidente supériorité sur celui de Spargo et malgré ses 600 pages n’est, de l’aveu même de l’auteur, qu’une esquisse biographique, destinée à un large public, surtout ouvrier, la présentation et l’analyse de l’oeuvre marxienne y étant moins que sommaire (8). La correspondance de Marx et d’Engels dont Mehring avait pu prendre connaissance encore avant la parution de l’édition réalisée par Bernstein et Bebel, fut une des sources majeures qui livrait à Mehring les traits intimes de la personnalité de Marx, mais le biographe se faisait scrupule de garder la discrétion sur certains passages des lettres de son héros, supprimés par les éditeurs soucieux de respecter le voeu exprimé par Laura Lafargue de ne pas étaler au grand jour les petitesses d’esprit et de coeur dont son père aimait à se décharger devant son meilleur ami (9). Il convient de signaler ici qu’en même temps que Marx avait trouvé en Mehring son premier biographe compréhensif, Engels allait trouver le sien en la personne de Gustav Mayer, remarquable chercheur et historien, qui sut utiliser judicieusement les richesses des archives Marx-Engels conservées par le parti social-démocrate allemand (10).
On ne saurait en dire autant d’un autre biographe de Marx, Otto Rühle qui, imitant l’exemple de Mehring, adversaire du « culte de Marx », désirait innover cette attitude critique par le recours à des méthodes psychanalytiques inspirées de l’école adlérienne (11). Rühle rend justice à la grandeur de l’oeuvre marxienne, mais le portrait qu’il fait de Marx est d’une extrême pauvreté psychologique et relève du genre journalistique de mauvais aloi : le secret du génie de Marx il en découvre la clef dans l’ascendance juive, la position de fils aîné et la maladie hépatique de son héros. Rühle trouvera à son tour des imitateurs, mais ceux-ci le dépasseront de loin dans le genre médiocre et superficiel.
Des trois biographies de Marx dont nous venons de parler, aucune ne s’élève au-dessus du niveau de la littérature de vulgarisation, toutes se contentant en appréciant diversement la personnalité et l’oeuvre de Marx, d’en esquisser les traits saillants. Mais ce qu’elles ont surtout en commun, c’est d’avoir été écrites avant la publication, de 1927 à 1935, des 11 volumes (sur 40 !) de l’édition historico-critique des oeuvres complètes de Marx et d’Engels, entreprise par Riazanov (12). De nombreux matériaux figurant dans ces volumes sont donc restés ignorés et inutilisés aussi bien par Spargo (1910) et Mehring (1918) que par Rühle (1928). Pour se faire une idée des perspectives qui s’ouvraient désormais aux biographes désireux d’étudier la vie et la pensée de Marx, il suffit de rappeler que la seule période et l’oeuvre de jeunesse de celui-ci ont pu fournir la matière biographique et idélogique de plusieurs monographies importantes parmi lesquelles celles d’Auguste Cornu (13), de Luc Somerhausen (14) et de G. Pishel (15) occupent un rang de choix. Par ailleurs, le Karl Marx de B. Nicolaïevski et O. Maenchen-Helfen (16), ouvrage fondé sur des documents historiques passés inaperçus, représente sans doute le meilleur portrait qui nous ait été tracé jusqu’ici du lutteur politique que fut Marx.
En laissant de côté d’autres travaux de moindre valeur (17), nous croyons avoir épuisé la liste des biographies de Marx qui, si elles n’atteignent pas le niveau de l’ouvrage analogue écrit par G. Mayer sur Engels, sont cependant les meilleures qui aient été publiées jusqu’à présent.
Que reste-t-il à dire des entreprises du genre de MM. Vène (18), Schwarzschild ou Gignoux ? Peu de chose, nous y reviendrons. C’est à une autre question que nous voudrions d’abord répondre : que doit être une biographie de Marx qui mériterait son titre ?
II
En 1934 l’Institut Marx-Engels-Lénine de Moscou publia une chronique de la vie de Marx comprenant plus de trois mille dates se rapportant aux faits et aux évènements importants de son existence et de son activité littéraire et politique (19). Il n’est pas exagéré de dire qu’aucune biographie sérieuse de Marx ne peut désormais se passer de l’inappréciable instrument de travail que représente cette publication. L’ouvrage étant devenu introuvable en librairie, — comme d’ailleurs l’ensemble des volumes de la Marx-Engels-Gesamtausgabe (20) — nous allons en retracer le plan d’après la table des matières.
La chronique distingue 18 phases dans la vie de Marx et note pour chacune d’elles les faits significatifs, dont elle indique, autant que possible, la date précise, jour, mois et année. Votons les diverses phases et leurs principaux moments :
I. 5 Mai 1918 – mi-avril 1841 : Ecole ; Université de Bonn ; Université de Berlin ; Club des Docteurs ; Etudes de Hegel ; Les « Athénéens » ; Thèse pour le Doctorat.
II. Mi-Avril 1841 – fin Mars 1843 : Bruno Bauer ; Projets de professorat ; Premières publications ; Ruge ; Feuerbach ; Etudes sur la religion et sur l’art ; Rheinische Zeitung ; Les Jeunes Hégéliens ; Questions économiques ; Socialisme français ; Rupture avec les « Affranchis » ; Démêlés avec la censure ; Projets.
III. Fin Mars 1843 – début Février 1845 : Critique de la philosophie du droit de Hegel ; Kreuznach ; Mariage ; Paris ; Annales franco-allemandes ; Premiers essais communistes ; Heine ; Rupture avec Ruge ; Economie politique ; Révolution française ; Proudhon ; Le Vorwaerts de Paris ; Engels ; La Sainte Famille ; Critique de la politique et de l’économie (manuscrit).
IV. Février 1845 – Février 1848 : Bruxelles ; Thèses sur Feuerbach (manuscrit) ; Etudes économiques ; Voyage en Angleterre ; L’Idéologie allemande (avec Engels, manuscrit) ; Débuts de propagande et d’organisation communistes ; Comités de correspondance communistes ; Circulaire contre Kriege ; Grün et Proudhon ; Rupture avec Weitling ; Wilhelm Wolff ; Harnay ; Ligue des Justes ; Anti-Proudhon ; Deutsche Brüsseler Zeitung ; Ligue des Communistes ; Association ouvrière de Bruxelles ; Association démocratique ; Fraternal democrats ; Discours sur le libre échange ; Salaire et capital (manuscrit) ; Question polonaise ; Manifeste communiste.
V. Fin Février 1848 – fin août 1849 : Tentatives d’insurrection à Bruxelles ; Expulsion ; Paris ; Club ouvrier allemand ; Revendications du Parti communiste en Allemagne ; Cologne ; Pour la fondation d’un parti ouvrier ; Gottschalk ; Neue Rheinische Zeitung ; Parlement de Francfort ; Insurrection de Juin ; Comité d’arrondissement de la Démocratie rhénane ; « Guerre à la Russie ! » ; Weitling ; Assemblée nationale de Berlin ; Le Ministère de l’action ; La révolution tronquée ; Voyage à Berlin et à Vienne ; Journées de Septembre à Cologne ; Etat de siège ; Contre-révolution de Berlin ; Grève de l’impôt ; Association ouvrière de Cologne ; Nouvelle vague révolutionnaire ; « République rouge ! » ; Procès pour délits de presse ; Le numéro rouge de la NRHZ ; Voyage à travers la région en révolte ; Paris.
VI. Fin août 1849 – Septembre 1850 : Londres ; Ligue des communistes ; Autorité centrale ; Association ouvrière ; Comité des réfugiés ; Willich ; Engels ; NRHZ (Revue d’économie politique) ; Les luttes de classes en France ; Miquel ; Crise et révolution ; Réorganisation de la Ligue des communistes ; Adresse de Mars aux sections ; Campagne contre la démocratie ; Les blanquistes ; Les chartistes ; La Société Universelle des Communistes Révolutionnaires ; Adresse de Juin ; Histoire économique de 1840-1850 ; Prospérité et réaction ; Scission de la Ligue.
VII. Septembre 1850 – Novembre 1852 : Etudes économiques ; Derniers fascicules de la NRHZ (Revue) ; Engels s’installe à Manchester ; Banquet des Egaux ; Conflit avec Herweg ; Lassalle ; Théorie de la rente foncière ; A la recherche d’un éditeur ; H. Becker, Essais choisis de Karl Marx ; Freiligrath à Londres; En Allemagne, la police découvre la Ligue Communiste ; Weerth ; Pieper ; Etudes technologiques et agronomiques ; New-York Tribune ; Weydemeyer et sa revue Die Révolution ; Cluss ; Kinkel et son « emprunt pour la révolution » ; Le 18 Brumaire ; Jones ; Bangya ; « Les grands hommes de l’exil » ; Szemere ; Zerffl ; Refus des éditeurs ; Kossuth et Mazzini ; Procès des communistes à Cologne ; Dissolution de la Ligue Communiste.
VIII. Novembre 1852 – fin 1856 : « Révélations sur les procès de Cologne » ; « Le chevalier de la conscience généreuse » ; New-York Tribune ; People Paper ; Politique anglaise ; Inde ; Palmerston ; Urquhart ; Guerre de Crimée ; Labour Parliament ; Révolution espagnole ; Neue Oder Zeitung ; Mort de Musch : Panslavisme ; Mort de Daniel ; Lassalle ; The Free Press ; « Révélations sur l’histoire diplomatique du 18″ siècle »; Mort Weerth ; Histoire de la Prusse ; Conflit de Neuenburg ; Symptômes de la crise.
IX. Début 1857 – Juin 1859 : Première rédaction de la « Critique de l’économie politique » ; Histoire de la Russie ; New American Cyclopaedia ; Le Crédit Mobilier ; Révolte aux Indes ; Crise économique ; L’ « Introduction » à la « Critique de l’Economie Politique » (manuscrit) ; Mort de Schramm ; Lassalle à Berlin ; Politique intérieure de la Prusse ; Guerre italienne ; « Le Pô et le Rhin » ; Napoléon III ; Kinkel et son Hermann ; Freiligrath ; Das Volk ; « Contribution à la Critique de l’Economie politique ».
X. Juin 1859 – Juillet 1861 : Das Volk ; Liebknecht ; Blind et Vogt ; Guerre en Chine ; Vogt ; National Zeitung ; Daily News ; Conflit avec Freiligrath ; La « Schwefelbande » ; Borkheim ; Un procès ; Vogt, agent de Napoléon III ; « Prospérité et paupérisme en Angleterre » ; « Herr Vogt » ; Chez Lassalle à Berlin ; Blanqui prisonnier.
XI. Avril 1861 – Septembre 1864 : Deuxième rédaction du « Capital » ; Théorie de la plus-value ; La Presse de Vienne ; Guerre civile aux U.S.A. ; Mexico ; Lassalle à Londres ; Insurrection en Pologne ; Deuxième rédaction du « Capital » ; Théorie de la plus-value ; La Presse de Vienne ; Guerre civile aux U.S.A. ; Mexico ; Lassalle à Londres ; Insurrection en Pologne ; Deuxième rédaction du « Capital » ; Mort de W. Wolff ; Liebknecht à Berlin; Mort de Lassalle.
XII. Septembre 1864 – Septembre 1867 : L’Association Internationale des Travailleurs ; Adresse inaugurale et Statuts ; Lassalle fonde l’Association générale des ouvriers allemands ; Liebknecht et Schweitzer ; Rupture avec le Sozialdemokrat ; Section parisienne de l’A.I.T. ; Conférence de Londres ; Question polonaise ; Brouillon des trois livres du « Capital » ; Congrès de Genève ; Kugelmann ; Congrès de Lausanne ; « Le Capital », Livre I.
XIII. Septembre 1867 – Juillet 1870 : Propagande pour « Le Capital » ; Liebknecht au Reichstag ; Question irlandaise ; Livres II et III du « Capital » (manuscrits) ; Congrès de Bruxelles ; Nurnberg et Hambourg ; Liebknecht et Schweitzer ; Question syndicale ; Bakounine ; L’Alliance de la Démocratie socialiste ; Eisenach ; Congrès de Bâle ; Danielson ; Marx apprend le russe ; Les Feniens ; La « Communication confidentielle » ; Marx, secrétaire pour la Russie ; Mort de Schappen ; Luttes de fractions en Suisse.
XIV Juillet 1870 – Juillet 1871 : L’A.I.T. et la guerre franco-allemande ; Liebknecht ; Bebel ; Bracke ; Lettre au Comité de Brunswig ; Sedan ; République française ; Engels s’installe à Londres ; Favre et Odger ; La Commune ; « La Guerre Civile en France ».
XV. Juillet 1871 – Septembre 1873 : L’Alliance en Suisse ; Outine ; Conférence de Londres ; Action politique et économique de la classe ouvrière ; Sectes et Parti ; « Le Capital », 2e édition et édition française ; Préparation de Congrès de La Haye ; Eccarius ; « Les Prétendues Scissions » ; « Le Capital » en russe ; Procès de haute trahison à Leipzig ; La citation de Gladstone ; Congrès de La Haye ; Exclusion de Bakounine ; Discours à Amsterdam ; Conseil fédéral britannique ; Scission en Angleterre ; La 2e édition du « Capital » paraît ; Brochure sur l’Alliance ; Congrès de Genève.
XVI. Fin Septembre 1873 – Mai 1878: Mouvement ouvrier allemand ; Marx à Karlsbad ; Critique du Programme de Gotha ; l’Edition française du « Capital » paraît ; Kovalevski ; Gladstone et la Russie ; Lavrov ; Question orientale ; Lissagaray, « Histoire de la Commune » ; Le deuxième livre du « Capital » ; L’Anti-Dühring.
XVII. Mai 1878 – Décembre 1881: Loi contre les socialistes en Allemagne ; Lothar Bûcher ; Hôchberg ; La direction du parti s’installe à Leipzig ; Lettre circulaire ; La Freiheit de Most ; Le Social-Demokrat de Zurich ; A. Loria ; Le Parti Ouvrier français ; Hyndman ; Etudes sur la Russie et l’Amérique ; Bebel chez Marx ; Morgan, « Ancient Society » ; Lettre à Vera Zassoulitch ; Henry George ; Mort de Madame Marx.
XVIII. Janvier 1882 – 17 Mars 1885 : Maladie ; Voyage ; Etudes sur la Russie ; Deprez ; Mort de Jenny ; Mort de Marx.
Comme on peut le constater, les diverses étapes de la carrière de Marx, de sa vie tout autant que de son œuvre, n’apparaissent, dans ce tableau chronologique, que sous la désignation de quelques trois cents faits, noms ou titres. Or, pour beaucoup de ceux-ci, il existe désormais des monographies plus ou moins volumineuses dont certaines se rapportent à des faits ou à des événements peu connus de la vie de Marx, ses relations avec Koeppen, par exemple, ou avec l’espion Bangya (21), sans parler des grandes enquêtes sur certaines phases de la carrière politique de Marx que nous devons à Max Nettlau, Riazanov, G. Mayer ou B. Nicolaïevski, pour ne nommer que les marxologues les plus connus.
On pourrait, par un simple calcul, arriver à se faire une idée des dimensions que doit prendre une biographie de Marx, écrite avec le souci d’une objectivité totale et sans la moindre incursion dans le domaine de la fantaisie ou du romantisme. En supposant que pour les trois cents noms et titres énumérés, on n’écrive en moyenne que cinq pages de commentaires historiques et bibliographiques, on obtiendrait un volume de 1.500 pages, chiffre impressionnant lorsqu’on pense que les quelques biographies de Marx parues jusqu’ici oscillent autour de 500 pages.
III
En tant que figure marquante du 19e siècle, Marx a de quoi séduire le biographe intrigué par la puissance quasi mythique qui se dégage de la personnalité du promoteur du plus important mouvement social de notre temps. Mais c’est précisément parce que le nom et la pensée de Marx sont si étroitement mêlés aux grands bouleversements politiques contemporains, que la tâche du biographe sérieux d’objectivité devient particulièrement ardue. Comme Kierkegaard, son génial contemporain, Marx fut, sans certes le vouloir, ce « penseur subjectif » dont le philosophe danois a tracé le saisissant portrait et qui, à la fois esthéticien, éthicien et dialecticien, est hanté par les problèmes d’existence plutôt que par les problèmes de spéculation (22). Mais ce qui déroute, lorsqu’on lit les ouvrages de Marx, c’est l’impression que cette lecture nous laisse d’une indifférence totale à l’égard des problèmes dits intérieurs, moraux ou sentimentaux, c’est, en bref, ce que Nietzsche appelait le pathos de la distance.
Or, il n’en est pas de même quand on lit les lettres privées de Marx et notamment sa correspondance avec Engels. Malgré ses immenses richesses d’idées, elle nous montre un Marx réduit à ses proportions humaines, trop humaines. Elle nous fait comprendre pourquoi Marx avait choisi, pour répondre à une question de ses enfants, la maxime de Térence, qui fut aussi celle de Goethe: « Je suis homme : rien de ce qui est humain ne m’est étranger ».
Quelle que soit l’opinion que l’on peut avoir sur son opportunité, la publication de ces lettres dans leur texte intégral, devait réjouir le biographe curieux de détails anecdotiques, petitesses humaines et quotidiennes, mouvements d’humeur, grandes et petites haines, accès d’orgueil, de jalousie et de cynisme, bref tout ce que la morale courante aime à mettre en évidence pour ravaler le génie au niveau de ses propres normes (23). C’est ce que C. J. Gignoux et surtout L. Schwarzschild ont fort bien compris, le premier en nous montrant un Marx imbu des défauts de sa race, prophète irascible, nomade paresseux vivant de mendicité, incapable de nourrir sa famille qu’il sacrifie à ses ambitions démesurées de meneur politique ; le second en nous présentant son héros comme l’auteur et l’incarnation du fléau de notre temps : le totalitarisme. En effet, L. Schwarzschild rend Marx responsable non seulement du « communisme » russe mais de « tous les autres Etats totalitaires », imitations ou variantes du modèle soviétique. Selon lui, Marx et Engels auraient été « imbus de l’idée
sianisme socialiste russe (24). C’est cette attitude invariable qui a valu à Marx et à Engels d’être traités très tôt de « russomanes » et de « slavophages » (25). Il faut donc un mépris total de la vérité ou une ignorance non moins totale de l’œuvre de Marx pour établir, comme le fait L. Schwarzschild, l’équation : Marx = Lénine = Staline = Hitler. Les pages consacrées par Marx et par Engels à la lutte contre la Russie autocratique se comptent par centaines et leur réunion pourrait former un beau volume dont l’actualité éclaterait à chaque ligne. Sans cesse, ils y flétrissent le tsarisme comme le bastion de la réaction européenne et comme une puissance qui aspire par les moyens les plus barbares à l’hégémonie mondiale. Beaucoup plus que dans certains ouvrages actuels on peut y trouver les critères historiques et politiques qui constituent là condamnation la plus énergique du totalitarisme russe, critères qu’on chercherait vainement dans l’arsenal de la morale occidentale traditionnelle.
Nous ne pouvons pas nous étendre, ici, sur cet aspect de l’oeuvre marxienne qui présente en même temps un des éléments fondamentaux dont aucune biographie sérieuse de Marx ne saurait se dispenser. Mais puisque M. Schwartzschild et M. Gignoux suggèrent à leurs lecteurs le portrait d’un Marx, père des régimes autocratiques modernes nous leur proposons de méditer les deux citations suivantes dont ils auront du mal à deviner l’auteur :
Une simple substitution de noms et de dates nous fournit la preuve évidente qu’entre la politique d’Ivan III et celle de la Russie moderne il existe non seulement une similitude mais une identité. Ivan III, pour sa part, n’a fait que perfectionner la politique traditionnelle de Moscovie que lui avait léguée Ivan I Kalila. Ivan Kalita, esclave des Mongols, acquit sa puissance en dirigeant la force de son plus grand ennemi, le Tarlar, contre ses ennemis plus petits, les princes russes. Il ne put utiliser cette force que sous de faux prétextes. Obligé de dissimuler à ses maîtres la puissance qu’il avait’ réellement acquise, il dut éblouir ses sujets, esclaves comme lui, par une puissance qu’il ne possédait pas. Pour résoudre ce problème, il dut élever au rang d’un système toutes les ruses de la servitude la plus abjecte et réaliser ce système avec la laborieuse patience de l’esclave. Même la violence ouverte, il ne put l’employer qu’en tant qu’intrigue dans tout un système d’intrigues, corruptions et usurpations secrètes. Il ne put frapper sans avoir, au préalable, empoisonné. L’unicité du but s’alliait chez lui à la duplicité de l’action. Gagner en puissance par l’emploi frauduleux de la force ennemie, affaiblir cette force tout en l’employant et, finalement, la détruire après s’en être servi comme instrument, — cette politique fut inspirée à Ivan Kalita par le caractère particulier de la race dominante tout comme par celui de la race asservie. Sa politique fut aussi celle d’Ivan III. Et c’est encore la politique de Pierre le Grand et de la Russie moderne, bien que le nom, le pays et le caractère de la puissance ennemie dupée aient changé. Pierre le Grand est réellement l’inventeur de la politique russe moderne, mais il le devint uniquement en dépouillant la vieille méthode moscovite d’usurpation de son caractère purement local et de ses ingrédients accessoires, en la distillant en une formule abstraite, en en généralisant le but. Grâce à lui, le désir de briser certaines limites données du pouvoir se transforma en l’aspiration exaltante au pouvoir illimité. Ce n’est pas par la conquête de quelques provinces, mais par la généralisation du système moscovite qu’il fonda la Russie moderne. En bref : C’est à l’école terrible et abjecte de l’esclavage mongol que Moscou s’est formé et a grandi. Il n’a acquis sa puissance qu’en devenant virtuose dans l’art de la servitude. Même après son émancipation du joug mongol, Moscou continua à jouer son rôle traditionnel d’esclave sous le masque du maître. Ce fut enfin Pierre le Grand qui combina l’art politique de l’esclave mongol et la fière ambition du maître mongol à qui Gengis Khan a légué la mission de conquérir le monde…
L’influence écrasante de la Russie a saisi par surprise l’Europe à différentes époques et a provoqué la terreur des peuples occidentaux. On s’y est soumis comme à une fatalité, on n’y a résisté que par soubresauts. Mais cette fascination exercée par la Russie s’accompagne d’un scepticisme sans cesse renouvelé qui l’accompagne comme une ombre, grandit avec elle, mêlant les notes aiguës de l’ironie aux gémissements des peuples agonisants et raillant sa puissance réelle comme une sinistre farce, montée pour éblouir et pour duper. D’autres empires ont, à leurs débuts, suscité de semblables doutes: seule la Russie est devenue un colosse sans cesser d’étonner. Elle offre l’exemple, unique dans l’histoire, d’un immense empire dont la puissance formidable, même après des exploits d’envergure mondiale, n’a jamais cessé d’être considérée comme étant du domaine de l’imagination plutôt que des faits. Depuis la fin du dix-huitième siècle jusqu’à nos jours, il n’est point d’auteur qui, voulant glorifier la Russie ou, au contraire, la blâmer, n’ait cru pouvoir se dispenser de prouver tout d’abord l’existence même de ce pays.
Mais que nous jugions la Russie en matérialistes ou en spiritualistes, que nous considérions sa puissance comme un fait palpable ou comme une vision de la mauvaise conscience des peuples européens, la question reste la même: Comment cette puissance, ou, si l’on veut, ce fantôme de puissance, est-elle parvenue à atteindre des dimensions telles qu’elle ait pu susciter les jugements les plus contradictoires, les uns croyant fermement, les autres contestant rageusement que la Russie menace le monde d’un retour à la Monarchie universelle ?
Les Schwarzchild, Gignoux et consorts admettront-ils que Marx – puisque c’est lui l’auteur des lignes ci-dessus – ne fut pas si mauvais prophète ? (26) Ou lui en feront-ils un grief de n’avoir pu rêver, dans ses pires cauchemars, que les maîtres futurs de la Russie se serviraient de son enseignement pour travestir leurs ambitions politiques tendant à instaurer dans le monde un absolutisme qui n’a pas son égal dans l’histoire ?
Si l’arbre est responsable de ses fruits, voudrions-nous qu’il répondit également de ses parasites ?
Notes:
(1) L. Schwahzschild, Karl Marx. Traduction de G. de Genevraye, Editions du Parois, Paris, 1950, 400 pages.
(2) C.-J. Gignoux, Karl Marx, Paris, Librairie Plon, 1950, 259 pages.
(3) Cette entreprise, commencée en 1927, par D. Riazanov, promoteur et directeur de l’Institut Marx-Engels de Moscou, et continuée après sa destitution par V. Adoratski, fut interrompue en 1935, après la publication de 11 volumes comprenant les oeuvres de Marx et d’Engels écrites avant 1849 et la correspondance entre ces derniers. Il faudra un jour raconter l’histoire dramatique du sort de cette publication comme du destin qui fut celui du legs littéraire de Marx et d’Engels.
(4) Voir, entre autres, la lettre d’Engels à Becker, du 22 Mai 1883. Cf. F. Engels, Vergessene Briefe, Berlin, 1920.
(5) Les divergences politiques entre Kautsky et Bernstein furent sans doute à l’origine des rivalités personnelles surgies après le suicide d’Eleanor Marx-Aveling, fille de Karl Marx, entre ces deux hommes qui avaient vécu dans l’intimité d’Engels.
(6) John Spargo, Karl Marx. His Life and his Works, New-York, 1910. Une traduction allemande en parut en 1912.
(7) Franz Mehring, Karl Marx. Geschichte seine Lebens, Leipzig, 1918, 580 pages, 2e édition en 1919. La 5e édition, parue en 1933, comporte une introduction et une postface d’E. Fuchs. Il en existe des traductions anglaise et espagnole.
(8) Dans le sous-titre initial, Mehring avait voulu mettre : « Histoire de sa vie et de ses oeuvres ».
(9) Cf. F. Mehring, Mein Vertrauensbruch. Article publié dans la Neue Zeit du 25 juillet 1913. Laura Lafargue avait autorisé la publication des lettres de son père à Engels tout en exigeant qu’on n’en publiât pas les passages insignifiants, de caractère purement intime et sans aucun intérêt historique. Le recueil, publié en 1913 par Bernstein et Bebel et revu, à la demande de L. Lafargue, par F. Mehring n’était donc pas complet. Riazanov crut de son devoir de refaire l’édition en ne tolérant aucune espèce de suppression, alléguant que Marx, sans être un ange, pouvait néanmoins supporter la critique la plus impitoyable. Cf. la préface de Riazanov à la correspondance Marx-Engels, dans Marx-Engels-Gesamtausgabe, section III, tome I, Berlin, 1929.
(10) Gustav Mayer, Friedrich Engels, 2 volumes, 2e édition, La Haye, 1934. (Environ 1.000 pages).
(11) O. Rühle, Karl Marx, Leben und Werk, Hellerau, 1928. Trad. française Grasset, 1933. On y lit des phrases comme celle-ci : « C’est le besoin de ressembler à Dieu qui dicte son programme de vie et lui trace ses directives ».
(12) V. supra, note 3.
(13) Auguste Cornu, La jeunesse de Karl Marx, Paris, F. Alcan, 1934, 430 p.
(14) Luc Somerhausen, L’humanisme agissant de Karl Marx, Paris, 1946, 290 p.
(15) Giuliano Pischel, Marx Giovane, Milan, 1948, 416 pages.
(16) B. Nikolaevski et O. Maenchen-Helfen, Karl Marx, Paris, Gallimard, 1937, 317 pages.
(17) On pourrait encore nommer : E.-H. Carr, Karl Marx. A Study in Fanaticism, 1934 ; — I. Berlin, Karl Marx, His Life and Environment, 1939.
(18) A. Vène, Vie et doctrine de Karl Marx, Paris, 1946. Rappelant la misère matérielle de la famille Marx à partir de 1851, cet auteur écrit : « La solution de bon sens, pour Marx, eût été de rechercher quelque emploi stable et rétribué ». Parlant de la théorie de la valeur de Marx : « …même si elles étaient exactes, les vues de Karl Marx, en raison de leur complication, ne pourraient être utilisées dans la pratique des affaires » (!). M. Vène a trouvé un émule en la personne de M. Gignoux chez qui nous lisons: « Il y a quelque chose d’insoutenable et de profondément inhumain dans le cas de ce prophète de la justice sociale, qui, muré dans son orgueil et dans la mission qu’il s’est attribuée, tient pour subalterne le devoir élémentaire auquel se plie le dernier des prolétaires : travailler pour nourrir les siens et ne pas laisser périr de misère les enfants qu’il met au monde ». Rarement la mentalité philistine a atteint ce comble de la bêtise et du cynisme ! Il est vrai que si Marx avait possédé le « bon sens » de MM. Vène et Gignoux… Nous laissons à nos lecteurs le soin d’imaginer ce qui serait arrivé.
(19) Karl Marx, Chronil seines Lebens in Einzeldaten. Publié par l’Institut Marx-Engels de Moscou, Moscou, 1934, 464 pages. Cet ouvrage a pu être composé grâce aux documents et matériaux recueillis par Riazanov. Son nom n’est pourtant même pas mentionné une seule fois ! En outre, des sources bibliographiques importantes n’y sont pas indiquées, considérées probablement comme hérétiques…
(20) Le sort des éditions de Marx et Engels en U.R.S.S. forme un chapitre des plus étonnants du drame que constitue l’histoire du legs littéraire des deux promoteurs du socialisme scientifique.
(21) Cf. Helmut Hirsch, Karl Friedrich Köppen, der intimste Berliner Freund Marxens. Dans « International Review for Social History », vol. I, Amsterdam, 1936. — R. Rodoiskvi, Karl Marx und der Polizeispitzel Bangya. Ibid, vol. II, 1937.
(22) V. S. Kierkegaard, Post-scriptum aux Miettes Philosophiques (1846).
(24) Voir, par exemple, mes essais dans la « Revue Socialiste » : Karl Marx et le socialisme populiste russe (Mai 1947) et La Russie dans l’œuvre de Marx et d’Engels (Leur correspondance avec Danielson), (Avril 1950).
(25) Notamment après leurs articles dans la Neue Rheinische Zeitung contre le panslavisme démocratique dont Bakounine s’était fait le porte-parole au Congrès slave de Prague, en Juin 1848.
(26) Les deux passages que nous avons ici traduits pour la première fois en français figurent dans la série d’études publiée par Marx dans la Free Press d’Août 1856 à Avril 1857 sous le titre Revelations of the Diplomatic History of the 18th Century. Ces articles ne furent que l’introduction à une étude plus vaste, restée inachevée. Ils furent réédités par Eleanor Marx Aveling sous le titre Secret Diplomatic History of the Eigteenth Century, London, 1899. Toutefois le premier passage que nous avons cité a été omis dans cette réédition. L’ensemble du texte a fait l’objet d’une analyse critique par D. Riazanov, dans un Supplément de la Neue zeit, paru en 1909, et intitulé Karl Marx über den Ursprung der Vorherrschaft Russlands in Europa (Karl Marx sur l’origine de l’hégémonie de la Russie en Europe). Dans ses commentaires, Riazanov fit un grief à Marx d’avoir considéré l’absolutisme russe comme un phénomène permanent de l’histoire russe. Par une ironie tragique du sort, l’éminent marxologue eut l’occasion, au moment de sa déportation en 1931, d’éprouver dans son âme et corps la justesse des vues marxiennes…
Post-scriptum à « Marx théoricien de l’anarchisme » (Rubel, 1983)
14 août 2011Maximilien Rubel: Post-scriptum (1983) à Marx théoricien de l’anarchisme (dans Les Cahiers du Vent du Ch’min). Texte transcrit par A.B.
En cette année du centenaire de la mort de Marx, l’essai ci-dessus, publié il y a dix ans, nécessiterait un remaniement en vue d’en renforcer la thèse centrale : la fondation par Marx d’une théorie politique de l’anarchisme [1]. Si l’on fait abstraction de la critique traditionnelle de caractère purement phraséologique, dont cette théorie fait l’objet de la part d’idéologues anarchistes et libertaires, on doit admettre que le véritable débat sur les modes de transition des sociétés dominées par le capital et l’État est loin d’être commencé. Le plus souvent, le verbalisme tient lieu d’argument dans les deux camps, anarchiste et marxiste, sans que l’enseignement du principal intéressé soit réellement pris en considération. Que la quasi-totalité des résolutions « politiques » rédigées par Marx pour les congrès successifs de l’Internationale ouvrière aient obtenu l’accord unanime des délégués, ce seul fait suffit pourtant pour reconnaître l’inanité des critiques soi-disant anti-autoritaires. En réalité, les « anti-autoritaires » n’étaient pas moins « marxistes » que leurs opposants, puisque, en votant ces résolutions dont ils ignoraient probablement l’auteur, ils rendaient hommage à l’« autorité » de ce dernier [2]. Et que dire du vote unanime, par l’ensemble des sections de l’A.I.T., de l’adresse sur la Guerre civile en France où le « vrai secret » de la nature de la Commune est révélé en ces termes :
« C’était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des accapareurs, la forme politique enfin découverte sous laquelle s’accomplira l’émancipation économique du Travail. » [3]
Comment ne pas s’étonner d’une phraséologie « anti-autoritaire » toujours florissante, lorsqu’on sait que cette conception du caractère politique de la Commune fut partagée sans réserve par les adeptes de Proudhon comme par ceux de Bakounine, lequel, peu de temps après, s’est évertué à répandre parmi ses compagnons de lutte des libelles où Marx est traité de « représentant de la pensée allemande », de « Juif allemand », de « chef des communistes autoritaires de l’Allemagne » aux allures de « dictateur-messie », partisan fanatique du « pangermanisme » [4]. Que dire de ces « Pièces justificatives » où Marx est décrit d’une part comme un « économiste profond… passionnément dévoué à la cause du prolétariat », comme « l’initiateur et l’inspirateur principal de la fondation de l’Internationale » et, d’autre part, comme un doctrinaire qui « en est arrivé à se considérer très sérieusement comme le pape du socialisme, ou plutôt du communisme » ? Il est, « par toute sa théorie, un communiste autoritaire, voulant comme Mazzini […] l’émancipation du prolétariat par la puissance centralisée du prolétariat ». Que penser d’un « anarchiste » ou d’un « communiste révolutionnaire » qui croit et affirme que le juif Marx est entouré d’une « foule de petits Juifs », que « tout ce monde juif », « un peuple sangsue », est « intimement organisé […] à travers toutes les différences des opinions politiques », qu’il est « en grande partie à la disposition de Marx d’un côté, des Rothschild de l’autre » [5] ? Comment prendre au sérieux un « anarchisme » qui, « anti-autoritaire » par essence et proclamation, attribue au même Marx le glorieux mérite d’avoir rédigé « les considérants si beaux et si profonds des statuts », et d’avoir « donné corps aux aspirations instinctives, unanimes, du prolétariat de presque tous les pays de l’Europe, en concevant l’idée et en proposant l’institution de l’Internationale, dans les années 1863-1864 », tout en oubliant ou feignant d’oublier que la charte de l’Internationale fut d’emblée un document politique, un manifeste qui confère à la lutte politique de la classe des producteurs le caractère d’un impératif catégorique, condition absolue et moyen indubitable de l’émancipation humaine [6] ?
Ce n’est pas Marx, c’est Bakounine qui pratiquait le principe de la libération de « haut en bas », prônant la constitution d’une autorité centralisée et secrète, d’une élite ayant pour mission d’exercer une « dictature collective et invisible » afin de faire triompher « la révolution bien dirigée » [7]. Confiant dans le mouvement réel des ouvriers, Marx soulignait l’importance des syndicats, des coopératives et des partis politiques en tant que créations « de bas en haut », pendant que Bakounine, tout en retraçant magistralement la carrière de Mazzini, héros des expéditions en marge de la vie réelle des masses, dessinait pour les révolutionnaires italiens, appelés à organiser « une grande révolution populaire », un plan d’action en vue de soulever, de révolutionner les paysans « nécessairement » fédéralistes et socialistes. Le programme prévoyait la formation d’un « parti actif et puissant » qui ne devait être en réalité qu’une avant-garde marchant « parallèlement » aux mazziniens, mais en se gardant de s’allier avec eux, en veillant à ce qu’ils ne pénètrent pas dans ce nouveau parti, etc. Ce n’est pas Marx qui, face aux persécutions gouvernementales et policières dont l’Internationale était la victime, dans tous les pays du continent européen, conseillait la création, « au milieu des sections », des « nuclei » composés des membres les plus sûrs, les plus dévoués, les plus intelligents et les plus énergiques, en un mot des plus intimes », avec la « double mission » de former « l’âme inspiratrice et vivifiante de cet immense corps qu’on appelle l’Association Internationale des Travailleurs en Italie comme ailleurs […]. Ils formeront le pont nécessaire entre la propagande des théories socialistes et la pratique révolutionnaire ». Ce n’est pas Marx qui recommandait aux Italiens ainsi recrutés de former une « alliance secrète » qui « n’accepterait dans son sein qu’un très petit nombre d’individus, les plus sûrs, les plus dévoués, les plus intelligents, les meilleurs, car dans ces sortes d’organisations, ce n’est pas la quantité, c’est la qualité qu’il faut chercher » ; il ne fallait pas imiter les mazziniens et « recruter des soldats pour former des petites armées secrètes, capables de tenter des coups par surprise », car pour la révolution populaire, l’armée, c’est le peuple. Ce n’est pas Marx qui suggérait de former des « états-majors », un « réseau bien organisé et bien inspiré des chefs du mouvement populaire », une organisation pour laquelle « il n’est nullement nécessaire d’avoir une grande quantité d’individus initiés dans l’organisation secrète » [8].
Imagine-t-on l’homme, dénoncé comme la personnification du « communisme autoritaire », apostropher de cette manière un réseau secret de compagnons ou employer ses talents d’homme de science et de militant pour « convertir l’Internationale en une sorte d’État, bien réglementé, bien discipliné, obéissant à un gouvernement unitaire et dont tous les pouvoirs seraient concentrés entre les mains de Marx » [9] ?
Comment expliquer le fait que, pour justifier leur dogme « anti-autoritaire », les soi-disant anarchistes n’ont d’autre recours que l’invocation sans cesse répétée de quelques passages du Manifeste communiste ou la citation d’extraits de lettres privées, ainsi que, naturellement, le rappel des manœuvres douteuses et diplomatiques de Marx et d’Engels pour faire exclure Bakounine et ses fidèles de l’Internationale ? Alors qu’il est facile de composer une anthologie d’écrits jacobins et blanquistes-babouvistes à partir de l’œuvre de Bakounine, pareille gageure se révèle impossible en tant que démonstration du « communisme d’État » prétendument prôné par Marx.
La carrière de Marx s’inscrit d’un bout à l’autre dans un processus de militantisme contre l’autorité. L’État et l’Église de Prusse furent le premier obstacle que le « docteur en philosophie » eut à affronter, pour pouvoir exercer la profession d’enseignant universitaire : ce fut le premier échec et aussi la première impulsion au combat contre l’autorité politique. Désormais, la vie de Marx se confond avec un combat politique mené dans tous les lieux d’exil comme dans le pays natal où il put retourner en 1848, non comme citoyen allemand mais comme apatride. A l’exception de l’Angleterre, lieu de liberté relative, les pays où Marx a séjourné ont mis la police à ses trousses. Jouissant du droit de libre expression en Grande-Bretagne, il ne s’est pas abstenu de pratiquer un journalisme « anti-autoritaire » et de chercher des contacts dans le milieu du chartisme alors sans grandes perspectives politiques. A Cologne, à Paris, à Bruxelles et à Londres, il a milité selon ses convictions socio-politiques, non en aventurier fomentant des conspirations de nul effet contre l’ordre établi, mais à visage découvert, là où les libertés bourgeoises étaient assurées, et dans la clandestinité quand la bourgeoisie devait encore lutter contre les vestiges de l’absolutisme féodal. Bref, son combat était toujours dirigé contre les régimes réactionnaires, donc autoritaires.
Un ensemble de principes ne mérite de s’appeler « théorie » que s’il développe des thèses empiriquement vérifiables et détermine les normes de réalisation rationnellement concevables. La théorie marxienne de l’anarchisme réunit ces deux caractéristiques ; elle analyse les phénomènes socio-historiques dans leur déroulement fixé par des témoignages vérifiés et vérifiables d’une part, et formule des pronostics relativement crédibles en fonction de comportements humains, de tendances transformatrices de la réalité sociale, d’autre part. Analytique et normative, cette théorie ne peut égaler l’exactitude des sciences dites naturelles, même si l’épistémologie moderne remet en question les présupposés déterministes des sciences dites exactes, assurant en quelque sorte le triomphe posthume de ce principe du « hasard », clef de l’atomisme épicurien (qui fut le sujet de thèse de l’étudiant Marx, candidat au doctorat en philosophie). Par opposition à la plupart des penseurs se réclamant de l’anarchisme ou d’un individualisme nihiliste (Max Stirner !), mais peu soucieux des moyens pratiques susceptibles de conduire à des formes de communauté libérées des institutions de classe favorisant l’exploitation et la domination de l’homme par l’homme, Marx a cherché à connaître les modes de transformation révolutionnaire des sociétés dans le passé, afin de déduire de ces expériences historiques des enseignements généraux. Lorsqu’il prétendait avoir assigné à ses recherches l’objectif ambitieux de « révéler la loi économique du mouvement de la société moderne », il avait déjà derrière lui près de trois décennies d’études dans plusieurs domaines du savoir. Ce n’est donc pas en spécialiste de l’économie politique qu’il se posait pour prétendre rivaliser avec Adam Smith ou David Ricardo et leurs épigones. L’originalité de sa méthode devait s’exercer dans l’observation des rapports humains qui sous-tendent les phénomènes dits économiques, tant dans leur expression théorique que dans leur manifestation pratique. Séparer le critique de l’économie politique et le théoricien de la politique révolutionnaire, c’est se fermer à la compréhension du sens profond de son œuvre, mais c’est aussi méconnaître l’influence forcément négative des circonstances « bourgeoises », plus exactement : de la « misère bourgeoise » qui a marqué toute sa carrière de paria intellectuel.
Nous disposons de nombreux indices qui permettent d’affirmer que le Livre de l’Etat prévu dans le plan de l’« Economie » défini par Marx dans l’Avant-propos de la Critique de l’économie politique (1859) devait exposer une Théorie de l’Anarchisme. Lorsque, pour commémorer le centenaire de la mort de Marx, un chroniqueur regrette que l’économiste l’ait emporté sur le théoricien du politique, il semble se fonder sur ce plan qu’il n’a pas été donné à Marx de mettre à exécution. Or, l’auteur de la Critique prétend disposer des « matériaux » destinés aux cinq « rubriques » ou « Livres » ; il parle même de « monographies » susceptibles de se changer, les circonstances aidant, en écrits élaborés conformément au schéma des deux triades où l’on devine facilement le rapport à la méthode dialectique d’un Hegel préalablement « redressé » [10]. Le halo de légende qui entoure l’œuvre de Marx a fini par atteindre un degré de mystification jamais atteint jusqu’ici, et l’on est bien obligé d’admettre que « libertaires » et « anti-autoritaires » y ont contribué pour une part non négligeable, se faisant ainsi les complices, souvent involontaires, des idéologues libéraux et démocrates enrôlés au service des intérêts du capitalisme vrai contre le faux socialisme peint sous les couleurs du démon totalitaire.
A la vérité, c’est « le politique » qui traverse de bout en bout l’ensemble de l’œuvre de Marx, demeurée fragmentaire pour des raisons évidentes. Pour ce qui est de la « monographie » mentionnée parmi les matériaux partiellement rédigés comme texte provisoire du « Livre », elle pourrait être reconstituée à partir des éléments épars et fort nombreux, présents dans presque tous les écrits, publiés et inédits, désormais accessibles, grâce aux éditions et rééditions dont Engels fut l’initiateur. Elles s’échelonnent, après sa disparition, sur plus de huit décennies, au bout desquelles la question posée par Kautsky à Marx en avril 1881 semble enfin recevoir une réponse définitive grâce à l’entreprise éditoriale la plus récente, la Marx-Engels-Gesamtausgabe [12].
On sait donc maintenant que Marx n’a jamais cessé de travailler pour la « rubrique » intitulée « l’Etat ». C’est même par une critique de la morale politique de Hegel qu’il a commencé sa carrière d’homme de science « engagé », tout comme il l’a terminée par un travail sur les perspectives révolutionnaires dans la Russie tsariste. On sait surtout que le premier plan du Livre de l’Etat date de 1845, alors qu’il venait d’écrire la première ébauche d’une critique de l’économie politique. Traiter d’un sujet tel que « Marx théoricien de l’anarchisme » sans soumettre ce plan au jugement des lecteurs et plus particulièrement de ceux parmi eux qui ne se lassent pas de s’acharner contre le « communiste d’Etat », c’est se priver d’un argument capital. Voici donc les onze thèmes inscrits par Marx dans un carnet utilisé pendant les années 1844-1847, leur date précise n’étant pas établie :
I. L’histoire de la genèse de l’Etat moderne ou la Révolution française.
L’outrecuidance du politique (des politischen Wesens) : confusion avec l’Etat antique. Rapport des révolutionnaires à la société bourgeoise. Dédoublement de tous les éléments en bourgeois et citoyens (bürgerliche und Staatswesen).
II. La proclamation des droits de l’homme et la constitution de l’État. La liberté individuelle et la puissance publique. Liberté, égalité et unité. La souveraineté populaire.
III. L’État et la société civile.
IV. L’Etat représentatif et la Charte.
L’État représentatif constitutionnel, ou l’État représentatif démocratique.
V. La séparation des pouvoirs. Pouvoir législatif et pouvoir exécutif.
VI. Le pouvoir législatif et les corps législatifs. Clubs politiques.
VII. Le pouvoir exécutif. Centralisation et hiérarchie. Centralisation et civilisation politique. Système fédéral et industrialisme. L’administration publique et l’administration communale.
VIII. Le pouvoir judiciaire et le droit.
IX. La nationalité et le peuple.
X. Les partis politiques.
XI. Le droit de suffrage, la lutte pour l’abolition (Aufhebung) de l’État et de la société bourgeoise [13].
Marx s’est engagé en février 1845 à céder à un éditeur allemand l’exclusivité d’un ouvrage en deux volumes ayant pour titre « Critique de la politique et de l’économie politique » (voir plus haut). On peut donc s’autoriser à affirmer que le schéma ci-dessus devait servir à l’auteur de cadre de référence pour ses études à entreprendre. Plusieurs des thèmes énumérés avaient déjà été abordés dans les écrits rédigés par Marx avant l’année 1845, d’autres feront l’objet de ses travaux tout au long de son activité d’historien, de chroniqueur politique et de polémiste. « Le politique » sera au cœur de ses affrontements avec les anarchistes affiliés à l’Internationale ouvrière.
A la liste des textes déjà mentionnés, il convient d’ajouter un écrit polémique d’une concision et d’une ironie telles qu’il mériterait d’être cité en entier en tant que document conclusif de la théorie politique qui se dégage de l’ensemble de l’œuvre de Marx et en justifie l’intention stratégique subordonnée à la cause de l’anarchie. Par le subterfuge d’un pastiche, Marx prête la parole à un défenseur de l’« indifférentisme politique », si bien que les propos cités, avant même d’être commentés, révèlent l’inanité du raisonnement soi-disant anarchiste. Il suffit de modifier le caractère ironique du discours fictif, pour parvenir à reconstituer la conception positive du prétendu « communiste d’Etat » :
« La classe ouvrière doit se constituer en parti politique, elle doit entreprendre des actions politiques, au risque de heurter les « principes éternels » selon lesquels le combat contre l’État signifie la reconnaissance de l’État. Ils doivent organiser des grèves, lutter pour des salaires plus élevés ou empêcher leur réduction, au risque de reconnaître le système du salariat et de renier les principes éternels de la libération de la classe ouvrière.
Les ouvriers doivent s’unir dans leur combat politique contre l’État bourgeois, pour obtenir des concessions, au risque de heurter les principes éternels en acceptant des compromis. Il n’y a pas lieu de condamner les mouvements pacifiques des ouvriers anglais et américains, pas plus que les luttes pour obtenir une limite légale de la journée de travail, donc de conclure des compromis avec des entrepreneurs qui ne pourront exploiter les ouvriers que dix ou douze heures, au lieu de quatorze ou seize. Ils doivent s’efforcer d’obtenir l’interdiction légale du travail en usine des filles de moins de dix ans, même si, par ce moyen, l’exploitation des garçons au-dessous de dix ans n’est pas supprimée — donc, nouveau compromis heurtant la pureté des principes éternels !
Les ouvriers doivent exiger que l’État — comme c’est le cas dans la République américaine — soit obligé d’accorder aux enfants des ouvriers la gratuité de l’école élémentaire, même si l’enseignement primaire n’est pas encore l’instruction universelle. Le budget de l’État étant établi aux dépens de la classe ouvrière, il est normal que les ouvriers et les ouvrières apprennent à lire, à écrire et à calculer grâce à l’enseignement de maîtres rémunérés par l’État, dans des écoles publiques, — car mieux vaut renier les principes éternels qu’être illettré et abruti par un travail quotidien de seize heures.
Aux yeux des « anti-autoritaires », les travailleurs commettent l’horrible crime de violation des principes si, pour satisfaire leurs mesquins et profanes besoins quotidiens et pour briser la résistance de la bourgeoisie, ils mènent le combat politique sans reculer devant des moyens violents, en mettant à la place de la dictature de la bourgeoisie leur propre dictature révolutionnaire. » [14]
Marx ne s’avise nullement de désigner cette dictature ouvrière de « communisme d’État », bien qu’il emploie une formule non dépourvue d’ambiguïté, en déclarant que le nouveau pouvoir, « au lieu de déposer les armes et d’abolir l’État », conserve en quelque sorte l’appareil de coercition existant en « donnant à l’État une forme révolutionnaire et transitoire ». Ces lignes, écrites dix-huit mois après l’écrasement de la Commune de Paris, nous prouvent à l’évidence que, dans la théorie politique de Marx, les événements de 1871 en France n’avaient rien d’une expérience susceptible d’être évoquée pour illustrer le concept de « dictature du prolétariat ». Nous avons signalé ailleurs l’erreur commise par Engels à cet égard et nous jugeons utile de la rappeler dans ce post-scriptum — qui est loin d’épuiser le débat sur le thème examiné — par quelques passages d’un texte publié en 1971 :
« Engels ne pouvait ignorer que, pour Marx, la dictature du prolétariat était une phase de transition « nécessaire » — au sens historique et éthique — entre le système capitaliste et le mode de production socialiste, « négation » du précédent. La théorie politique de Marx — qu’il aurait sans doute développée dans le Livre sur l’État prévu dans le plan de l’ « Economie » –— repose sur le principe de l’évolution progressive des « modes de production » dont chacun crée, en se développant, les conditions matérielles et morales de son dépassement par le suivant. En vertu de ses propres antagonismes sociaux, le capitalisme prépare le terrain économique et social de sa mutation révolutionnaire qui n’a rien d’un phénomène accidentel : afin que puisse se réaliser la dictature du prolétariat, les conditions matérielles et intellectuelles doivent avoir atteint un niveau de développement qui rende tout retour en arrière impossible. En d’autres termes, le postulat de la dictature prolétarienne exclut l’éventualité d’un échec. Une dictature, pour mériter le nom de prolétarienne, doit aboutir au type de société qu’elle a aidé à naître. Son existence ne peut être démontrée qu’a posteriori. Par conséquent, l’échec de la Commune prouve qu’il n’y eut pas de dictature du prolétariat et qu’il ne pouvait pas y en avoir. » [15]
En accordant à l’œuvre de Marx une place éminente parmi les contributions à une théorie de l’anarchisme, nous nous efforçons de préserver l’héritage intellectuel des penseurs révolutionnaires du XIXe siècle. La nouvelle théorie naîtra d’un mouvement révolutionnaire à l’échelle mondiale, sans quoi la « loi économique du mouvement de la société moderne » — que Marx prétendait avoir révélée — l’emportera sur l’instinct de survie et de conservation de notre espèce. Alors que cette « loi » relève de l’analyse scientifique du mode de production capitaliste — qui semble loin d’être parvenu au terme de son évolution — l’impératif catégorique de la révolution prolétarienne s’inscrit dans cette éthique de l’anarchie dont Kropotkine nous a légué les prolégomènes [16].
M.R. octobre 1983
Notes:
[1] Voir L. Janover et M. Rubel, « Matériaux pour un Lexique de Marx. — Etat. Anarchisme ». Etudes de marxologie (Cahiers de l’I.S.M.EA), nº 19-20, janvier-février 1978, p. 11-161.
[2] M. Rubel, « La charte de la Première Internationale. Essai sur le « marxisme » dans l’Association internationale des travailleurs. » Dans : Marx critique du marxisme, Paris, 1974, p. 25-41. Le Rapport du Conseil central de l’A.I.T., rédigé par Marx pour le Congrès de Genève (1866), contient sous la question 4 (« Travail des jeunes personnes et des enfants des deux sexes ») un paragraphe où il est dit entre autres : « La partie la plus éclairée des classes ouvrières comprend pleinement que l’avenir de leur classe, et par conséquent de l’espèce humaine, dépend de la formation de la génération ouvrière qui grandit. Ils comprennent que surtout les enfants et les jeunes personnes doivent être préservés des effets destructeurs du système présent. Cela peut seulement être accompli par la transformation de la raison sociale en force sociale et dans les circonstances présentes nous ne pouvons faire ceci que par des lois générales mises en vigueur par le pouvoir de l’Etat. En créant de telles lois, les classes ouvrières ne fortifieront pas le pouvoir gouvernemental. De même qu’il y a des lois pour défendre les privilèges de la propriété, pourquoi n’en existerait-il pas pour en empêcher les abus ? Au contraire, ces lois transformeraient le pouvoir dirigé contre elles en leur propre agent. Le prolétariat fera alors par une mesure générale ce qu’il essaierait en vain d’accomplir par une multitude d’efforts individuels. » A.I.T., Compte rendu du Congrès de Genève publié dans le Courrier international. Londres, 1867; cf. La Première Internationale, sous la direction de J. Freymond, t. I, Genève, 1962, p. 32. En votant « à une grande majorité » ce rapport, les délégués ne se sont sans doute pas aperçus qu’ils adhéraient à la théorie du « communisme d’Etat » fabriqué plus tard par la propagande obstinée de Bakounine et ses amis.
[3] Marx, The Civil War in France, 3e éd., Londres, 1871. MEGA, 1/22, 1978, p. 142.
[4] Nous nous abstenons de produire ici un florilège des propos racistes et germanophobes que la figure de Marx a inspirés à Bakounine. On les trouvera, fidèlement rapportés mais peu commentés, dans les Archives Bakounine, I, Michel Bakounine et l’Italie 1871-1872, 2e partie : La première Internationale en Italie et le conflit avec Marx. Leiden, 1963. Le parti pris « anti-autoritaire » de l’éditeur, A. Lehning, ne favorise pas un jugement équilibré et éclairant sur le fond théorique d’un conflit dont l’étude serait à reprendre à zéro, vu le désarroi des porte-parole dans les camps des « marxistes » et des « antimarxistes ».
[5] Bakounine, Rapports personnels avec Marx. Pièces justificatives nº 2. op. cit., p. 124 sq. « Cela peut paraître étrange. (…) Ah ! c’est que le communisme de Marx veut la puissante centralisation de l’Etat, et là où il y a centralisation de l’Etat, il doit y avoir nécessairement une Banque centrale de l’Etat, et là où une pareille Banque existe, la nature parasite des Juifs, spéculant sur le travail du peuple, trouvera toujours moyen d’exister… » (ibid., p. 125).
[6] Voir la « Lettre aux internationaux de la Romagne », datée du 23 janvier 1872, Archives Bakounine, I, 1963, op. cit., p. 207-228. Bakounine y fait son mea culpa pour avoir contribué à l’élargissement des pouvoirs du Conseil général de l’A.I.T. lors du Congrès de Bâle (1869) et renforcé de la sorte l’autorité de la « secte marxienne ».
[7] Bakounine à Albert Richard, 1er avril 1870. Archives…. op. cit.. p. XXXVI sq. A. Lehning résume dans son Introduction les activités de Bakounine tendant à « donner aux masses une direction vraiment révolutionnaire » en multipliant les organisations secrètes.
[8] Lettre à Celso Ceretti, 13-27 mars 1872. Archives…. op. cit.. p. 251 sq.
[9] Lettre aux internationaux de la Romagne…. op. cit., p. 220. Avant de forger l’expression « marxistes » pour désigner les amis de Marx. Bakounine parlait de « marxiens » et du « nucleo marxien ».
[10] Cf. Jacques Julliard, « Marx mort et vif », le Nouvel Observateur, 25-31 mars 1983, p. 60 : Marx aurait « négligé la théorie politique » au profit d’une « théorie de l’exploitation économiques »… « pour notre malheur ».
[11] Marx, Œuvres, Pléiade, t.1.
[12] Cette édition est due à l’initiative conjuguée des Instituts du marxisme-léninisme de Moscou et de Berlin (RDA). Une quinzaine de volumes — sur un total calculé à plus de cent — sont parus depuis 1975.
[13] Cf. Marx-Engels-Werke, Berlin (RDA), vol. III, p. 537. Les points VIII à XI (8 à 11 ) sont indiqués par 8′, 8″, 9′ et 9″.
[14] Marx, « L’indifférentisme en matière politique » (en italien) dans Allmanacco repubblicano, 1873, p. 141-148.
[15] Introduction à Jules Andrieu, Notes pour servir à l’histoire de la Commune de Paris en 1871, Paris, Payot, 1971. Édition établie par M. Rubel et L. Janover. Le volume sera repris par l’éditeur de Spartacus, René Lefeuvre.
[16] Pierre Kropotkine, l’Ethique. Trad. du russe avec une introduction par Marie Goldsmith. Stock + Plus, Paris 1979. Un deuxième volume livrera le texte inédit d’une ébauche dont la traductrice résume la pensée directrice, p. 8 sq. Il convient de signaler une étude italienne récemment parue où les thèses présentées ci-dessus reçoivent des éclaircissements complémentaires : Bruno Bongiovanni, L’Universale pregiudizio Le interpretazioni della critica marxiana della politica, Milan, La Salamandra, 1981.
L’agonie posthume de Karl Marx (Rubel, 1983)
2 juin 2011Maximilien Rubel, interviewé par Olivier Corpet et Thierry Paquot, Le Monde dimanche, 10 avril 1983 [+ pdf].
En cette année du centenaire de la mort de Marx, les commémorations, colloques, publications, fleurissent, tant à Paris que sur la place Rouge. Mais que va-t-on célébrer exactement : l’œuvre de Marx ou ce qu’en ont fait des différents marxismes ? Quelle est, face à ce nouvel enterrement, la réaction d’un marxologue, familier de l’œuvre en question, mais qui se reconnaît également dans le projet éthique et révolutionnaire de Marx d’une autoémancipation des classes opprimées ?
– Quand on fera le bilan des manifestations et des mascarades de toutes sortes auxquelles cette célébration aura donné lieu, en cette année mémorable, on pourra constater que le message révolutionnaire de l’auteur du Capital aura été étouffé de trois manières différentes : Primo, par la glorification outrancière du prétendu fondateur du marxisme, fondation à laquelle les fidèles du culte marxiste associent, en règle générale, l’alter ego de Marx : Friedrich Engels. Secundo, par la mise à mort posthume du penseur dont les doctrines, loin d’être scientifiques, auraient été controuvées ou démenties par l’histoire économique, politique et sociale des dernières cent années et seraient donc erronées d’un bout à l’autre. Tertio, par l’appréciation dite objective qui sait séparer l’ivraie du bon grain digne d’être engrangé pour l’enrichissement des sciences humaines.
» De ces trois manières d’évacuer la substance émancipatrice de l’œuvre marxienne, la troisième me paraît la moins blâmable. Elle peut rendre justice à l’esprit scientifique qui imprègne la théorie sociale de Marx, sans déformer systématiquement son œuvre. Le marxologue que je m’efforce d’être assume une tâche difficile : faire respecter l’ultime vœu de Marx protestant contre l’usurpation de son nom à des fins idéologiques et politiques, mais s’élevant aussi contre l’identification quasi religieuse de la conscience supposée des esclaves modernes avec une théorie abusivement baptisée « marxisme ».
Un défenseur « bourgeois » des droits de l’homme
» Cette double usurpation a fini par prendre la forme d’un véritable culte onomastique. C’est la raison de l’insistance que je mets à rappeler l’ultime avertissement de Marx : « Ce qu’il y a de certain, c’est que moi je ne suis pas marxiste. » II ne s’agit pas d’une boutade, mais d’une interdiction absolue, conforme à un enseignement scientifique et à une conviction éthique ayant leur source dans le mouvement émancipateur autonome du prolétariat moderne, et non dans l’œuvre de cet individu cosmo-historique que les admirateurs de Hegel, cet anti-Marx, appelaient de leurs vœux du vivant de Marx.
– Depuis quelques années, on voit de nombreux intellectuels se livrer à une critique sévère de Marx et du marxisme. Certains ont cru voir dans Marx un « bourgeois allemand », prisonnier de l’« esprit » de son temps ; pour d’autres, Marx n’aurait pas pensé le politique. D’où le goulag. L’œuvre de Marx vous semble-t-elle totalement innocente de toutes ces dérives, détournements, pire, de ces crimes dont on la rend responsable ?
– Votre question concerne surtout les deux dernières manières d’étouffer l’appel révolutionnaire et émancipateur de Marx. L’une consiste à opposer à sa théorie le démenti de l’expérience historique. De ce point de vue, ces cent années auraient été marquées par un progrès immense, inimaginable pour les plus grands penseurs du dix-neuvième siècle, Marx y compris. Malgré de terribles catastrophes et régressions de tous ordres, le bilan en serait « globalement positif ». L’histoire du vingtième siècle aurait donc déjoué toutes les spéculations de Marx sur la disparition du capitalisme et son remplacement par le socialisme dans les pays industriellement développés ; en revanche, des pays industriellement et politiquement arriérés auraient réussi à s’engager sur la voie du communisme. Bref : naufrage de la théorie de l’homme de science, inefficacité totale de la politique de l’homme de parti !
» Quant aux fossoyeurs académiques, une distinction nette est à faire. Il n’est pas question, en effet, de refuser d’entendre ceux dont la critique utile, nécessaire, prend en compte l’état d’inachèvement de l’œuvre scientifique de Marx pour séparer les éléments théoriques, dont la validité permanente doit être reconnue, des erreurs historiquement et psychologiquement explicables. Bien au contraire ! Mais que dire quand ceux qui, hier, ne juraient que sur le père fondateur le rendent aujourd’hui responsable des égarements d’une postérité intellectuelle et politique dont la perversité relève de la pathologie la plus élémentaire ?
» Ces apostats du marxisme suspectent le père répudié d’avoir à dessein omis ou sous-estimé le « politique » et de ne pas avoir répondu à la question essentielle du pourquoi de la mise en tutelle de la société civile par le pouvoir d’État. D’autres l’accusent d’ « aveuglement devant les droits de l’homme ». Or, les faits parlent d’eux-mêmes : Marx a passé les quatre décennies de sa carrière de communiste militant à vitupérer, en défenseur « bourgeois » des droits de l’homme, les trois formes majeures du « totalitarisme » de son temps : le bonapartisme, le tsarisme et l’absolutisme prussien.
» C’est cet ennemi acharné du Léviathan moderne que toute cette littérature académique antimarxiste va jusqu’à associer au « goulag » ! Ajoutons que c’est par choix qu’il s’est rangé dans le camp de la démocratie « bourgeoise » : victime dès ses débuts littéraires de la violation des droits de l’homme en Allemagne, en France et en Belgique, il s’est réfugié en Angleterre, cette métropole du capital lui ayant offert un asile sûr où il pouvait non seulement continuer à écrire librement, mais aussi mener campagne pour le droit d’association et le suffrage universel.
» Sur ce Marx démocrate et libéral, mais aussi démocrate révolutionnaire, il m’a été donné de dire l’essentiel dans mes travaux comme dans mes commentaires des écrits de Marx publiés dans la Pléiade : je m’applique à y démolir la légende de Marx construite autant par des adeptes zélés que par des adversaires obtus. En ce moment même, je préfère me tenir loin de la mêlée et du tapage provoqués par les célébrations officielles et officieuses. J’ai en chantier un opuscule consacré à cette légende, dont les méfaits idéologiques, aussi intolérables qu’ils puissent être, sont peu de chose en comparaison de la misère réelle du monde, qu’aucune théorie, fût-elle marxienne ou marxiste, ne saurait faire disparaître. Ce sera ma contribution à un hommage dont le défunt célébré et maudit peut certes se passer, mais qui se situera hors de la triple entreprise d’enterrement évoquée.
Mais en réaffirmant qu’il faut considérer Marx comme le premier – et le plus efficace – critique du marxisme, on peut se demander si, à votre tour, vous ne contribuez pas aussi à une certaine mystification de Marx, par exempte en le déchargeant totalement du poids de ses « disciples », tout en accablant Engels de tous les maux et en particulier celui d’avoir inauguré le culte de son ami, le jour même de son enterrement ?
– Je me suis contenté de montrer qu’une intelligentsia en mal d’idéologie consolatrice s’évertue à réduire, souvent par pure gloriole, en quelque sorte comme l’investissement le plus rentable de son capital intellectuel, la puissance démystificatrice de l’œuvre de Marx. Seule sa carrière d’auteur marginal et impécunieux a empêché Marx d’élaborer systématiquement le projet d’une triple critique scientifique des institutions bourgeoises.
» Mais il suffit de lire son œuvre pour comprendre que, loin de refuser de « penser le politique », il a mis le « politique » au centre de ses préoccupations. Si bien que son Économie est restée inachevée, qu’il n’a pu que péniblement mettre la dernière main à l’unique livre du Capital, alors que l’ensemble de ses écrits historico-politiques, en fait, sa critique du politique, apparaît comme un ensemble relativement achevé. Elle s’impose aujourd’hui à notre réflexion avec plus de pertinence convaincante que la Critique de la philosophie et la Critique de l’économie politique, comme l’œuvre du premier théoricien de l’anarchisme, donc du critique et dénonciateur sans concession tant du vrai capitalisme que du faux socialisme.
» C’est sur ce point essentiel que devrait s’engager le débat concernant le rôle d’Engels. Contrairement à ce que l’on prétend parfois, je ne le tiens nullement pour responsable de tous les avatars et distorsions subis par la pensée marxienne – surtout depuis l’institution du marxisme-léninisme comme religion d’État – dans la fondation de ce qu’il a cautionné, presque à son corps défendant, sous le concept de « marxisme ».
» Mais comment rester indifférent face aux conséquences, aujourd’hui clairement perceptibles, de ce geste de consécration élevé tôt à la dignité d’un dogme intouchable ? Comment méconnaître le fait qu’en se spécialisant dans les questions militaires Engels a légué, sans s’en douter, à la postérité marxiste un héritage ambigu et aliénant qui, baptisé « marxiste-léniniste », constituera la négation absolue de la cause émancipatrice pour laquelle Marx a vécu et combattu ?
» Cependant, cette ambiguïté peut se retourner contre les héritiers aliénés : Engels aurait sans peine reconnu en eux les continuateurs enragés et aveugles de la politique tsariste. N’oublions pas que Marx lui-même n’a cessé de prêcher la « guerre révolutionnaire ». au prix d’une concession vulgairement « réformiste » à la vocation civilisatrice de l’Occident bourgeois, contre le despotisme asiatique, et spécialement contre la Russie, cet « ultime bastion de la réaction européenne ».
» Soyons sérieux ! Engels aurait été le dernier à se laisser prendre au piège d’une idéologie politique accommodée à la sauce « marxiste », et rien de ce qu’il a dit ou fait, en tant que légataire spirituel de son ami, ne peut servir à légitimer ce marxisme-là.
Le monopole de la Mecque marxiste
– Dans quelles conditions et dans quel esprit avez-vous entrepris la publication des œuvres de Marx dans «La Pléiade» ? A quels obstacles et critiques, notamment politiques, avez-vous été confronté ? Ne pensez-vous pas être aujourd’hui mieux reçu et compris ? En fin de compte, y a-t-il, à votre avis, un usage possible, fécond, de Marx ? Ou bien s’agit-il d’une pensée dépassée?
– En acceptant la lourde responsabilité d’une édition des œuvres de Marx dans la «Bibliothèque de la Pléiade», je savais les risques d’une entreprise conçue à contre-courant d’une tradition enracinée. Elle heurtait une coutume éditoriale devenue pour ainsi dire une loi non écrite, en affrontant le mythe de la double fondation d’une scienzia nova appelée « marxisme ». En outre, elle brisait le monopole que la Mecque marxiste possède dans le domaine des éditions prétendument scientifiques des « classiques du marxisme ».
» Si j’ai aujourd’hui la conviction d’avoir réussi, malgré les difficultés et obstacles que l’on imagine facilement, en revanche, j’ai échoué dans une entreprise similaire, mais bien plus ambitieuse : le projet d’une édition du jubilé des œuvres de Marx dans le texte original. L’histoire de cet échec fera sans doute un chapitre de la Légende de Marx que j’ai en chantier. Mon projet devait se conformer au vœu de l’auteur de faire entendre un appel toujours recommencé et toujours actuel, un réquisitoire éthiquement justifié. L’édition du jubilé devait surtout faire apparaître pourquoi cette œuvre, dès lors qu’elle ne s’affirme qu’en symbiose avec ses sources ouvertement ou tacitement reconnues, répugne à se présenter comme un tout achevé, l’achèvement n’étant pas concevable dans ce processus continu de théorie et de praxis, orienté vers une fin clairement énoncée : la génération de la société humaine ou de l’humanité sociale, accomplissement des visées des utopistes, des réformateurs et des révolutionnaires.
» N’ayant jamais recherché l’approbation ou brigué le verdict de la confrérie des spécialistes, la désapprobation des écolâtres de la théologie marxiste n’a nullement réussi à faire obstacle à la réception plus que favorable de mon travail d’éditeur et de commentateur de l’enseignement marxien. Ce qui m’importait avant tout, c’est que cette édition puisse atteindre les milieux auxquels Marx destinait ses œuvres.
« La classe ouvrière est révolutionnaire ou elle n’est rien du tout », a déclaré Marx, conscient que tous les prestiges du verbe dialectique demeurent vains devant l’attitude de résignation ou de soumission des ilotes modernes. Au risque de heurter l’opinion universellement admise, j’affirme que la vie posthume de l’auteur du Capital est loin d’avoir commencé. S’il est vrai, comme le croyait Nietzsche, que « certains individus naissent posthumes », ce propos ne s’applique pas encore à Marx.
» A la vérité, les cent années de marxisme triomphant démontrent le contraire d’une résurrection spirituelle de ce penseur qui se reconnaissait essentiellement dans son activité d’éducateur en situation d’apprentissage permanent. Le triomphe du marxisme comme idéologie du socialisme réellement inexistant dissimule en fait un échec flagrant : la carrière posthume du penseur et praticien de de l’éthique prolétarienne ressemble à une longue agonie plutôt qu’à une présence révolutionnaire. »
Le parti de la mystification (Rubel, 1976)
30 Mai 2011Article de Maximilien Rubel paru dans Le Monde du 7 mai 1976. [Nous avions déjà publié sa traduction en anglais par A. Buick: The Dictatorship of the Proletariat ].
Dans le débat sur l’« abandon » par le parti communiste français de la dictature du prolétariat, personne ne semble avoir mentionné un fait qui méritait pourtant d’être mis en lumière. Il permet d’éclairer, en effet, mieux que tout autre le sens et la nature de cette démarche : c’est le parti qui s’arroge le droit de décider si le prolétariat doit ou non exercer sa dictature ; c’est le parti, voire son secrétaire entouré de ses idéologues, qui, se substituant à la classe et à la masse des travailleurs, décide de rayer d’un trait de plume ce qui, selon Marx, représente une « période », transitoire certes, mais nécessaire et inévitable de l’évolution de la société et nullement un phénomène accidentel susceptible d’être abandonné ou accepté au gré des impératifs de la nouvelle stratégie politique dictée par le programme commun. Le parti se garde bien de remettre en question l’essentiel, à savoir ses prérogatives, de représentant autoproclamé de la classe ouvrière. C’est toujours lui qui, par la voix de ses chefs, décide au lieu et place de la classe ouvrière, c’est lui qui définit la nature et la forme que doit prendre l’action de cette classe ; et rien ne garantit que l’abandon de la dictature du prolétariat entraîne l’abandon de la dictature sur le prolétariat, la seule qui importe au parti.
Le concept de dictature du prolétariat est partie intégrante de la théorie du développement du mode de production capitaliste et de la société bourgeoise, développement dont Marx affirme avoir révélé « la loi naturelle ». Engels range cette théorie parmi les deux grandes découvertes scientifiques de son ami, après la conception matérialiste de l’histoire comparable à la découverte de Darwin : « Ainsi que Darwin a découvert la loi de l’évolution de la nature organique, Marx découvrit la loi de développement de l’histoire humaine. » Le postulat politique de la dictature du prolétariat s’inscrit dans la perspective d’une société capitaliste pleinement développée, terrain de l’affrontement entre une classe possédante fortement minoritaire, mais au sommet de son pouvoir, et une classe ouvrière largement majoritaire, dépossédée économiquement et socialement, mais intellectuellement et politiquement mûre et apte à établir sa domination par la « conquête de la démocratie » au moyen du suffrage universel. Parvenu à cette position dominante, le prolétariat n’usera de la violence que pour répondre à la violence, au cas où la bourgeoisie quitterait le terrain de la légalité afin de conserver ses privilèges de domination. La dictature du prolétariat est décrite dans la conclusion du Capital comme « expropriation des expropriateurs » , autrement dit comme « expropriation de quelques usurpateurs par la masse ».
Tout en étant limitées à une étape déterminée de l’évolution globale du genre humain, les lois et les tendances du développement de l’économie capitaliste « se manifestent et se réalisent avec une nécessité de fer », les pays développés industriellement montrant aux pays moins développés « l’image de leur propre avenir ». Donnant la parole à un critique russe du Capital, Marx souscrivait sans réserve à une interprétation qui mettait tout l’accent sur le déterminisme implacable de sa théorie sociale : elle « démontre, déclarait ce critique, en même temps que la nécessité de l’organisation actuelle, la nécessité d’une organisation dans laquelle la première doit inévitablement passer, que l’humanité y croie ou non, qu’elle en ait ou non conscience ». Marx lui-même n’est pas moins catégorique : « Lors même qu’une société est arrivée à découvrir la piste de la loi naturelle qui préside à son mouvement (…) elle ne peut dépasser d’un saut ni abolir par des décrets les phases de son développement ; mais elle peut abréger la période de la gestation et adoucir les maux de leur enfantement. » (Le Capital.)
Que faudrait-il penser d’une société de savants qui oserait proclamer le « renoncement » à la loi newtonienne de l’attraction universelle ou aux lois mendéliennes de la hybridation des plantes et de l’hérédité chez les végétaux ? Et qui invoquerait, pour justifier sa décision, le caractère « non dogmatique » de ces lois, sans se soucier de les réfuter par des méthodes scientifiques, mais en prétextant un profond changement des modes de pensée dans les classes non intellectuelles ? Cette société « savante » se couvrirait de ridicule. Telle est pourtant l’attitude de la compagnie savante se disant communiste et marxiste qui, tout en se réclamant d’une théorie dont elle ne cesse de souligner le caractère scientifique, en rejette l’enseignement majeur, celui même qui intéresse l’existence de la majorité des hommes : agissant au nom du « socialisme scientifique », ses dirigeants et idéologues ne déclarent-ils pas que l’évolution des sociétés capitalistes a rendu caduc l’impératif de la dictature du prolétariat, ce qui équivaut à remettre en question une thèse que Marx lui-même considérait comme son principal apport au socialisme scientifique.
Il importe peu de savoir si l’ « abandon de la dictature du prolétariat » répond à des impératifs de tactique électorale ou renvoie à d‘autres préoccupations : car cet « abandon » signifie au fond que les responsables de la politique du parti écartant du débat le principal intéressé, le prolétariat, qui seul a pour « mission historique » de libérer les sociétés de l’esclavage de l’argent et de l’Etat, donc d’exercer sa dictature. Ainsi le veut la science de Marx autant que le simple bon sens non marxiste : la dictature du prolétariat ne pouvant être que l’affaire des exploités – donc de la presque totalité de l’espèce humaine, – la décision d’un parti, quel qu’il soit, d’effacer un postulat dont la portée éthique le dispute au revêtement scientifique ne saurait avoir le moindre effet sur l’évolution de la société et la vocation révolutionnaire et émancipatrice des esclaves modernes. Car si le mouvement ouvrier est, d’après le Manifeste communiste, « le mouvement de l’immense majorité dans l’intérêt de l’immense majorité », la dictature du prolétariat peut être définie comme la domination de l’immense majorité dans l’intérêt de l’immense majorité, autrement dit, l’autodétermination du prolétariat. En somme, elle est censée réaliser les promesses d’une démocratie intégrale, l’autogouvernement du peuple, contrairement à la démocatie partielle (bourgeoise) dont les institutions assurent la dictature des possédants – du capital contrôlant le pouvoir politique, donc d’une minorité de citoyens – sur les non-possédants, donc sur l’immense majorité des citoyens. Dans ces conditions, comment expliquer qu’un parti se réclamant de Marx et du communisme abandonne une conception de la dictature du prolétariat qui – à tort ou à raison – annonce l’avènement de la démocratie intégrale ?
Alors qu’avant 1917 Lénine rêvait pour la Russie d‘un autogouvernement des ouvriers et des paysans, après la prise du pouvoir, il s’orientera vers la conception d’une dictature du prolétariat susceptible d’être exercée par la « dictature de quelques personnes », voire « par la volonté d’un seul » ; cette conception correspondait parfaitement à l’état économique et social d’un pays qui pouvait tout « développer » excepté le… socialisme, la dictature du parti ayant pour objectif la création du prolétariat « soviétique » et non l’abolition de celui-ci. donc la mise en place de rapports sociaux compatibles avec l’exploitation du travail salarié et là domination de l’homme par l’homme. C’est à cette école et non à celle de Marx que les dirigeants des partis communistes ont pris leurs leçons d’hommes politiques. C’est eux-mêmes qu’ils condamnent en prenant leur distance avec un régime qui a su construire pour des millions de paysans prolétarisés un archipel de bagnes dont la description n’a d’analogue que l’Inferno de Dante.
L’impératif de la dictature du prolétariat implique la vision de l’abrègement et de l’adoucissement des maux d’enfantement de la société enfin humaine. Les révolutions « marxistes », russe et chinoise, n’ont fait que susciter le mal qu’elles sont censées avoir supprimé. Telle est la mystification de notre époque. Et si les partis dits ouvriers peuvent décréter l’« abandon de la dictature du prolétariat », n’est-ce pas parce que le prolétariat n’a pas (encore ?) cette conscience révolutionnaire que la conception matérialiste de l’histoire tient pour le résultat fatal du devenir-catastrophique du mode de production capitaliste en pleine expansion mondiale ?
Critique sociale N°14
31 janvier 2011Le numéro 14 de Critique Sociale (février 2011) est disponible au format PDF.
Au sommaire :
– Actualité :
* La révolution tunisienne ouvre la voie
– Histoire et théorie :
* Entretien avec Maximilien Rubel (1979)
* Paul Frölich (1884-1953) : parcours militant du biographe de Rosa Luxemburg
Critique Sociale est un bulletin d’informations et d’analyses pour la conquête de la démocratie et de l’égalité. Notre but est de contribuer à l’information et à l’analyse concernant les luttes sociales et les mouvements révolutionnaires dans le monde. Nous nous inspirons du « marxisme », en particulier du « luxemburgisme », certainement pas comme des dogmes (qu’ils ne sont en réalité nullement), mais comme des outils contribuant au libre exercice de l’esprit critique, à l’analyse de la société, et à la compréhension de sa nécessaire transformation par l’immense majorité. Nous combattons le capitalisme et toutes les formes d’oppression (sociales, politiques, économiques, de genre). Nous militons pour que « l’émancipation des travailleurs soit l’oeuvre des travailleurs eux-mêmes », pour une société démocratique, libre, égalitaire et solidaire : une société socialiste, au véritable sens du terme.
site http://www.critique-sociale.info. contact – @ – critique-sociale.info
Pour recevoir régulièrement ce bulletin, envoyez simplement un mail à : critiquesociale-subscribe@yahoogroupes.fr
Pour une union mondiale des tendances révolutionnaires (Rubel, 1983)
9 janvier 2010Texte rédigé par Maximilien Rubel d’après la plaquette de Ngo Van Avec Maximilien Rubel… Combats pour Marx 1954–1996: une amitié, une lutte. Source: original de 6 pages dactylographiées que nous a envoyé le SPGB.
On peut considérer que la théorie révolutionnaire est achevée, mais on doit aussi reconnaître que cet achèvement théorique n’a pas abouti jusqu’à présent à un mouvement révolutionnaire authentique mettant en péril l’ordre social mondial dominé par le capitalisme et l’État. Ces deux fléaux dont disposent les oligarchies économiques et politiques menacent aujourd’hui l’humanité d’un cataclysme qui n’a pas son pareil dans l’histoire. Ils maintiennent l’espèce humaine dans un état de servitude permanente, l’insécurité matérielle et morale des masses entraînant quasi automatiquement la soumission de l’immense majorité aux entreprises d’exploitation économique et aux aventures politico-militaires des pouvoirs établis.
Les discours politico-militaires des gouvernants des pays réellement capitalistes et des pays faussement socialistes révèlent par leur identité foncière des symptômes d’une nouvelle forme d’aliénation mentale que l’on est en droit de considérer comme un nouveau genre de paranoïa. La pathologie de cette aliénation dissimulée derrière des discours parfaitement logiques reste à élaborer, alors que les meilleurs représentants de la psychiatrie et de l’antipsychiatrie modernes, presque exclusivement hantés par les « structures asiliaires », dédaignent de s’intéresser au caractère paranoïde des comportements observables parmi les membres de la classe politico-militaire tant dans les pays hautement civilisés que dans les pays « en développement ».
Il importe, par conséquent, de constater l’évidence: les peuples du monde sont prêts à jouer le jeu infernal de leurs gouvernements, à l’Ouest comme à l’Est, du Nord au Sud, quelques que soient les régimes établis, « démocratiques » ou « totalitaires », la nature du mode de production sur lequel ces régimes sont fondés étant identique. S’il existe partout des foyers d’opposition ou de subversion, ceux-ci ne présentent nulle part une véritable menace pour les classes dominantes, même si à l’intérieur de celles-ci s’affrontent des tendances idéologiques et politiques rivales. Face aux masses dépossédées et asservies, les maîtres des moyens de production et de distribution, dans le domaine économique comme dans le domaine culturel, se livrent frénétiquement à leurs jeux démentiels, pour satisfaire leurs besoins et leurs instincts les plus pervers aux dépens de ces masses. Les individus, hommes et femmes, que l’on peut encore aujourd’hui – malgré les immenses progrès des sciences et des techniques – ranger sous la catégorie des « masses laborieuses », accomplissent les tâches matérielles et intellectuelles nécessaires au maintien et au développement de la civilisation bourgeoise, donc de la barbarie du capital, dont ils acceptent et soutiennent plus ou moins consciemment le système des valeurs dans l’ordre de la morale et de la culture, donc dans leur existence quotidienne de citoyens et de producteurs.
Rien ne caractérise mieux l’état actuel du monde que la perspective, quasi unanimement acceptée, d’une nouvelle guerre mondiale envisagée comme l’ultime recours pour le sauvetage des biens et valeurs proclamés, sacrés, par les maîtres du pouvoir politico-militaire et du savoir technocratique. « Plutôt mort qu’américanisé », pontififie-t-on dans les pays décrétés socialistes.
***
« La classe ouvrière est révolutionnaire, ou elle n’est rien » (Marx, 1865)
Si nous acceptons aujourd’hui cet avertissement, nous serons bientôt amenés à admettre qu’une seule alternative se dessine devant nos yeux: la révolution ou le néant. Devant ce choix fatal, la seule chance de salut réside dans l’existence ou l’organisation d’un mouvement révolutionnaire dont la seule devise devrait être: « La praxis avant tout, ensuite la théorie! » Bien entendu, l’action ne s’oppose nullement à la réflexion théorique, mais sa finalité révolutionnaire ne doit pas être subordonnée à une théorie tenue pour infaillible et moins encore à une idéologie quelle qu’elle soit, puisque, ainsi que l’expérience des mouvements groupusculaire nous le prouve, toute adhésion idéologique est synonyme d’enlisement sectaire. Les oligarchies dominantes n’ont rien à craindre des professions de foi révolutionnaires que se lancent, à longueur de pages enflammées, les groupes idéologiquement divisés, opposés dans leurs périodiques respectifs, le plus souvent à tirage réduit et à parution éphémère.
« … l’union des travailleurs est la première condition de leur triomphe » (Marx, 1847)
Nulle théorie n’est nécessaire, nul marxisme, pour admettre cette vérité qui est bien antérieure à l’œuvre de Marx. Mais l’admettre et s’y conformer sont deux positions bien différentes. La simple constatation de l’existence de nombreux groupes et partis se disant « marxistes », de plusieurs écoles de pensée se réclamant d’une variété particulière de marxisme et invoquant pieusement telle ou telle célébrité de la postérité marxiste (Lénine, Rosa Luxemburg, Trotski, Mao, etc.), ce seul fait démontre l’impuissance des servants du culte marxiste devant l’indifférence et l’apathie des masses auxquelles ils destinent leurs lumières théoriques.
Le but révolutionnaire ne sera atteint que si le mouvement est porté par des individus dont le comportement et l’action tendent à l’union et à la solidarité plutôt qu’à un accord théorique; si ce mouvement se confond avec l’activité de masses d’individus dont la force révolutionnaire [espace] leur nombre et que leur soumission à des mots d’ordre d’avant-garde divisées entre elles par des « plateformes » contradictoires qui sont autant d’obstacles à l’union des travailleurs manuels et intellectuels. Il est conforme à la lettre et à l’esprit de l’enseignement des penseurs socialistes du XIX° sicèle, Marx y compris, d’accorder la priorité à la pratique révolutionnaire sur la spéculation verbale et de concentrer la réflexion sur une action concrète portée par un mouvement de masses. Il importe donc d’élaborer ensemble un projet de subversion sociale progressive dans le respect critique des impératifs révolutionnaires hérités des réformateurs (socialistes, communistes, anarchistes) dont les contributions théoriques et pratiques gardent encore aujourd’hui une certaine valeur.
En esquissant ce projet d’action, nous renonçons à en appeler à l’autorité de Karl Marx et encore moins à celle d’un marxisme quel qu’il soit. Notre hommage, en cette année du centenaire, s’adresse à travers son œuvre à la cause émancipatrice qu’il avait faite sienne, donc à la révolution imaginaire dont l’accomplissement pratique nous importe plus que les interminables et stériles querelles des professionnels du discours idéologique ou académique. A la différence d’autres penseurs du XIX° siècle, traités de « grands », les Hegel, Kierkegaard ou Nietzsche, Marx cherche aujourd’hui comme hier le contact avec la « vile multitude », le contact avec la « masse massive », la communication avec l’humanité souffrante qui pense et veut agir, tout comme avec l’humanité pensante consciente de son aliénation.
Il est, en effet, intolérable qu’un penseur révolutionnaire dont l’œuvre se destine avant tout à la classe la plus nombreuse et la plus pauvre (selon le terme de Saint-Simon), soit confisquée par des castes d’intellectuels pour qui l’interprétation du monde l’emporte sur la transformation du monde. Il n’est pas juste que « l’Année Marx » soit célébrée par des discours sans conséquence et par des exégèses sans portée aucune ni pour le prolétariat des pays riches ni pour les masses affamées et humiliées des pays pauvres.
***
Imaginons un mouvement révolutionnaire offrant le maximum de chances de réussite. Seul un mouvement organisé sur la base d’un projet global, épuré de toute ambiguïté idéologique et de toute référence à des concepts désormais entrés par usurpation dans le discours officiel des régimes proclamés « socialistes » ou « communistes », seul un mouvement capable de s’inventer un nouveau langage sans artifice jargonnant mais fidèle à l’esprit critique des pionniers de l’émancipation humaine, seul un tel mouvement pourrait avoir prise sur les consciences des victimes des fléaux signalés précédemment: le capital et l’État. Les principes d’association à adopter se réduisent à un petit nombre de constatations et de postulats empiriques portant,
1°, sur la nature de la crise mondiale annonciatrice d’une catastrophe sociale sans précédent, suite normale des calamités qui ont jalonné l’histoire de notre vingtième siècle jusqu’à ce jour et qui continuent à nous accabler à chaque instant de notre existence;
2°, sur la nécessité prioritaire d’une union des forces révolutionnaires éparses, divisées par des convictions idéologiques dont se nourrit le sectarisme stérile, au seul profit des détenteurs du pouvoir politique et intellectuel;
3°, sur les règles de conduite révolutionnaire, la plus efficace semblant être, dans les circonstances historiques actuelles, l’arme de la GRÈVE GÉNÉRALE entraînant la rupture totale et décisive avec les mécanismes de contrainte et d’abrutissement grâce auxquels les oligarchies économiques et politiques ont jusqu’ici réussi à se maintenir et à se renforcer.
« Pour le triomphe des principes énoncés dans le Manifeste communiste, Marx se fiait uniquement au développement intellectuel de la classe ouvrière, tel qu’il devait résulter nécessairement de l’union et de la discussion commune » (Engels, 1890).
Pour peu que nous prenions au sérieux ce propos, nous y verrons une exhortation à subordonner nos divergences théoriques à l’impératif de parvenir à la plus large Union mondiale des tendances révolutionnaires. Ce sera en quelque sorte l’acte fondateur préalable à toute discussion relative aux trois principes d’association définis plus haut.
A cet effet, nous proposons un programme d’action à entreprendre dans le délai le plus bref possible, lequel ne devrait pas dépasser l’année 1983:
1°, organisation d’un « Colloque fraternel » où se feraient connaître les représentants des « groupes » (au sens le plus large du terme) pouvant être caractérisés comme des « tendances révolutionnaires » en raison de leur position théorique et de leur activité de propagande. Ce colloque pourrait se tenir pendant la semaine de noël 1983, à Paris.
2°, publication d’un bulletin de correspondance (trimestriel?) qui serait l’organe provisoire des « candidats » au titre de « tendance révolutionnaire ». Les modalités de ce projet seront discutées lors du « Colloque fraternel ».
3°, constitution immédiate de « Comités de correspondance » en vue des réalisations sous 1° et 2° et aboutissant à la formation d’un « Réseau de communication ».
Ce projet est proposé à la réflexion des camarades pour qui penser et agir sont inséparables, étant entendu que l’association pour définir des modes d’action constitue en elle-même une manière d’agir, et que les querelles idéologiques ne doivent pas entraver l’union des tendances révolutionnaires: les chances de tout mouvement révolutionnaire dépendent de la réalisation de cette union.
Paris, juin 1983
Comité de correspondance de Paris
Prière de communiquer tout courrier relatif au présent projet à l’adresse ci-après:
Comité de correspondance de Paris
c/o SPARTACUS
5, Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie
75004 PARIS
France































































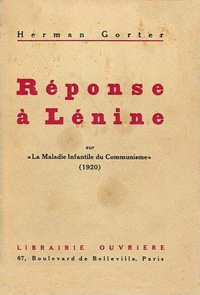

















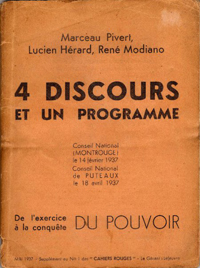



 Brochure sur l'assassinat d'A. Nin
Brochure sur l'assassinat d'A. Nin 
 Numéros de L'Insurgé de 1942 et 1943
Numéros de L'Insurgé de 1942 et 1943


 Brochure Spartacus
Brochure Spartacus


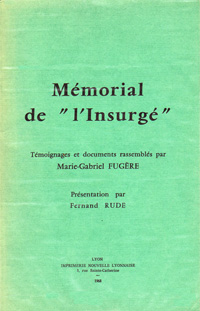 Mémorial de
Mémorial de 





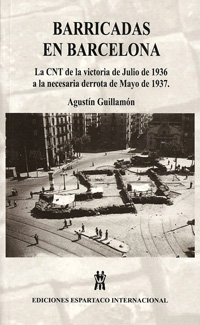


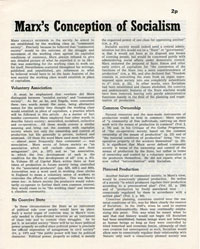













 page
page






Vous devez être connecté pour poster un commentaire.