Traduction par nos soins d’un article de Felix Baum paru dans The Brooklyn Rail (déc. 2015/janvier 2016). Quelques courts extraits de la biographie de Mattick par Roth seront traduits en français dans le prochain numéro de Critique sociale.
Le mot « communisme », qu’on avait cru discrédité à jamais par l’expérience en Russie et dans ses pays satellites au XX° siècle, semble bénéficier d’un retour en grâce ces dernières années avec le retour des crises économiques et des luttes sociales à travers le monde. Des conférences sur « l’idée du communisme » attirent du monde, des livres d’auteurs se réclamant communistes comme Alain Badiou et Slavoj Žižek trouvent des lecteurs et l’attention des médias. Mais le plus souvent ce retour (limité) ne semble pas poussé par un véritable désir de retrouver le contenu émancipateur du mot comme dans les écrits de Karl Marx et les mouvements du XIX° siècle. Les maîtres-penseurs (*) Badiou et Žižek préfèrent se poser en enfants terribles (*), défendant le maoïsme et flirtant avec la terreur bolchevique, réaffirmant précisément une tradition avec laquelle le « communisme » du XXI° siècle devrait rompre.
Dans sa nouvelle biographie de Paul Mattick, travailleur d’origine allemande émigré aux États-Unis en 1926 qui devint l’un des plus important critiques radicaux de son temps, Gary Roth parle d’un courant largement oublié du XX° siècle qui a dès le début rompu avec les caricatures étatistes du communisme dans lesquelles sont encore les intellectuels de gauche médiatiques. [Gary Roth, Marxism in a Lost Century. A Biography of Paul Mattick (Brill, 2015).] Notant que cette histoire relève d’ « époques révolues où une classe ouvrière radicalisée constituait encore un espoir pour l’avenir », Roth évite la mélancolie et la nostalgie, cherchant à justifier son travail dans une reconfiguration récente « de la population mondiale en une vaste classe ouvrière s’étendant aux classes moyennes dans les pays industrialisés et aux travailleurs agricoles sous-employés partout ailleurs ». Tout en étant loin de constituer une offensive soutenue et cohérente contre les conditions existantes, quelques luttes récentes de cette classe, notamment les “square movements” qui se sont propagés de l’Afrique du Nord vers l’Europe et Istanbul, montrent une auto-organisation horizontale, sans dirigeants, une action de masse directe contre les forces d’État, un intérêt pour les occupations qui relève bien moins de la tradition léniniste que ne le dit Roth mais plus du communisme de conseil, sans en exagérer pour autant les ressemblances. [1]
Né en 1904 dans une famille de la classe ouvrière de Berlin, Mattick chemine vers ce courant pendant les bouleversements de la fin de la Première Guerre mondiale, quand il était encore un adolescent. Alors que le rôle infâme du Parti social-démocrate allemand (SPD) dans cette période (notamment son implication dans l’assassinat de ses anciens membres Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht par les Corps francs) est largement reconnu, même par les historiens libéraux, le radicalisme ouvrier de ces années-là est resté une affaire de spécialistes. Même en Allemagne, beaucoup à gauche ne savent quasiment rien du KAPD, le Parti communiste-ouvrier qui rompit avec le Parti communiste nouvellement fondé (KPD) quand celui-ci abandonna son abstentionnisme initial et son boycott des syndicats traditionnels. Surfant sur une vague d’agitation prolétarienne, ce parti a été capable d’entraîner vers lui une majorité de militants du KPD, ce dernier devenant une organisation croupion transformée lentement mais sûrement en annexe locale des bolcheviks victorieux en Russie. Bien que fascinés au début, non seulement par l’Octobre rouge mais aussi par le rôle qui jouèrent les bolcheviks, les communistes de conseils prirent bientôt une distance critique vis-à-vis de l’U.R.S.S., y voyant l’établissement d’un capitalisme d’État sous contrôle strict du parti unique. Opposant l’activité auto-dirigée des travailleurs à la dictature du parti, ils ont compris que les conseils qui étaient apparus en Russie en 1905 étaient non seulement une forme de lutte sous le capitalisme, mais aussi le germe d’une nouvelle société sans classe sous contrôle direct des producteurs, et ont fait de l’abolition du salariat leur cri de ralliement.
C’étaient ces perspectives de base, forgées dans le feu de luttes qui étaient parfois à la limite de la guerre civile, qui ont façonné les activités et les écrits de Mattick jusqu’à la fin de sa vie. En suivant Mattick dans les grèves d’usine, dans ses activités comme militant de l’organisation de jeunesse du KAPD et dans sa vie personnelle, Roth dresse un portrait coloré du milieu entourant le KAPD et les Unionen qui ont compté plusieurs centaines de milliers de membres au début des années 20, ainsi que des cercles d’intellectuels d’avant-garde qui gravitaient autour de revues comme Die Aktion.
Avec le fléchissement des luttes et le déclin rapide du KAPD, Mattick décida de partir aux États-Unis en 1926. Il était ici, à Chicago, pour le second évènement majeur de sa vie militante. Tandis qu’il continue d’écrire pour la presse radicale en Allemagne et, lisant, se forme en autodidacte sur les questions théoriques pour devenir bientôt un auteur exceptionnel, il se lie aux I.W.W. (Travailleurs industriels du monde) et à la communauté socialiste allemande émigrée. Là encore, Roth redonne vie à un milieu d’une époque révolue, celui de travailleurs politisés et de leurs organisations secouées de querelles et scissions constantes. A partir de 1932, Mattick ayant perdu son travail à l’usine Western Electrics, a participé au mouvement des chômeurs à Chicago. Il a décrit plus tard ces années comme les meilleures de sa vie, celles où il pouvait militer à plein temps. Il est intéressant de lire la description que donne Roth de ce mouvement, qui contraste avec la tranquillité sociale aux Etats-Unis lors de la dernière crise. Bien que moindre que l’effervescence sociale en Europe après la Première guerre mondiale, le mouvement des chômeurs radicaux auquel a participé Mattick se caractérisa par des formes d’action directe qui combinaient l’entraide matérielle et l’activisme politique:
The unemployed began to use abandoned storefronts for their own purposes. Locks were broken, and the stores became meeting places, with chairs taken from deserted movie houses. Mattick estimated that there were some fifty or sixty such locales in Chicago [ … ]. Mimeograph machines were installed for the production of leaflets and movement literature. Paper was contributed by those still employed, who stole office supplies from their workplaces. [ … ] Gas lines were tapped without setting off the meters [ … ] Makeshift kitchens were set up in the storefronts and meals cooked around the clock.
Cependant, ces tendances les plus radicales furent déjouées par les organisations de chômeurs des partis de gauche plus grands, tandis que le développement de l’aide sociale et de l’emploi public dans l’administration Roosevelt amenait une éclipse finale du mouvement d’ensemble.
Avec un groupe de communistes de conseils à Chicago, Mattick a commencé à publier la revue International Council Correspondence (ICC) en 1934, rebaptisée plus tard Living Marxism et enfin New Essays. Avec Karl Korsch (un ancien membre du SPD et du KPD, celui aurait enseigné le marxisme à Bertolt Brecht) Mattick en a été le principal contributeur en textes. Mettant l’accent sur les développements contemporains comme la Grande Dépression et le New Deal, la guerre civile espagnole et la montée du fascisme et du nazisme en Europe et débattant de questions théoriques plus générales, ICC est un excellent exemple de critique sociale indépendante sans affiliations universitaires ou à un parti , produite par quelques intellectuels précaires et des théoriciens autodidactes comme Mattick. Avec de nombreuses traductions de textes des radicaux européens, ICC a également servi de pont entre l’Amérique et le vieux continent à une époque de rivalité impérialiste accrue. [2]
Pendant les mêmes années, Mattick a eu des relations plutôt difficiles avec l’Institut de Francfort (Frankfurt Institute of Social Research) en exil. L’Institut, surtout connu par ses plus célèbres membres Max Horkheimer, Theodor Adorno et Herbert Marcuse, lui a commandé une analyse détaillée du chômage et du mouvement des chômeurs aux États-Unis mais a répugné à la publier, sans doute parce qu’elle exposait clairement une orientation marxiste que l’Institut se pressait désormais de minimiser afin de ne pas compromettre son statut aux États-Unis. Cette analyse lucide fut publiée pour la première fois en 1969 par un petit éditeur allemand et ne fut jamais traduite en anglais. Les relations entre Mattick et l’Institut de Francfort durant les années de guerre font partie des sujets pour lesquels une étude plus approfondie que celle qui peut l’être dans le cadre d’une biographie serait intéressante. Alors que certains membres de l’Institut commencèrent à travailler pour l’Office of Strategic Services, apportant des analyses du fascisme nazi à l’appareil d’État américain et contribuant donc à l’effort de guerre de celui-ci, Mattick appartenait à une petite minorité de radicaux qui rejetaient les deux bords, pour la Seconde guerre mondiale comme pour la première.
D’un côté, cette position semble logique, comme le rappelle Roth:
Under the banner of anti-fascism, the Communist Party embraced Roosevelt and the New Deal, egged forward the country’s economic and military policies, and found a new audience among intellectuals and professionals for whom Russia offered a means to appreciate the accomplishments of state planning. The more patriotic the party became, the more members it attracted.
D’un autre cependant, elle semble s’être basée sur des notions problématiques, comme celle d’une tendance générale vers l’État autoritaire, une incompatibilité générale du capitalisme et de la démocratie, conduisant à l’idée que l’issue de la guerre ne ferait aucune différence. « Si Hitler gagne, il est vrai (écrit Mattick dans le numéro de l’hiver 1941 de Living Marxism) qu’il n’y aura ni paix, ni socialisme, ni civilisation, rien que la préparation de plus grandes batailles à venir, pour une destruction à venir. Mais s’il y a victoire des « démocraties », la situation ne sera pas différente ». Cela s’étendra à une équation entre le système des camps de concentration nazis et la politiques des Alliés en Allemagne occupée: impressionné par des rapports d’amis et de la famille en Allemagne sur la pénurie dramatique de nourriture (et se référant au camp de Bergen-Belsen), Mattick écrit dans une lettre que si les nazis ont privé de nourriture une minorité à Bergen, les Alliés ont mis presque toute la population à ce régime.
En même temps, il faut le dire, la discussion sur la guerre et le fascisme dans Living Marxism et New Essays était très complexe; la revue a été l’un des rares endroits où des esprits indépendants pouvaient tenter de se confronter à une situation déconcertante et inconnue. Korsch, par exemple, notait que le slogan de la Première guerre mondiale « A bas la guerre impérialiste ! » avait désormais perdu son ancienne force révolutionnaire, quand il correspondait aux tendances des isolationnistes bourgeois, tandis que le slogan « Défaite de son propre pays » était devenu la pratique politique de cette importante fraction de la classe dirigeante de divers pays européens qui préférait la victoire du fascisme à la perte de sa domination. La note un peu triomphaliste par laquelle termine Korsch – ce n’est ni la Grande-Bretagne ni la « démocratie » mais le prolétariat qui est le champion de la lutte de l’humanité contre le fléau du fascisme – s’est avérée un vœu pieux. Mais il est hors de portée de cette note de lecture d’approfondir ces questions. Dans les paragraphes qui leur sont consacrés, Roth, qui semble partager le point de vue de Mattick, ne parvient pas à mon avis à régler le problème.
En tout cas, la fin de la Seconde guerre mondiale n’a pas donné lieu à de grands bouleversements sociaux comme l’avait fait la précédente. Dans la période d’après-guerre, Mattick s’est abstenu la plupart du temps d’activité politique, se retirant temporairement avec sa femme Ilse et son fils Paul dans la campagne du Vermont. Pourtant, c’est pendant cette seconde partie de sa vie qu’il est finalement apparu comme l’un des principaux penseurs de l’émancipation sociale inspirés par Marx, justement en rejetant à peu près toutes les variétés de marxisme académique ou encarté de l’époque. Plus important encore, Mattick a repris la théorie des crises de Marx qui était démodée pendant les Glorieuses quand la plupart des marxistes croyaient que la gestion par l’Etat de l’économie avait apporté une éternelle « société d’abondance »en neutralisant la tendance du capitalisme à la crise. Le principal travail de Mattick, Marx et Keynes, publié en 1969, a dissipé ces illusions avant qu’elles ne deviennent indéfendables, et lui a assuré un lectorat plus large. Ayant raconté (parfois un peu trop en détail) les difficultés de Mattick à faire publier ses textes, Roth a aussi évoqué son succès posthume, notamment en Europe de l’Ouest, où certaines parties de la Nouvelle Gauche qui n’avaient pas d’appétences néo-bolcheviques ou maoïstes ont développé une Mattick-mania pendant quelques années. Des événements comme mai 68 à Paris et les luttes autonomes des travailleurs en Italie ont fourni un terrain fertile pour une redécouverte de la tradition du communisme de conseils dont Mattick était l’un des rares partisans vivants.
En suivant Mattick à travers ce « siècle perdu », Roth livre un riche récit d’une tradition radicale qui, après une certaine renaissance dans les années 60 et 70, est de nouveau tombée dans l’oubli. La biographie exclut naturellement un examen en profondeur des questions politiques et théoriques en jeu. Roth déclare explicitement qu’il ne veut pas mettre l’accent sur le travail théorique de Mattick parce qu’il voit « peu de raisons de résumer un travail qu’il vaut mieux lire dans l’original » (et dont des parties importantes peuvent se trouver sur internet aujourd’hui.) Pourtant, dans certains cas, les contours et la signification contemporaine de cette théorie auraient pu être rendus plus clairement, tandis que certains détails biographiques semblent plutôt dispensables. Pour les lecteurs qui se sentent inspirés à poursuivre la lecture dans les écrits de Mattick et de ses camarades, les points forts du livre l’emportent de loin sur cette lacune.
Felix Baum
Notes:
[*] en français dans le texte (Note du traducteur de la BS)
[1] Voir l’entretien avec Charles Reeve en 2012 (Note de la BS)
[2] Greenwood Press a réédité les textes des trois revues dans leur intégralité en 1970 dans une édition en six volumes aujourd’hui épuisée. L’auteur ne semble pas connaître leur mise en ligne récente sur internet.













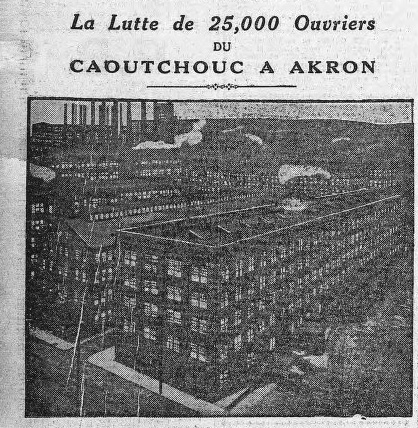

























































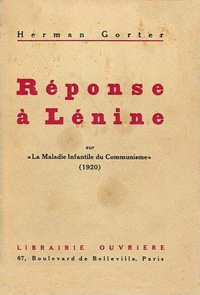

















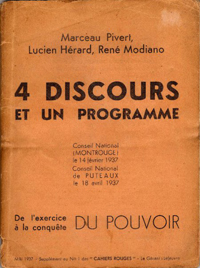



 Brochure sur l'assassinat d'A. Nin
Brochure sur l'assassinat d'A. Nin 
 Numéros de L'Insurgé de 1942 et 1943
Numéros de L'Insurgé de 1942 et 1943


 Brochure Spartacus
Brochure Spartacus


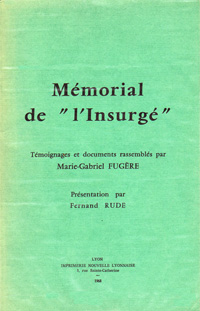 Mémorial de
Mémorial de 





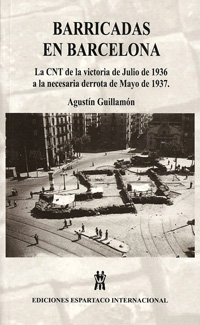


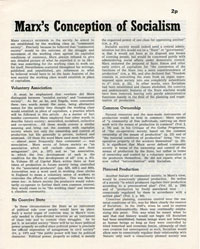













 page
page






Vous devez être connecté pour poster un commentaire.